Diverses « Chroniques de Paris » parues dans Le Temps en février 1872. Page web mise en ligne le dix novembre 2025. Temps de lecture : vingt minutes.
Rabagas — Le Bal de l’opéra — Deux dictionnaires académiques — Le Carnaval — L’Institution de mariage — Le chanoine joueur — Notes
Comme dans ses Vie à Paris de 1880, dans ses Chroniques de Paris, Jules Claretie traite de sujets du jour. Si tous, peut-être, intéressaient les lecteurs du lendemain, certains, de nos jours, semblent moins passionnants. C’est dans ces occasions que l’on observe combien certains sujets présentent un intérêt durable à travers les siècles. Intérêt, d’ailleurs, largement orienté par claretie.fr, essentiellement d’ordre littéraire.
Autant les Vie à Paris sont reproduites ici intégralement, autant des libertés ont pu être prises avec certaine Chroniques de Paris, dont de grandes parties ont été abandonnées. Prenons la première, parue dans Le Temps du trois février 1872. Cette chronique — le fait est rare — traite d’un unique sujet, Rabagas, pièce de théâtre de Victorien Sardou très controversée. Jules Claretie s’y est rendu pour la première. Le lendemain il aborde sa chronique par des informations nouvelles sur la représentation suivante. Mais ce second texte ne fait que 93 mots. La suite ? Des élections en Corse. Sans vouloir froisser qui que ce soit, qui, en 2025, s’intéresse, hors des spécialistes pointus, à les élections locales d’il y a plus de cent-cinquante ans ?
C’est donc un choix, le plus agréable possible — dans les années 1960 on aurait parlé de « tranches de vie » ; qui est proposé ici.
Rabagas
« Chronique de Paris » parue dans Le Temps du trois février 1872.
C’est de la première de Rabagas, comédie en cinq actes, en prose, dont il est question ici. Il y a quinze jours Victorien Sardou a offert une féérie au théâtre de la gaîté des Arts-et-Métiers, Le Roi Carotte, avec une musique de Jacques Offenbach, qui a remporté un immense succès populaire, et qui se joue encore. Ici nous sommes dans un autre des grands théâtres de Paris, le Vaudeville. Le théâtre du Vaudeville se trouvait alors à son quatrième et dernier emplacement, après avoir déménagé trois fois. C’est pour cette raison que les adresses des théâtres sont parfois précisées ici. Après l’incendie de la première salle, au Louvre et une brève installation dans les murs du Gymnase, le Vaudeville s’est installé pendant une trentaine d’années à la place de la salle des Nouveautés de la rue Vivienne. Mais le prolongement de la rue Réaumur (qui deviendra la rue du Quatre-septembre) oblige à un dernier déménagement sur le boulevard des Capucines, il y a quatre ans.

Démolition du théâtre du Vaudeville pour le prolongement de la rue Réaumur
En même temps que la démolition de l’ancien théâtre, un nouveau était en construction, à l’initiative de la ville de Paris, à l’entrée du boulevard des Capucines (au numéro deux), à l’angle de la rue de la Chaussée d’Antin.
Cette splendide époque jetait les dernier feux du triomphal et bientôt défait second empire et ouvrait ses portes à la prodigieuse troisième République. Les Parisiens vivaient sans le savoir l’apothéose du théâtre. Une génération encore allait en profiter avec délices. Mais un jour d’hiver, à quelques numéros de là sur ce même boulevard, un inventeur Lyonnais projettera des niaiseries sur un écran d’un mètre carré. Ces niaiseries feront tomber un empire. Le théâtre, qui avait 2 000 ans, a mis à peine plus de vingt ans à mourir. Les théâtres ont été rachetés, les uns après les autres par des entreprises de cinéma et avant 1930, le prestigieux Vaudeville a été racheté par Paramount, qui le détruit pour en faire un cinéma, le Paramount Opéra, puis le Gaumont Opéra en 2008, puis de nos jours, le Pathé palace.

L’ancien théâtre du Vaudeville, en 2014
Chronique de Paris du trois février
Grande agitation hier au théâtre du Vaudeville ; il y avait longtemps qu’on parlait de la nouvelle pièce de Monsieur Sardou1, on savait que l’ingénieux dramaturge s’était proposé de mettre en scène l’avocat de nos jours : M. Gambetta, M. Émile Ollivier2 ? — on hésitait et d’ailleurs, disait-on, l’auteur avait hésité lui-même. Donc la curiosité publique paraissait fort éveillée ; la jolie salle de la Chaussée-d’Antin était, comme appareillée de neuf ; elle a si grand besoin, d’un vrai succès, d’une nouvelle Famille Benoiton3 ! Le public est tout à fait de choix ; je n’entends pas seulement les habitués des premières, mais les gens amenés par ce sentiment vague qu’il y aura lutte et qu’on ne pourra plus dès le lendemain entrer, dans un salon sans avoir une opinion faite sur la pièce. Beaucoup de jolies femmes dans cette demi-toilette que comportent les théâtres de genre et qu’une vraie Parisienne sait toujours rendre adorable.

Entrée de Lafont en prince de Monaco : l’excellent artiste, qu’on regrettait si fort et qui eût pu s’aviser de prendre une retraite définitive4 est accueilli par plusieurs salves d’applaudissements. Mademoiselle Hébert5, qui fait la princesse de Monaco est gentille mais d’une grâce un peu maigre ; la pièce ne lui donne, il est vrai, que dix-sept, ans. Mlle Antonine6 en Américaine de Paris ou, si vous voulez, en Parisienne d’Amérique : bien en point, autant de grâce et plus de vivacité brillante que dans Fernande7, toilette fort réussie. Puis, nous sommes sur la terrasse du château avec la mer bleue sous nos pieds et, à notre gauche, les élégants contreforts alpins que franchit la Corniche : décor, charmant et, autant que je puis m’en souvenir, très exact. Seulement le Château n’a pas, que je sache, de terrasse du côté de l’Italie8.
Grenier-Rabagas9 ne paraît qu’au second acte : vêtement complet noir et cravate blanche flottante, longs cheveux noirs et favoris, rien qui rappelle plus particulièrement le masque Ollivier ou le masque Gambetta. Au premier acte, on avait à peu près également tapé sur les hommes d’opposition et sur les conservateurs. On égratignait légèrement et sans parti pris bien violent. Au second acte, les choses se sont un peu gâtées : les applaudissements ont été entremêlés de quelques sifflets.
Le troisième acte se passe dans les salons du prince : Mlle Antonine, toujours charmante, a une fort jolie toilette jaune avec nœuds de ruban rose. Les officiers des gardes rappellent un peu trop, par leur uniforme, les laquais du casino de M. Blanc10. Meubles en tapisserie fort luxueux. Apparition de Rabagas en culotte11 : cette fois, c’est bien M. Émile Ollivier, et la belle Américaine ne peut être que la femme d’un ministre mort, égérie bien connue de l’empire libéral. Nouvelle lutte d’applaudissements et de sifflets.
À l’orchestre, des bruits d’altercation : on m’a dit après qu’un spectateur républicain s’étant écrié : « Mais alors qu’on ramène tout de suite Napoléon III », son voisin bonapartiste a riposté par une ruade aux hommes du 4 septembre. Les trois roulements de tambour12 ont jeté un froid : Ce sont là des souvenirs qui ne font rire personne, heureusement.
Le quatrième acte se noie dans un mélange d’officiers des gardes et de portes de sortie où le public n’a pas vu très clair et est resté très froid. Au cinquième acte, une sorte de récit du 31 octobre13 a paru long et embrouillé. Lafont a dit, comme il sait dire, une scène analogue à celle du dernier acte des Paysans : on l’a beaucoup applaudi. Sur le mot de la fin dit par Rabagas : « Je m’expatrie, je vais dans le seul pays où l’on supporte les gens de mon espèce, en France ! » orage de battements de mains et de sifflets ; le bruit est tel que Lafont peut à peine lancer le nom de l’auteur. Les commentaires et les discussions s’animent, se croisent ; on se bouscule dans les couloirs et dans la rotonde du rez-de-chaussée où des dialogues violents s’établissent.
Les gardiens de la paix commencent à faire circuler, mais en faisant précéder ce décret inoffensif d’un exposé des motifs empreint d’une telle urbanité qu’il est vraiment impossible de résister à une invitation si bienveillante. Sur le trottoir, où l’assistance s’est amassée, le meeting continue de plus belle ; deux spectateurs qui ne sont pas du même avis sur la pièce, en profitent pour se conduire réciproquement au poste ; ils défilent le long du Café Napolitain14 entourés et suivis de badauds.
Pendant toute la durée de la représentation, les curieux assiégeaient la porte du Vaudeville ou stationnaient au café Peters15, et demandaient anxieusement aux privilégiés : « Eh bien ! la pièce est tombée ? » J’ignore le sort réservé à la nouvelle production de M. Sardou, mais je prévois que le public va se diviser aujourd’hui plus encore qu’hier, et demain plus encore que la veille. Qui est-ce qui l’emportera ? — Mon avis et celui de beaucoup de mes voisins, c’est que M. Sardou eût mieux fait de ne pas poser en ce moment une pareille question. Voici du reste un petit mot que je reçois de mon collaborateur Sarcey, et qui sera naturellement développé dimanche prochain16 :
« Le Vaudeville a joué hier le Rabagas de Victorien Sardou. Il sera bien difficile de savoir, avant quelques jours, ce qu’il adviendra d’une pièce, qui est faite pour surexciter aussi vivement les passions politiques. Le premier acte est joli et assez fin de ton ; le second amusant, bien qu’un peu chargé et poussant à la caricature. Çà et là, encore, dans les trois derniers actes, de spirituels détails.
« Le drame a paru long et quelque peu enfantin. Mais l’intérêt n’était pas là. On attendait toujours une explosion de colère : il y a eu en effet des sifflets, timides d’abord, puis furieux.
« Quelques disputes à l’orchestre, et même dit-on, des cartels17 échangés à la sortie, dans la rue, au milieu de la foule, qui était singulièrement houleuse.
« Si nous avons un conseil à donner au public ; c’est d’écouter l’œuvre nouvelle jusqu’au bout, et de n’y voir qu’une pièce de théâtre. S’il s’amuse, voilà qui est bien, et l’auteur aura cause gagnée.
« Mais s’amusera-t-il ?
« Grenier joue avec entrain le rôle de Rabagas. Mais sa verve est un peu grossière. Lafont est très distingué dans le rôle du prince de Monaco. Mlle Antonine, aimable et délicatement spirituelle dans celui d’Eva Blount, l’égérie du prince.
« En somme nous ne pouvons préjuger du succès de Rabagas. L’œuvre a été écoutée par un public très nerveux, très tendu et disposé, les uns à applaudir de parti pris, les autres à siffler sans miséricorde.
« Il est bien difficile de conserver un jugement sain et froid au milieu de ces passions violentes et tumultueuses. »
En somme et en tenant compte des circonstances, on peut dire de cette pièce qu’elle est un déplorable mal à propos.
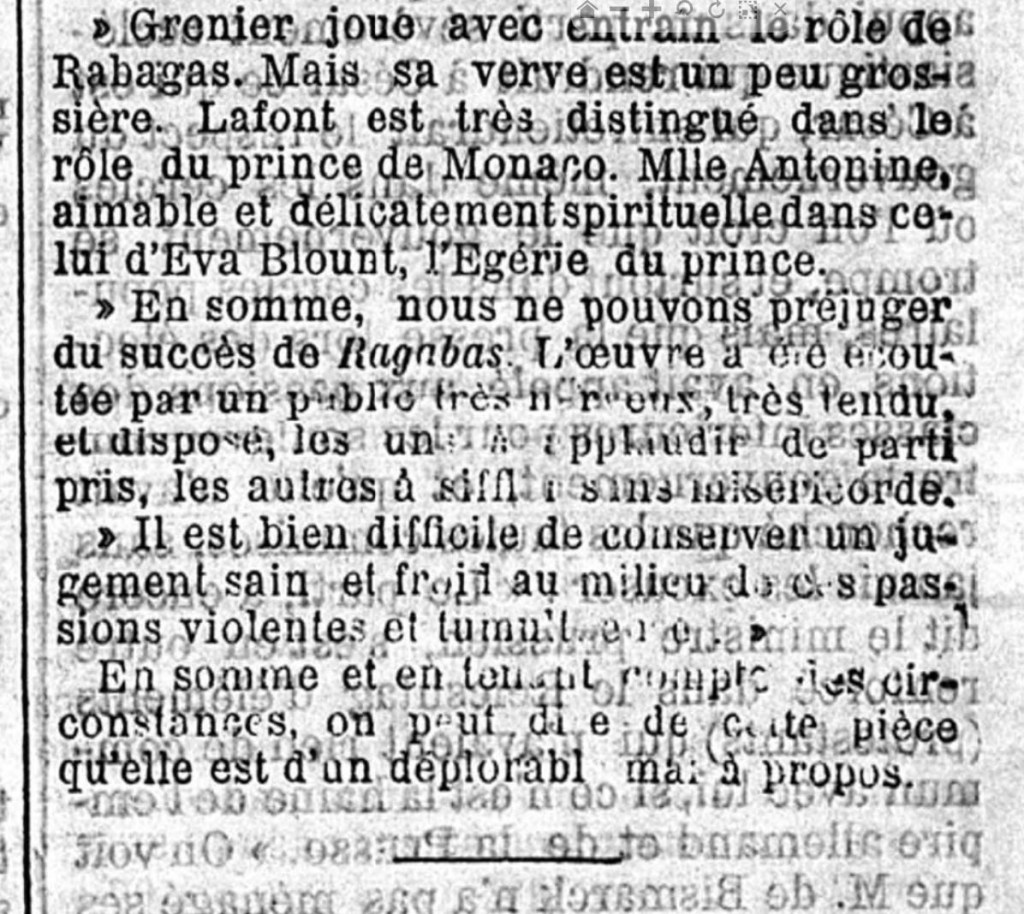
Rabagas, suite
Il paraît que le Rabagas d’hier a été moins orageux que le Rabagas de la première ; encore des sifflets, cependant. L’auteur a fait, dit-on, quelques coupures, entre autres celle des trois roulements de tambour : j’avais déjà signalé l’impression pénible que produisait ce souvenir peu vaudevillesque. Doit-on considérer la pièce comme sauvée par la deuxième représentation ? Il est de règle que le vrai public n’arrive guère qu’à la quatrième. Attendons jusque-là. Quelques personnes ont encore stationné hier à la porte du Vaudeville, mais aucun tumulte ne s’est produit à la sortie.
La suite de la chronique, traitant d’élections en Corse, n’a pas été poursuivie.
Le bal de l’opéra
« Chronique de Paris » parue dans Le Temps du cinq février 1872.
Commençons par une bribe de chronique de l’avant-veille qui traite, bien trop brièvement, du bal de l’opéra.
Le bal de l’Opéra a été très brillant cette nuit : les dominos blancs ou roses commencent décidément à détrôner les dominos noirs ; toujours beaucoup d’étrangers et pas mal d’étrangères venues, j’imagine, par pure curiosité, comme l’empereur du Brésil.
Une nouveauté assez drôle : les basses de l’orchestre se sont avisées de danser un quadrille en agitant leurs instruments comme des manches de pierrot. M. Strauss18 riait comme un fou, et l’assistance applaudissait comme à une première qui a réussi.
Le Vaudeville ne joue pas ce soir Rabagas : tant pis ; le vrai public aurait été consulté pour la première fois et on eut pu tirer de cette soirée quelques pronostics touchant la destinée de la pièce.
La suite de cette chronique traite d’un sonnet corse, d’un militaire et de la vente de la collection d’Étienne Arago (1802-1892), qui ne mourra que dans vingt ans. Il doit manquer d’argent et on le plaint beaucoup mais on a préféré passer à la chronique du surlendemain, sept février :
Deux dictionnaires académiques
« Chronique de Paris » parue dans Le Temps du sept février 1872.
Vous souvenez-vous de la visite que fit récemment l’empereur du Brésil au Dictionnaire historique et au Dictionnaire de l’usage, ces deux plantes bien frêles encore qu’on arrose goutte à goutte dans les jardins d’Académus ? M. Cuvillier Fleury19 nous disait avec quelle incessante ardeur il se livrait avec ses collègues à cette horticulture sacrée. Le Dictionnaire historique avait déjà poussé son premier fascicule en 1863, année de la présentation et de l’échec de M. Littré à l’Académie française20 : M. Cuvillier-Fleury nous a révélé qu’au bout de huit ans de siège on était enfin parvenu aux approches ; c’est là que Don Pedro II est venu à point pour donner son coup d’épaule. La troupe savante qui garde la tête du pont des Arts21 va-t-elle emporter enfin le second fascicule ? Oui, si elle se décide à investir officiellement son nouvel allié, M. Littré, de la direction des travaux.
Quant à l’œuvre même de M. Littré, tout le monde sait qu’elle touche à son couronnement : il a employé les huit années d’interdit que l’Académie s’est infligées en lui fermant ses portes, à parfaire un édifice irréprochable et complet22 ; après ça, les immortels ont peut-être réfléchi qu’en recevant plutôt M. Littré, ils eussent absorbé, dissous, supprimé cette vigueur solitaire et puissante et qu’il valait mieux en recueillir les fruits.
Que n’eût pas produit pourtant cette association d’un travailleur éclairé et robuste avec une compagnie qui a su parfois tenir le sceptre du goût ?
M. Sainte-Beuve s’en préoccupait dans l’un des trois Lundis qu’il consacra à M. Littré, après la réception de M. de Carné23 : car l’illustre critique, qui apportait dans les luttes de la libre-pensée toute la vaillance de Voltaire, n’en conservait pas moins la mesure, la justice et le goût. Il voyait, il sentait ce que les deux dictionnaires rivaux pourraient gagner à se fondre, et s’il affirmait nettement M. Littré, il ne niait pas radicalement l’Académie.
Oh ! si je ne me retenais, disait-il, qu’il y aurait une jolie comparaison à faire de M. Patin24, le rédacteur du Dictionnaire de l’Académie, et de M. Littré ; une opposition de leurs deux esprits, de leurs qualités et de leur trempe ! Ne voyez-vous pas d’ici le parallèle et l’antithèse ? M. Patin, homme de goût, avec toutes les délicatesses, mais avec toutes les mollesses aussi et les faiblesses ou les négligences que ce mot comporte ou suppose ; M. Littré, homme de science, de méthode, de comparaison, de raison, de vigueur et même de rigueur ; le premier d’un tempérament doux, de bonne heure pétri de la pulpe de l’antiquité ; le second nourri du pain des forts en tout genre, du suc généreux des doctrines, tout ressort et tout nerf. J’avais fait un beau rêve, moi et quelques amis. Au lieu d’opposer l’un à l’autre, au lieu d’instituer entre les auteurs ou les œuvres un parallèle et un contraste désormais inévitable, et dont le public sera un juge peu indulgent, j’aurais voulu réunir et fondre, combiner les avantages sans les défauts. Les Dictionnaires étant réellement différents et le grand Dictionnaire historique de l’Académie commençant à peine, je m’étais dit, et plusieurs autres avec moi, que l’Académie et M. Littré pouvaient très bien, et sans aucunement s’entraver, se rendre utiles et profitables l’un à l’autre. Ce qui domine en effet à l’Académie et qu’on appelle du nom flottant de goût, ce qui se produit parfois et jaillit à l’improviste dans les conversations d’un hasard et d’un laisser-aller aimable, pouvait ne pas être inutile à l’esprit sévère, mais un peu absolu, de M. Littré. Et surtout l’esprit d’un nouveau confrère, rigoureux, exact, et plus savant (sans mentir), plus sûr de son fait en ces matières que nous le sommes généralement, eût pu nous être d’un usage et d’un recours journalier. Hélas ! il était écrit que ce ne serait là qu’un rêve, et que jamais aucun auteur — j’entends un auteur sérieux de Dictionnaire ne ferait partie de l’Académie française. »
Grâce au bon sens tardif, mais louable, de l’Académie, le rêve de M. Sainte-Beuve est enfin réalisé. II est vrai que M. Littré est déjà arrivé, tandis que l’Académie est à peine partie ; mais M. Littré est homme à faire deux fois le chemin.
La suite de la chronique traite de la vente Anastasi, qui n’est qu’un catalogue de prix de peintures.
Le Carnaval
« Chronique de Paris » parue dans Le Temps du seize février 1872.
Que dites-vous de ce carnaval ? Pour ma part j’en ai été fort satisfait : que d’autres regrettent la promenade du bœuf gras, cette cérémonie officielle dont la Compagnie des pompes funèbres eût pu revendiquer le caractère ; lorsque la malechance25 ou une fantaisie idiote m’ont par hasard conduit sur le boulevard à l’heure du passage du char traditionnel, je n’y ai jamais gagné que la satisfaction d’être figé pendant une demi-journée sur un point donné de l’asphalte, avec défense d’accomplir aucun mouvement dans aucun sens : je ne compte pas les enfants qu’on avait dans les jambes, et que des mères furieuses d’épouvante vous accusaient de fouler systématiquement aux pieds ; je ne parle pas non plus des joueurs de coudes qui vous envoyaient des coups d’aviron dans les côtes en prétendant qu’ils suivaient le mouvement.
Au lieu de ce travail d’attaque et de défense des places, nous avons eu trois journées charmantes, celle du mardi surtout. Tout Paris dehors, en famille ; les boulevards bondés, le bois de Boulogne envahi. Beaucoup de jolies toilettes, un peu lourdes peut-être, trop de drap et trop de velours ; mais le tour de main parisien fait tout passer.
Et l’orage d’hier soir, d’où peut-il bien sortir ? Songez donc, la foudre au mois de février, tout comme au mois de juin, c’est peut-être plus rare encore qu’une aurore boréale. Décidément quelque événement désagréable se prépare ; il ne nous manque plus qu’une pluie de crapauds pour arranger nos affaires.
M. Alphand26 reste seul impassible au milieu de ces mouvements atmosphériques : il n’en donne ni un coup de balai ni un pan d’asphalte de plus. Dans une des dernières séances du conseil municipal on lui a parlé de chaussées qui étaient en mauvais état. Il a répondu qu’il fallait attendre pour les réparer que les chances de gelée eussent disparu, c’est-à-dire que M. Alphand ; se croisera les bras jusqu’à la fin de mai, car il tiendra compte aussi, soyez en sûrs, des gelées tardives. Hier soir la chaussée d’asphalte qui réunit le passage Jouffroy au passage des Panoramas27 était défoncée en plusieurs points et ne figurait plus qu’une collection, de flaques d’eau. J’engage bien vivement notre excellent préfet à avoir l’œil à tout cela, qui en vaut la peine. Nous allons commencer cette année, au moyen d’impôts assez lourds, la liquidation de l’empire ; la population ne peut pas ignorer à qui nous devons ce surcroît de charges : il y a pourtant des gens qui chercheront à lui faire entendre que c’est la République qui en est cause. S’ils peuvent dire par-dessus le marché que, payant davantage, nous serons pourtant moins balayés, moins asphaltés, moins gardés qu’autrefois, qui donc profitera de ces insinuations en apparence légitimes ? Il n’y a pas de petites choses ; et d’ailleurs quand on a, comme les habitants de Paris, un budget énorme, au moins faut-il que les quelques dépenses qui se voient et se touchent, qui sont pour ainsi dire le témoignage extérieur des impôts que nous payons, soient régulièrement et largement faites.
La suite de cette chronique aborde une question religieuse, qu’il n’a pas paru nécessaire de reproduire.
L’Institution du mariage
« Chronique de Paris » parue dans Le Temps du vingt février 1878.
Vous savez que la princesse de Beauffremont28 a enfin réussi, après des efforts extraordinaires, à ne pas se démarier29. Il est certain qu’en notre beau pays de France, il est plus facile de prendre un mari que de le laisser. En Suisse, c’est ou du moins c’était il y a peu de temps encore tout le contraire. On n’a pas idée des travaux qu’on était tenu d’accomplir pour franchir le seuil de ce palais enchanté ; dans certains cantons, il fallait avoir une certaine religion, de certains revenus et une certaine moralité pour contracter mariage si l’on manifestait l’intention d’élire domicile dans un nouveau canton, il fallait payer une taxe d’admission comme dans les cercles. Il n’y a pas très longtemps, un citoyen du canton d’Uri, marié en France avec une Française, manifesta la prétention fort légitime de faire reconnaître cette union par les magistrats de sa commune. Ceux-ci ne demandaient pas mieux, mais ils exigeaient le dépôt d’un cautionnement s’élevant à 573 fr. 19 c. Notre Urinois poussa des cris de paon et refusa de se soumettre à cette réglementation gothique. Si la révision de la Constitution n’était pas survenue sur ces entrefaites, cet enfant de l’Helvétie serait encore considéré, faute de ces 573 fr. 19 c, comme vivant en concubinage avec sa moitié, et ses enfants seraient réputés enfants naturels.
Ces traditions féodales, hier encore vivantes et agissantes chez nos excellents voisins malgré leur état républicain, sont bien et dûment enterrées dans notre pays malgré le virus monarchique dont on l’accuse de n’avoir pu se défaire. Il faut remonter jusqu’à 89 pour retrouver des coutumes analogues ; seulement on aurait tort de croire qu’elles fussent tombées en désuétude bien avant la réunion de la Constituante. L’immortel coup de pioche de cette grande assemblée frappa des abus séculaires, il est vrai, mais solidement enracinés et fort bien portants. J’ai entre les mains un traité des Droits Seigneuriaux, publié à Toulouse en 1775 ; il y est question du droit de Formariage, ainsi défini : un droit que l’homme serf paye à son seigneur lorsque ; sans sa permission, il épouse une femme d’une autre condition, d’une autre juridiction, ou d’une autre servitude que la sienne. En cas de contravention, l’amende pouvait être de la moitié des biens meubles ou immeubles possédés par le serf dans l’étendue de la seigneurie. Voilà qui ne s’éloigne pas beaucoup des coutumes du canton d’Uri.
Le chanoine joueur
« Chronique de Paris » parue dans Le Temps du 22 février 1872.
Je viens de découvrir dans les journaux allemands une véritable perle. Vous n’êtes pas sans avoir ouï parler de l’archevêque de Posen30, comte Ledochowlski31 ; ce prélat avait auprès de lui, à titre d’éminence grise, un membre de l’ordre des Jésuites, le chanoine Kozmian, qui était l’âme de l’ultramontanisme dans la province. Or, il vient d’être soudainement relevé de ses fonctions de conseiller ecclésiastique et voici les motifs qu’on donne de cette décision.
Le chanoine Kozmian avait été expédié, il y a quelque temps, à Rome par son archevêque pour déposer aux pieds du pape une somme assez considérable destinée au denier de saint Pierre. Malheureusement le pieux émissaire s’étant arrêté à Francfort, eut l’idée de faire une pointe sur Hombourg32, sans doute pour respirer les effluves salutaires du Taunus33 et boire de l’eau de la fontaine Elisabeth34. Après avoir visité le parc, il était naturel d’aller se reposer un instant dans les salons du Kursaal35.
L’occasion, l’herbe tendre,
Et le diable aussi le poussant36,
notre chanoine crut pouvoir tondre de ce pré la largeur de sa langue. Il mit quelques thalers sur la table de la roulette c’était d’ailleurs pour le bon motif. N’avait-il pas la chance de gagner quelques numéros pleins et d’arrondir, sans trop de peine, le magot pontifical ? S’il pouvait seulement la doubler, quelle gloire !
Dieu prodigue ses biens
À ceux qui font vœu d’être siens37.
Les choses tournèrent bien d’abord ; le ponte romain semblait deviner les numéros ; les croupiers, à l’œil terne, couvraient mélancoliquement sa mise de thalers. L’heureux Kosmian se voyait déjà chargé de dépouilles opimes38 qu’il apportait triomphalement au Vatican. Mais voilà qu’il perd un coup, puis un autre ; il double sa mise, il perd encore ; il veut se raidir contre ce caprice de la fortune, il charge cinq numéros d’une poignée de thalers : aucun ne sort. Cela ne peut pourtant pas durer : le chanoine renonce aux thalers, il met des Frédérics d’or. La déveine persiste : tout le bénéfice avait déjà fui, et le capital commençait à se disperser. Furieux contre les numéros, le conseiller de l’archevêque de Posen adopte la rouge : il gagne ; il fait partie et ajoute une masse, il gagne encore : il expose le tout, il perd. Oh alors, il passe à noire, décidé à s’y tenir quand même ; mais une série de rouges se lève, le chanoine veut lutter, il se jette dans une martingale à fond de train, au bout de laquelle il ne lui restait plus un Kreutzer.
Le chef de partie, qui assistait impassible à ce drame, hélas ! trop commun, eut l’attention de faire prévenir officieusement cet ecclésiastique décavé que la caisse tenait à sa disposition la somme nécessaire pour rentrer dans ses foyers : le chanoine, honteux et confus, mais n’apercevant aucune autre solution, accepta ce secours de route, en jurant, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus.
Eh bien ! je vous avoue qu’en apprenant les détails de cette odyssée mélancolique, j’ai été surpris que l’archevêque de Posen ait montré tant de rigueur. Il ne faut jamais dire, monseigneur ; Roulette, je ne boirai pas de ton 0.
Notes
1 Tout a très mal commencé pour Victorien Sardou (1831-1908), qui a dû interrompre des études de médecine qu’il ne pouvait financer et a survécu en donnant des cours particuliers. Ses premières pièces n’ont pas eu un meilleur sort, les directeurs de théâtre, changeaient ou mouraient juste avant les premières représentations. Une de ses premières pièces a même été affichée par erreur sous le nom d’un autre. C’est alors que tout fortuitement il fait la connaissance de Virginie Dézajet (1798-1875), qui lui offre un théâtre, 41 boulevard du Temple, qui existe encore aujourd’hui. Après une pièce interdite par la censure, dernier épisode de malchance, toutes les pièces de Victorien Sardou connaîtront le succès. Voir aussi La Vie à Paris du 24 février 1880.
2 Émile Ollivier (1825-1913), avocat en 1847 mais nommé l’année suivante (piston) préfet de la IIe république. Il est âgé de 23 ans et, prudemment, continue de s’installer comme avocat. Brillant orateur, cela lui réussit. En 1857, ce natif de Marseille est élu député de Paris. En janvier 1869, Émile Ollivier est nommé président du Conseil et ministre de la Justice, ce qui ne pouvait pas durer. Une situation bien plus pérenne provient de son élection à l’Académie française en avril 1870 — il était temps — au fauteuil d’Alphonse de Lamartine.
3 Victorien Sardou, La Famille Benoiton, comédie en cinq actes créée au théâtre du Vaudeville du boulevard des Capucines en novembre 1865. Le texte de cette pièce, qui a reçu un grand succès, est paru chez Calmann-Lévy peu de temps après.
4 Que Jules Claretie ne s’impatiente pas, Pierre-Chéri Lafont (1797-1873), comédien fort apprécié, mourra dans à peine plus d’un an le 18 avril. Ce rôle du prince de Monaco n’est d’ailleurs pas encore son dernier.

Pierre Lafont au théâtre du Gymnase, fin 1863, par Léon Crémière « photographe de la maison de l’empereur ».
5

Portrait de cette comédienne dont même le prénom semble oublié, qualifiée seulement de « Hebert, (actrice au théâtre du Vaudeville) » par le musée Carnavalet, d’où provient cette photographie par l’Allemand Charles Reutlinger, spécialisé dans les comédiennes, installé 21 boulevard Montmartre
6 Antonine Pélissié (Marie-Henriette Mayliand, 1841-1925) a débuté à 18 ans au théâtre du Gymnase. Il ne semble pas qu’Antonine ait été choisie pour son accent anglais puisque, selon le Dictionnaire des comédiens d’Henry Lyonnet, « Son accent très parisien le “grasseyement particulier aux indigènes de la capitale” a fait sa renommée.

Notice d’Antonine dans le Dictionnaire des comédiens d’Henry Lyonnet, lequel note trois comédienne sous ce nom.
7 Fernande, comédie en quatre actes créée au théâtre du Gymnase le huit mars 1870.
8 C’est même tout le château qui est orienté à l’ouest.
9 Jules Claretie indique ici que le rôle de Rabagas est tenu par Pierre-Eugène Grenier (1833-1875), mort à 42 ans.
10 François Blanc (1806-1877), fondateur de la société des Bains de mer de Monte-Carlo où il a bâti le casino, ouvert en février 1863 mais dont la construction ne s’est achevée qu’en 1866. Ce casino va être démoli et reconstruit en 1879 par Charles Garnier.
11 Le pantalon court, qui était en usage à l’époque à la cour de Monaco.
12 Ces trois roulements de tambour étaient le prélude aux sommations de la police, puis à l’ouverture du feu.
13 En octobre 1870, 100 000 soldats français sont encerclés dans Metz. Le 27, Bazaine capitule, ce qui libère les soldats prussiens et les rend disponibles pour continuer leur avancée vers Paris. La nouvelle est parvenue à Paris le 30 octobre au soir, ce qui provoque des émeutes dans la plus grande confusion.
14 Le Napolitain se trouvait juste en face, au numéro un du boulevard des Capucines. C’est aujourd’hui et depuis longtemps un restaurant(?) Hippopotamus.
15 Ce café Peters se trouvait à l’emplacement de ce qui est de nos jours le passage des Princes, au carrefour Richelieu-Drouot, assez loin du Vaudeville.
16 « Dimanche prochain », c’est-à-dire dans Le Temps daté de lundi où Francisque Sarcey traitera de Lise Tavernier d’Alphonse Daudet. Il attaquera Rabagas et son auteur à partir de la quatrième colonne de une, dans les deux tiers de sa chronique.
17 Cartes de visites, en vue d’un duel.
18 Isaac Strauss (Emmanuel Israël, 1806-1888), violoniste était responsable des bals de la cour à la fin de règne de Louis-Philippe. Il assurera des fonctions comparables sous Napoléon III, organisant des bals dans les différentes villes d’eaux visitées par le couple impérial et sa suite. En 1854 Isaac Strauss obtient la concession des bals de l’Opéra, en assurant tous les frais et bénéfices jusqu’à cette année 1872, à l’âge de 66 ans. Voir aussi la page « Mademoiselle Aïssé »
19 Alfred Cuvillier-Fleury (1802-1887), journaliste et critique littéraire élu à l’Académie française en 1866.
20 Émile Littré (1801-1881) a fini par être élu en décembre dernier (1871). Lors de sa précédente candidature, en avril 1863, Félix Dupanloup (1802-1878), évêque d’Orléans s’était farouchement opposé au païen Émile Littré, qui a néanmoins été élu huit ans plus tard, à la grande colère de Dupanloup.
21 L’institut est en effet dans l’axe de ce que l’on nomme de nos jours la passerelle des arts qui la relie à la cour carrée du Louvre.
22 Le Dictionnaire d’Émile Littré est daté de 1863-1873. La Préface d’Émile Littré à son dictionnaire est datée de juin 1877. Le Complément de la préface ou Coup d’œil sur l’histoire de la langue française, daté du premier mars 1880, indique, en fin de texte et dans une « note supplémentaire : « Le commencement de la copie fut remis à l’imprimerie le 27 septembre 1859 ; la fin, le 4 juillet 1872 ». D’autres détails techniques ou dates suivent.
23 Louis de Carné (1804-1876), soutenu par le parti religieux, a été préféré à Émile Littré en avril 1863. Voir la page « La dent du Chevalier de Trézurin ».
24 Henri Patin (1793-1876), normalien docteur ès lettres, agrégé de grammaire, maître de conférences à l’École normale à 22 ans, professeur d’éloquence puis de poésie latine à la Faculté des Lettres dont il devint le doyen, a été élu à l’Académie française en 1842, dont il est devenu Secrétaire perpétuel en juin dernier.
25 Plusieurs occurrences de cette graphie ont été observées chez Jules Claretie. Il semble que cet usage se soit maintenu pendant les premières années du siècle suivant.
26 Adolphe Alphand (1817-1891), ingénieur des Ponts et chaussées, directeur des Travaux de la ville de Paris et créateur de nombreux espaces verts. Du côté de la porte Maillot une petite avenue porte son nom.
27 La « chaussée d’asphalte » en question est le boulevard Montmartre, qui sépare, d’avantage qu’il réunit, le passage des Panoramas du passage Jouffroy,
28 Valentine de Riquet de Caraman-Chimay (1839-1914), a épousé en 1861 Paul de Bauffremont (1827-1893).
29 En 1876 est paru chez Marescq, éditeur de droit, un opuscule de dix pages intitulé sobrement « Un mot sur le cas de Mme la princesse de Bauffremont aujourd’hui princesse Bibesco — de la naturalisation en pays étranger des femmes séparées de corps en France — par Daniel de Folleville avocat à la Cour d’Appel de Douai et professeur de code civil à la faculté de droit ». « Le cas de Mme la princesse de Bauffremont, aujourd’hui naturalisée en Allemagne, sans aucune autorisation soit de son mari, soit de la justice, et remariée, par application du statut national allemand, avec M. le prince Georges Bibesco, donne lieu en ce moment même à d’importants débats judiciaires dont le retentissement s’étend jusques dans la presse. » Lire la suite, où il ressort, entre autres, que « La femme séparée de corps peut s’expatrier sans le consentement de son mari. »
30 Pozna ?, de nos jours en Pologne mais à l’époque sous domination allemande.
31 Mieczysław Halka-Ledóchowski (1822-1902), sera créé cardinal en mars 1875.
32 Proche de la frontière française, non loin de Sarrebruck.
33 Chaîne montagneuse de la région.
34 Élisabeth de Hongrie (ou de Thuringe, 1207-1231).
35 Essentiellement germaniques, ces lieux comprennent généralement une salle de bal, une salle de concerts et de théâtre, une salle de jeu et plusieurs restaurants.
36 « L’Âne vint à son tour, et dit : “J’ai souvenance / Qu’en un pré de moines passant, / La faim, l’occasion, l’herbe tendre, et je pense / Quelque diable aussi me poussant, / Je tondis de ce pré la largeur de ma langue. / Je n’en avais nul droit, puisqu’il faut parler net.” » Jean de La Fontaine, Les Animaux malades de la peste.
37 « Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. / Il fit tant de pieds et de dents / Qu’en peu de jours il eut au fond de l’ermitage / Le vivre et le couvert : que faut-il davantage ? / Il devint gros et gras : Dieu prodigue ses biens / À ceux qui font vœu d’être siens. » Jean de La Fontaine, Le Rat qui s’est retiré du monde.
38 Opime : Riche, opulent, admirable. Les dépouilles opimes sont remportées par le général romain ayant tué de sa main un général de l’armée ennemie. « Qui t’eût dit alors, à ce faîte sublime, / Tandis que tu rêvais sur le trophée opime / Un avenir si beau… » Victor Hugo, Les Chants du crépuscule / À la colonne.
.
