Chronique parue dans Le Temps du dix mars 1880, annoncée dans La Vie à Paris de la veille.
Page publiée le quatorze octobre 2024. Temps de lecture : un quart d’heure.
Parallèlement à La Vie à Paris, Jules Claretie écrivait dans Le Temps une autre série d’articles sous le titre général Chronique1. Ces articles n’étaient jamais signés. C’est le cas de ce texte à la mémoire du directeur du théâtre du Gymnase. Pourquoi cet article a été inséré dans l’édition Havard de La Vie à Paris et pas les autres, nous ne le saurons jamais. Une édition en volume de toutes les Chroniques de Jules Claretie reste à établir. Le huit avril 1880 paraîtra dans l’édition Havard une autre chronique, réservée à la comédienne meurtrière Marie Bière dont la France entière a parlé.
Les intertitres proviennent de l’édition Havard.
M. Montigny — Son passé : Amazampo ou la découverte du quinquina — Le directeur — Les origines de Je dîne chez ma mère — Un Beau Mariage : M Montigny et M. Augier — Notes
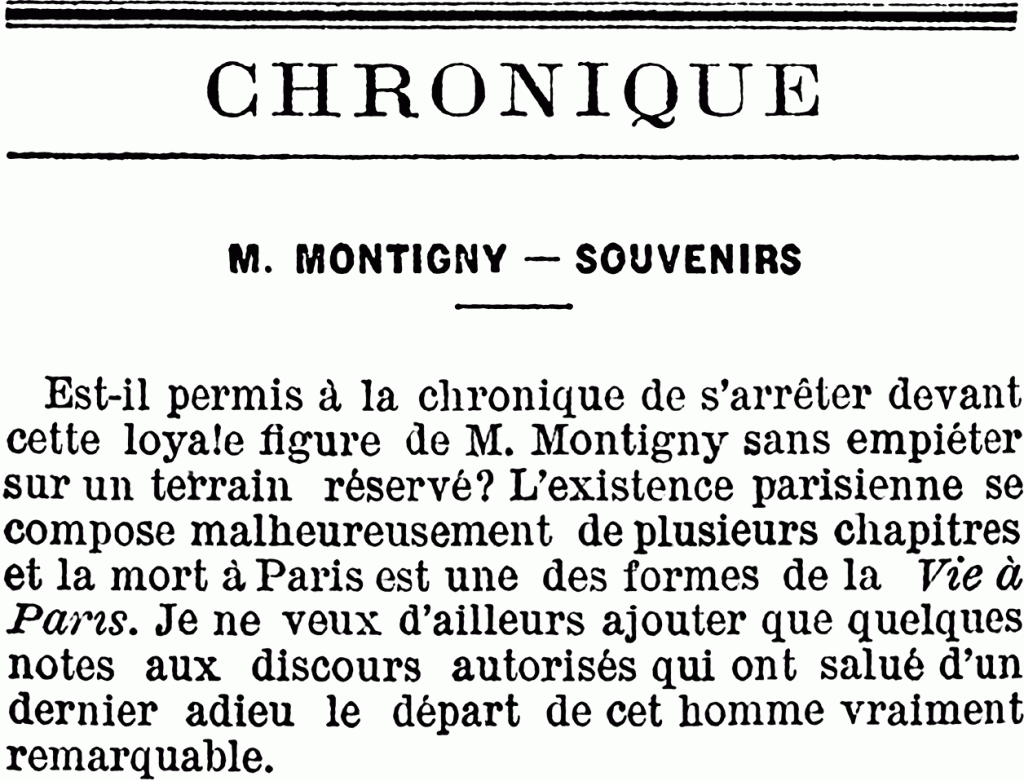
Cet article du Temps ne porte pas le titre de La Vie à Paris
Est-il permis à la chronique de s’arrêter devant cette loyale figure de M. Montigny2 sans empiéter sur un terrain réservé3 ? L’existence parisienne se compose malheureusement de plusieurs chapitres et la mort à Paris est une des formes de la Vie à Paris. Je ne veux d’ailleurs ajouter que quelques notes aux discours autorisés qui ont salué d’un dernier adieu le départ de cet homme vraiment remarquable4.
Depuis que nous l’avions vu, debout, ferme encore, mais prêt à s’écrouler sous la douleur, dans cette église de Passy5 où, appuyé sur son digne fils vivant, il conduisait le deuil de son fils mort6, M. Montigny était perdu. La douleur l’avait terrassé. Il ne s’était acharné à la vie et à la lutte que par devoir et aussi par amour pour cette vieille maison du boulevard Bonne-Nouvelle, qu’il avait comme fondée, qu’il avait du moins renouvelée, rajeunie, fortifiée7 !
Et puis il aimait le théâtre, la poudre des batailles, le salpêtre des premières, le bruit des bravos, la houle des résistances, tout ce qui est la vie de cet art surchauffé. Il avait été acteur, il avait été auteur. Le théâtre et « son théâtre », c’était un prétexte pour vivre.
Oui, il avait jadis écrit des vaudevilles, des drames, et lorsqu’il refusait une pièce à quelqu’un, — ce qu’il ne faisait qu’en toute connaissance de cause, — les mécontents se demandaient et faisaient parfois demander à quelque malicieux article de journal si l’auteur d’Amazampo ou de la Découverte du Quinquina8 était bien venu à se montrer si sévère ?
Antazampo ! la Découverte du Quinquina ! c’était bien vraiment le titre authentique de certain drame représenté le mardi 21 juin 1836 sur le théâtre de l’Ambigu-Comique9, et où Montigny lui-même avait rempli le rôle de don Gomès, vice-roi du Pérou, le principal rôle, à côté d’Albert de Guyon10 et de Saint-Ernest11 ! Et sous ce titre bizarre, quelque peu démodé aujourd’hui, se cachait un mélodrame fort bien fait, solidement bâti, que M. Lemoine-Montigny avait écrit en collaboration avec H. Meyer12.
Son passé : Amazampo ou la découverte du quinquina
M. Montigny laisse d’autres ouvrages, Zarah13, Samuel le marchand14, Le Doigt de Dieu15, un drame intime tout à fait mâle intitulé Un Fils et précédé de l’Auberge des Trois-Oliviers, prologue16 ; — mais c’est Amazampo qui constituait pour la critique ; — et pour les satiriques — son principal titre à l’attention. Ce drame, en son temps, avait donné lieu à une singularité notable le soir de la première représentation. Le directeur de l’Ambigu avait fait distribuer aux spectateurs une notice explicative sur le quinquina et ses propriétés médicinales.
Quant à la pièce, j’en trouve l’analyse toute faite dans un recueil du temps, le Monde dramatique17, fondé par Gérard de Nerval, et où, je crois bien, Alphonse Karr faisait, comme on dit, les théâtres18. Cette curiosité vaut la peine d’être reproduite :
La scène se passe en 1636 ; à cette époque, le Pérou est gouverné par le vice-roi, don Gomès de Cabrera del Chinehon ; Philippe IV règne en Espagne, Louis XIII en France. Amazampo, chef d’une tribu péruvienne, aime Maïda, qui ne l’aime point parce qu’elle aime Fernand l’Espagnol, Fernand le fils du vice-roi. Cette passion malheureuse et très peu sauvage d’Amazampo lui donne la fièvre19 et le pousse au désespoir. C’est alors qu’ayant bu, dans l’intention de s’empoisonner, de l’eau d’une mare dans laquelle étaient des troncs de l’arbre appelé kina et réputé vénéneux, Amazampo se sent guéri comme par enchantement, non de son amour, mais de sa douleur physique. Dès ce moment, les propriétés fébrifuges du quinquina sont découvertes.
Amazampo profite de sa bonne santé pour oublier Maïda et se venger de ses oppresseurs ; le meilleur moyen pour satisfaire son cœur cruellement ulcéré est de laisser mourir les Espagnols un à un de cette terrible fièvre qui était en Amérique un mal presque sans remède. Le plan d’Amazampo réussit à merveille : les Espagnols succombent tandis que les Indiens résistent ; Lima est un vaste cimetière dont le sauvage s’est fait le pourvoyeur, puisqu’il a juré et fait jurer au siens, sur l’autel du Soleil, de ne jamais divulguer le précieux remède. Cependant, la vice-reine va mourir de la fièvre ; Maïda se sent émue pour la mère de son amant, mais on ne lui donne pas le temps de sauver la malade, et c’est Amazampo lui-même qui, par un très beau dévouement et le poignard sur la gorge de dona Théodora, l’oblige à boire la liqueur salutaire. Cette intrépidité scénique a été couverte d’applaudissements, ainsi que la scène où Amazampo, traîtreusement emprisonné, apprend que celle dont il a la grâce dans la main est en ce moment conduite au bûcher. Ces deux situations sont énergiquement écrites et d’un beau caractère. Le reste à l’avenant comme l’action, car Amazampo sauve Maïda et expire d’un coup de poignard que lui a mérité sa trahison.
Sous ce compte rendu un peu narquois, à la mode en 1836 — c’est-à-dire à la Janin20 — on peut reconstruire le drame de Montigny. Écrit d’un style légèrement majestueux, dans l’école d’Atala et des Martyrs21. Il est vraiment émouvant, patriotique et agencé par un homme de théâtre. En le lisant, on y trouve des tirades du goût de celle-ci :
AMAZAMPO
Il y a un mois22, à la suite d’un chagrin cruel dont le motif ne fut un secret pour aucun de nos compagnons, je fus atteint de la maladie qui fait en ce moment tant de victimes chez nos ennemis ; le cœur souffrait en même temps que le corps ; mon état fut bientôt désespéré ; en quelques jours la fièvre m’avait tué… J’allais mourir !
MAÏDA, à part
Que dit-il ?
AMAZAMPO
Le troisième jour, j’étais seul, étendu sur ma natte, brûlant, haletant, en proie au plus affreux délire. Je ne peux savoir ce qui se passa, mais je sentis tout à coup une grande fraîcheur par tout le corps. La raison me revint. Je me sentis plongé dans les eaux du lac Oxicaya, précisément au pied d’un de ces arbres dont le lac est bordé, et que toujours nous avons nommés arbres de la mort parce que leur écorce distille une liqueur que nos pères appelaient un poison mortel…
OUTOUGAMYZ
Eh bien ?
AMAZAMPO
Eh bien ! mon père, cet arbre, c’est l’arbre de la santé ; cette liqueur mortelle, c’est la vie ! car cette eau dans laquelle il trempait ses racines et laissait tomber ses fruits, cette eau dont je m’étais dans mon délire abreuvé largement23, cette eau où vous aviez dit que je buvais 1a mort, il me sembla qu’elle me rendait tout d’un coup la force et la vie. Le lendemain, j’osais presser sur mes lèvres cette écorce que j’avais si longtemps regardée comme un poison, et quelques heures après je sentais le feu de la fièvre qui abandonnait mes membres rafraîchis. Que vous dirai-je enfin ? Grâce à cette liqueur bienfaisante, je recouvrai la santé. Ataliba, qui est ici, avec moi, et que j’aime comme un père, Ataliba fut frappé de la maladie, et comme j’avais été sauvé, je le sauvai aussi.
MAÏDA, à part
Mon père !
AMAZAMPO
Je sauvai de même plusieurs de nos frères… mais toujours sans leur rien apprendre de mon secret… car ce secret, que le hasard m’avait fait connaître, c’est seulement devant vous, ô Inca, à la face de notre Dieu, devant le feu de l’autel, que je m’étais promis de le révéler !
Aujourd’hui, avec notre humeur railleuse, je ne sais trop si l’on accepterait cet Outougamyz, vieillard centenaire, dernier rejeton des Incas, — des Incas de Marmontel24, — dont Montigny avait emprunté le nom aux Natchez25 de Chateaubriand ; peut-être ces Péruviens et ces Espagnols, cet Ataliba, chef de sauvages et ce don Fernand paraîtraient-ils un peu ridés quoiqu’ils ne soient pas plus improbables, à coup sûr, que les sauvages et les Portugais de l’Africaine26. Mais, toujours est-i1 que lorsque l’Ambigu donna ce drame, le succès en fut complet. On rappela par deux fois Montigny, et comme acteur et comme auteur, et en l’acclamant à la chute du rideau on lui fit un triomphe double.
Le Directeur
M. Montigny semblait avoir oublié ses succès d’auteur. Il n’en disait jamais un mot. Il se contentait de mettre son expérience et son autorité au service des autres. Il était vraiment le type idéal du directeur de théâtre, non pas un collaborateur, mais un conseiller, un accoucheur d’idées. Le goût très sûr, l’oreille très délicate, le tact très fin, il excellait non seulement dans la mise en scène — qui est un grand art — mais dans cette guerre aux mots, aux mots dangereux, qui est fort utile au théâtre. Il ne laissait rien passer, pas un loup27, comme on dit en argot de coulisse. Ami intime de M. Désiré Nisard28, il était classique en littérature, si cette épithète a un sens aujourd’hui. Ôtons classique, mettons puriste. Il savait exactement jusqu’à quelle hardiesse on pouvait aller sur son théâtre.
Trois hommes, en ce temps-ci, d’une destinée bien différente, mais d’une carrure, d’une robustesse et d’un tempérament analogues, ont eu à un degré extraordinaire le sens de leur maison, de leur création, de leur chose : Buloz29, Villemessant, Montigny.
Sous l’apparence un peu brusque de Montigny, il y avait une tendresse, une délicatesse rare. Ce colosse rudement taillé gardait pour ceux qu’il aimait des attentions de femme. Alexandre Dumas fils avait déjà payé sa dette à Montigny, dans une de ses Préfaces. Montigny l’adorait. C’était lui qui l’avait non pas révélé mais vu grandir. Dumas, Sardou, Meilhac, Gondinet30, avaient passé, à leurs débuts, par ce petit cabinet directorial du Gymnase, large comme un mouchoir de poche et qui a tenu tant de place dans l’histoire du théâtre depuis trente ans.
Il fallait voir M. Montigny à l’avant-scène ! L’avant-scène31, c’est le poste de combat du directeur. Assis dans un fauteuil légendaire, il écoutait, refrogné, et de sa voix forte donnait un avis, dictait un ordre. Avec quel art il savait fondre, comme les plans mêmes d’un tableau, les épisodes divers d’une pièce !
Il disait à un comédien :
— Pardon, monsieur, — ou mon cher enfant — vous dites trop bien ce que vous dites là.
— Comment, trop bien ?
— Oui ; vous faites trop d’effet. Vous êtes là pour donner une réplique. Donnez une réplique. Si vous taillez un premier rôle dans un personnage accessoire, le véritable premier rôle paraîtra épisodique. À chacun sa place !
« À chacun sa place ! » C’est la règle même de toute interprétation dramatique.
Et avec quel respect d’élèves à maître les comédiens écoutaient ses conseils ! Tous l’aimaient, et se seraient mis en quatre pour lui ! Après une répétition générale douteuse, ils recommençaient à répéter le lendemain, dans la journée, devant créer leurs rôles le soir. Pas un murmure. Et Montigny coupait, coupait. Les coupures, c’était son grand art encore. Il a sauvé bien des pièces à coups de ciseaux, en bon chirurgien. Parfois, il enlevait bien un peu de chair vive, mais la plupart du temps c’était de la chair morte, c’est-à-dire mortelle.
On lui rendait en dévouement ce qu’on lui devait. Non seulement l’excellent M. Chéri, son chef d’orchestre, son parent32, se serait sacrifié pour lui, mais j’ai vu Landrol33, le jour d’une première, rester sur le théâtre jusqu’à près de huit heures, jusqu’au lever du rideau, pour faire faire un travail dans le plancher à des machinistes, et Landrol jouait le soir et il avait une des responsabilités de la pièce ! Que ceux qui connaissent la nervosité des acteurs, le soir d’une première, comprennent la vaillantise34 de ce brave Landrol !
Les origines de Je dîne chez ma mère
Un des sens très précieux de M. Montigny, c’était le sens de l’honnête. Ce n’était pas seulement un mot douteux, mais un sentiment douteux qui l’offusquait dans tel ou tel personnage sympathique. Il demandait alors, il réclamait une atténuation. Il aimait à faire intervenir le nom et l’image de la mère dans certaines situations pathétiques.
Un premier janvier, un jour de l’an, comme on dit, Lambert Thiboust35, étant invité à dîner chez M. Decourcelle36, arrive un peu en retard :
— Je vous demande pardon d’arriver passé l’heure, dit-il, mais figurez-vous, que Mlle Alice Ozy37 voulait me retenir à dîner. J’ai été obligé de lui répondre, pour m’excuser, que je dînais chez ma mère ! « Ah ! ça ! mais, m’a-t-elle dit, c’est la réponse de tout le monde ! Tout le monde dîne donc chez sa mère aujourd’hui ? »
Decourcelle avait écouté. Après le repas, il prit Lambert Thiboust à part. — Savez-vous qu’il y a une bien jolie comédie dans ce que vous nous avez raconté ?
— Quoi donc ?
— L’histoire d’Alice Ozy ! Et un joli titre : Je dîne chez ma mère38. Voulez-vous que j’en parle à Montigny ?
Montigny fut ravi. Voilà les idées qui lui plaisaient.
— Pourquoi ne m’apporte-t-on plus, disait-il parfois, des Je dîne chez ma mère ?
Un Beau Mariage : M. Montigny et M. Augier
Dans une comédie de MM. Émile Augier et Édouard Foussier39, Un beau mariage, il y a une scène, au troisième acte, où Michel Ducaisne, un savant pauvre, vient emprunter 1 500 francs à son ami Pierre Chambaud, devenu riche.
— Et pourquoi a-t-il besoin de ces 1 500 francs ? demandait M. Montigny à M. Augier.
— Parce qu’il a des dettes.
— Des dettes ! des dettes ! Cela va me gâter le personnage. Comment les a-t-il contractées, ces dettes ?
— Ah ! ma foi, mon cher Montigny, vous m’en demandez trop ! répondait Augier en riant.
— Eh bien ! conclut un jour le directeur, voyons, — qu’est-ce que cela vous fait ? — dites qu’il a dépensé ces 1 500 francs pour soigner un ami malade.
Tout l’homme est là, avec sa bonté mâle et son besoin d’honnêteté. Ceux qui l’ont connu ne l’oublieront jamais.
Et — quelle étrange chose que cette vie de Paris ! — Hier matin, on conduisait le deuil du directeur du Gymnase. Hier soir, à l’hôtel Continental, on portait des toasts à l’ancien directeur de la Gaîté, au maestro Jacques Offenbach et à la Fille du Tambour Major40. Funérailles ici, souper de centième là. Et ici et là, même public. Il y aurait un livre à écrire qui s’appellerait les Antithèses parisiennes.
Notes
1 « Parallèlement » mais aussi avant et après puisque la première chronique est parue, sous le titre Chronique de Paris, dans Le Temps du six décembre 1871. À partir du quatre octobre 1872, les mots de Paris sont tombés et le titre Chronique a perduré treize années encore, jusqu’au trente décembre 1886, c’est-à-dire plus d’un an après la fin de la première série de La Vie à Paris, avandonnée pour cause de nomination de Jules Claretie au poste d’administrateur général de la Comédie-Française.
2 Pour Montigny, voir la note 18 de La Vie à Paris du 24 février 1880, évidemment moins riche que le texte que nous lisons.
3 Sous-entendu, « sur la chronique théâtrale de Francisque Sarcey » paraissant tous les lundis.
4 Le début de ce premier paragraphe est un peu différent de celui d’Havard.
5 Montigny a habité rue Saint-Pierre, à Neuilly puis dans son hôtel particulier au 73 rue de La Tour, à Paris, qui existe encore de nos jours.
6 Montigny a eu trois fils de sa seconde épouse, la comédienne Rose Chéri (Marie Cizos, 1824-1861) : Chéri (1855-1878, mort célibataire à 23 ans), Henri (1857-1865, mort à huit ans) et Didier (1858-1933). C’est donc sur ce dernier que Montigny prenait appui.
7 Il s’agit, on l’a compris, du théâtre du Gymnase.
8 Amazampo ou La Découverte du Quinquina, drame que quatre actes et sept tableaux par MM. Lemoine-Montigny et H. Meyer (Ambigu-Comique, juin 1936).
9 Ce théâtre, fondé en 1869 a été détruit près de deux siècles plus tard par la volonté d’André Malraux et remplacé par l’un des bâtiments administratifs les plus laids de Paris.

Le théâtre de l’Ambigu-Comique en 1959. Au premier plan, l’entrée du métro Saint-Martin. Cette station de métro a été fermée au début de la guerre et jamais rouverte. Elle a ensuite servi d’abri nocturne aux indigents, et de nos jours encore. Elle permettait aussi aux piétons de traverser le boulevard Saint-Martin.
10 Georges Guyon (1809-1850, à 41 ans). Après être entré une première fois à la Comédie-Française en 1933 sous le nom de Naudet (il est le fils du comédien Jean-Baptiste Naudet) y entrera une deuxième fois en 1838. Après un tour au théâtre de la Renaissance, il reviendra à la Comédie-Française une troisième fois dans l’emploi des rois et des pères nobles, favorisé par sa haute taille et sa voix de basse. Ce dernier retour fut bref, en 1849 Georges Guyon perdit brusquement la mémoire, puis la raison. Il est mort fou en octobre 1850.
11 Louis-Nicolas Brette Saint-Ernest (1802-1860), comédien et auteur dramatique.
12 Henri Horace Meyer (1801-1870), romancier, auteur dramatique. Directeur du théâtre de la Gaîté de 1839 à 1847.
13 Zara ou La Sœur de l’Arabe, mélodrame en quatre actes de Mourier et Lemoine-Montigny, représenté au théâtre des Folies dramatiques en mai 1837.
14 Samuel le marchand, drame que cinq actes par MM. Montigny et H. Meyer (Ambigu-Comique, mars 1838 avec le même Saint-Ernest).
15 Le Doigt de Dieu, drame en un acte de Montigny et Henri Meyer, Ambigu-Comique, mars 1834.
16 Montigny, Un fils, drame en trois actes et en prose, précédé de L’auberge des Trois-Oliviers, prologue en un acte (théâtre de l’Ambigu-Comique, octobre 1835, avec Montigny dans le premier rôle, celui de « Jacques de Raimbault, manufacturier, quarante ans) ». « La scène se passe en octobre 1815 à l’auberge des Trois-Oliviers, sur la route de Lyon à Avignon. » Pourquoi octobre 1815 ? Le 16 octobre 1815 est la date de l’arrivée de Napoléon à Sainte-Hélène, assez loin de la route d’Avignon. L’action n’a peut-être aucun rapport. Il faudrait lire la pièce.
17 Le Monde dramatique, « revue des spectacles anciens et modernes », numéro de 1837 pas plus précisément daté (peut-être mars), pages 62 et suivantes.
18 On peut le confirmer.
19 C’est Jules Claretie qui souligne. Le texte de l’édition originale ne comporte d’italiques que pour décrire l’action, qui ne sont jamais dans les textes des personnages.
20 De nombreux textes ne sont pas signés et Jules Janin n’avait nul besoin de se mettre en avant par sa signature (ses chroniques dramatiques du Journal des débats n’étaient signées que de ses initiales). Son nom apparaît dans la liste alphabétique des rédacteurs de la page trois entre Victor Hugo et Alphonse Karr.
21 François-René de Chateaubriand, Atala, ou Les Amours de deux sauvages dans le désert, Migneret, imprimeur rue Jacob, 1801. Les cinq éditions suivantes sont également parues chez Migneret. L’action est aussi une histoire d’Indiens. Le manuscrit est perdu. Les Martyrs ou Le Triomphe de la religion chrétienne, du même auteur, chez Le Normant, deux volumes, 1809. L’action se déroule en Bretagne.
22 Acte I, deuxième tableau, scène XIV, page huit de l’édition originale de 1836.
23 Ces italiques ne figurent pas dans l’édition originale, c’est Jules Claretie qui souligne.
24 Jean-François Marmontel (1723-1799), auteur dramatique et grammairien proche de Voltaire, directeur du Mercure de France en 1758, reçu à l’Académie française en 1763, secrétaire perpétuel vingt ans plus tard. Jean-François Marmontel, Les Incas, ou La Destruction de l’empire du Pérou, chez Lacombe, libraire rue de Tournon, 1777. Deux volumes.
25 Les Nachez, œuvre de jeunesse rédigée vers 1797 un peu oubliée de son auteur-même, a été publiée pour la première fois in-extremis dans les Œuvres complètes chez Ladvocat (22 volumes), de 1826 à 1831. Ces Nachez sont les membres d’une tribu indienne de Louisiane.
26 Vraisemblablement L’Africaine, opéra en cinq actes d’Eugène Scribe sur une musique de Giacomo Meyerbeer (1791-1864) créé à l’Opéra de Paris en avril 1865. L’action se déroule à la toute fin du XVe siècle dans les palais et les geôles de Lisbonne. Cet opéra sera cité à la première ligne du roman de Jules Claretie : Monsieur le ministre : « On venait de finir le troisième acte de l’Africaine. Le ministre sortit de la loge du directeur de l’Opéra »…
27 Argot d’imprimerie puis de théâtre : « Défaut, malfaçon, lacune » (TLFi), entré de nos jours dans le langage courant : « Il y a un loup ».
28 Désiré Nisard (1806-1888), agrégé de lettres en 1832 et critique littéraire extrêmement doctrinaire, pour ne pas dire étroit. Désiré Nisard a été professeur d’éloquence latine au Collège de France. Il a été élu deux fois député centriste de la Côte d’or entre 1842 et 1848 et sénateur, de 1867 à 1870. Un de ses pairs député dit un jour de lui, à propos de ses discours « Cette pluie fine de Nisard finit tout de même par mouiller. » Ce tempérament conduisit donc tout naturellement Désiré Nisard à l’Académie française. Adversaire des romantiques, il fut élu en novembre 1850 face à Alfred de Musset, qu’il reçut néanmoins en mai 1852.
29 François Buloz (1803-1877), imprimeur puis traducteur et enfin directeur, pendant quarante années de la prestigieuse (à l’époque) Revue des deux mondes. Cette activité qu’on imagine prenante n’empêcha pas François Buloz d’être nommé en août 1847 « Commissaire royal » (administrateur) de la Comédie-Française, dix mois seulement, il est vrai.
30 Edmond Gondinet (1828-1888), auteur dramatique et librettiste, était proche de Montigny. Son livret le plus durable est celui de Lakmé, de 1883, opéra en trois actes sur une musique de Léo Delibes. Les autres auteurs cités ici on déjà fait l’objet d’une note à diverses dates de La Vie à Paris.
31 L’avant-scène est une loge, souvent au jardin, parfois grillagée, se trouvant entre le rideau de scène et la rampe, ou, si l’espace est trop étroit, débordant de la rampe vers la salle. On a pu connaître des avant-scènes bien plus reculés, donnant directement sur la scène. De nos jours dans certains théâtres manquant de profondeur, une avant-scène (il y a souvent une ou deux avant-scène supérieures ou d’autres à la cour) peut être occupée par les régies lumière ou son.
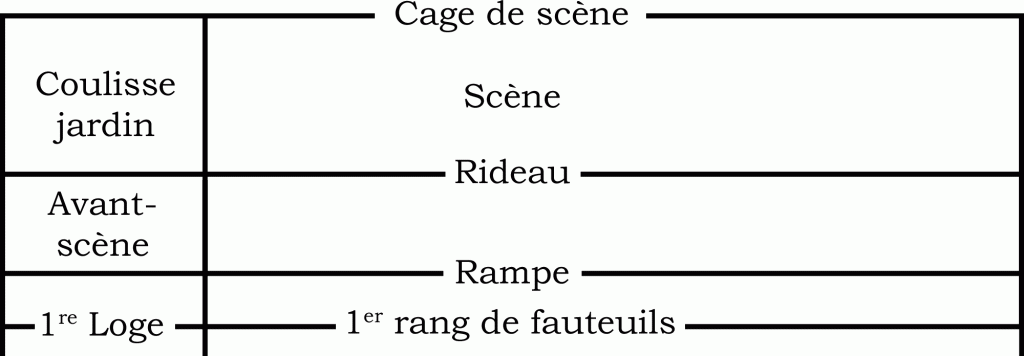
32 Peut-être son fils (pourquoi Jules Claretie ne le dit-il pas ?), 1855-1878, mort à 23 ans et déjà signalé dans la note 5 ci-dessus.
33 Joseph Landrol (1828-1888), qui a fait toute sa carrière au Gymnase.
34 Contrairement à la bravitude, célèbre en janvier 2007, la vaillantise existe bien dans les dictionnaires. On peut, à l’occasion, s’interroger sur l’absence de l’un et la présence de l’autre.
35 Lambert-Thiboust (Pierre Thiboust, 1827-1867, mort avant ses quarante ans), d’abord comédien puis auteur dramatique à succès extrêmement prolifique.
36 Adrien Decourcelle (1821-1892) n’a pas eu moins de succès dans les comédies qu’il a écrites, bien moins nombreuses néanmoins que celle de Lambert-Thiboust. Adrien Decourcelle est le père du romancier et auteur dramatique Pierre Decourcelle (1856-1926), davantage connu que son père.
37 Alice Ozy (Julie Pilloy, 1820-1893), jolie comédienne écervelée aux nombreux amants ayant joué entre 1836 et 1855.
38 Je dîne chez ma mère, comédie en un acte mêlée de couplets par Adrien Decourcelle et Lambert-Thiboust (cinq personnages) créée au théâtre du Gymnase le 31 décembre 1855. L’action se passe à Paris le premier janvier 1765. Le texte de la pièce est paru chez Michel Lévy en 1860 (28 pages).
39 Édouard Foussier (1824-1882), condisciple d’Émile Augier au lycée Henri-IV, avec qui il écrira au moins deux comédies dont ce Beau Mariage, comédie en quatre actes créée au théâtre de Gymnase le cinq mars 1859.
40 La Fille du tambour major, opéra-comique en trois actes d’Alfred Duru et Henri Chivot sur une musique de Jacques Offenbach (Folies dramatiques, treize décembre 1879).
.
.
