Cette Vie à Paris est parue dans Le Temps du six avril 1880 mais est curieusement daté du premier avril dans l’édition en volume de Victor Havard. Page mise en ligne le 14 octobre 2024. Temps de lecture : 24 minutes
De l’influence du téléphone et du phonographe sur la vie moderne — Les télégrammes de Mme de Sévigné — Les petits cartons pour lettres — Spirites et spiritisme — Fernand de Marescot — François Hippolyte Walferdin — Les impressionnistes — Courses et Coursing — Notes
De l’influence du téléphone et du phonographe…
Je sais bien que nous vivons dans un siècle où la science marche à pas de géant ; je sais bien qu’il est parfaitement ridicule de faire du paradoxe à propos d’inventions nouvelles ; c’est là de l’esprit démodé. Il me tombait hier sous les yeux un article où, sans aller plus loin, Théophile Gautier1, rendant compte des premiers voyages faits de Paris à Saint-Germain sur une ligne de chemin de fer, s’amusait à déclarer que le railway et le steam-horse étaient deux choses parfaitement ridicules et qui n’auraient, à la longue, aucun succès. Valait-il bien la peine d’être un romantique à tous crins pour en arriver à regretter les diligences, comme ce spirituel M. Thiers, qui était déjà « le petit bourgeois » en 1837 ?
Encore une fois, ces paradoxes, désormais vieillis, ne font plus sourire personne, et la science, Sa Majesté la Science, est la souveraine de ce temps, une souveraine incontestée et ultra-constitutionnelle puisqu’elle poursuit ses découvertes sous toutes les Constitutions, et, parfois en dépit de certaines constitutions. Il n’en est pas moins permis, je pense, de se demander quelles modifications formidables le progrès amènera dans nos mœurs, notre façon de dire, de sentir, de penser même, et je vois et prévois, dès aujourd’hui, par exemple, dans l’installation des téléphones et l’usage des dépêches télégraphiques la perte de tout un art délicat et charmant, profondément français : l’art épistolaire, — cette causerie la plume à la main.
Il est évident que, lorsqu’on pourra converser d’un bout de Paris à l’autre sans sortir de son cabinet, le papier à lettres sera chose parfaitement inutile. On assure qu’il y a déjà deux ou trois cents téléphones installés autour de nous ; c’est huit ou neuf cents personnes qui peuvent jusqu’à un certain point laisser leur encrier vide2. Lorsque nous aurons deux ou trois mille téléphones sillonnant Paris, adieu le cher bavardage par lettres : la grande ville ressemblera à une vaste assemblée de gens atteints de surdité et penchés, du matin au soir, sur leur cornet acoustique. Et quel étonnement ! La personnalité même y disparaîtra. On ne sera plus, dans l’immense concert téléphonique, qu’un numéro matricule, comme au régiment ou au bagne : on notifiera au bureau central la volonté d’être mis, je suppose, en communication avec le no 1700. Et sous ce no 1700 qui sait ce qu’on cachera d’inquiétudes, de fièvre, de hâte ardente de savoir ? Invention admirable, je n’en disconviens pas, et d’une utilité criante, soit dit sans jeu de mots. Je le salue, ce téléphone, comme un miraculeux événement, et Edison, qui l’a inventé, prend dans mon imagination un vague aspect de Génie des contes arabes, mais je n’en persiste pas moins à croire que, si la conversation y gagne, l’art épistolaire et la simple urbanité y perdront.
Les télégrammes de Mme de Sévigné
À quoi bon des visites, par exemple, avec le téléphone ? Un simple souhait à travers l’espace : « Vous allez bien ? — Fort bien, merci ! » Tout est dit. L’instrument redevient silencieux et la politesse est faite. Au point de vue spécial de l’art bien français et bien féminin de la correspondance, le téléphone, après tout, est moins pernicieux que le télégraphe. La dépêche télégraphique est à la fois le succédané et le fléau de la lettre mise autrefois à la petite poste3. Le télégraphe est à l’art épistolaire ce que le reportage est à la littérature. Il l’active et le supprime. On n’a pas grands frais de style à faire pour enserrer une communication quelconque dans vingt mots. Les adjectifs deviennent inutiles, les épithètes pittoresques sont encombrantes et coûteuses. On remplace par le langage enfantin des nègres cette claire et brillante langue française, qui compte justement des chefs-d’œuvre exquis en ce genre et en cet art particuliers. Qui sait vraiment si nous aurions la correspondance de Mme de Sévigné en supposant que le télégraphe eût été inventé du temps de Louis XIV ? Sans nul doute la marquise, avec son prurit de plume et de verbiage, n’eût pas complètement renoncé à montrer à ses amis qu’elle avait de l’esprit et savait tourner une jolie missive. Mais elle eût, la plupart du temps, employé le télégraphe pour correspondre plus vite avec sa fille, et, au lieu de ces délicates causeries avec Mme de Grignan qui évoquent pour nous des tendresses infinies, et tout un monde de sentiments affinés, nous collectionnerions aujourd’hui des semblants d’autographes bizarres où Mme de Sévigné s’exprimerait à peu près ainsi :

Fragment de l’article du Temps
Et relisez maintenant la jolie lettre datée de ce beau pays silencieux où Mme de Sévigné se montre « lisant, rêvant dans un éloignement de toutes sortes de nouvelles, vivant enfin sur ses réflexions » — et voyez ce que nous y aurions perdu4-5 !
⁂
Mais, en dépit des lamentations, il faut bien que les destins s’accomplissent, et les destins des peuples c’est d’aller vers le progrès matériel et le bien-être du plus grand nombre. Il ne peut pas plus être question de ce que les délicats y perdent qu’on ne saurait s’occuper des fleurettes que les roues des canons écrasent lorsqu’il s’agit de mettre, au plus vite, sur un point donné, une batterie d’artillerie en position. Le télégraphe supprimera à la longue — cela est bien certain — tout un genre littéraire, et la tâche des Monmerqué6 de l’avenir se réduira à déchiffrer des télégrammes. Il n’y a rien à dire à cela et rien à faire. Le monde marche ; personne ne l’arrêtera en chemin.
⁂
Les femmes pourtant, les femmes d’esprit, les mondaines, les oisives, pouvaient encore sauver cette causerie par lettres qui était un plaisir si charmant, Ce fut jadis pour elles une occupation et une séduction que de tourner galamment une invitation, de mettre dans le moindre billet un grain d’esprit ou un brin de sentiment. Elles triomphaient dans cette sorte de broderie délicate, car l’art épistolaire est un art de femmes, comme l’aquarelle. Ah ! bien oui ! Elles n’ont pas voulu !
Les petits cartons pour lettres
Elles ont inventé ces papiers élégants, ces bouts de carton chiffrés qui laissent à peine de quoi loger sèchement trois ou quatre lignes abrégées, avec une signature au bout. Elles ont mis à la mode ces tablettes anglaises au format exigu qui semblent dire à celui qui écrit : « Pas de longueurs ! Aucune expansion ! Laconisme et économie de temps ! » Fa presto, la devise de ce peintre de la décadence7 qui a décoré tant de monuments en Espagne, est aussi le mot d’ordre d’une société nouvelle qui n’a plus à s’attarder aux sentiers fleuris, qui va droit au but, supprime les périphrases, donne à ses billets les plus intimes le ton de circulaires et finira par faire lithographier d’avance un certain nombre de lettres toutes préparées pour les diverses circonstances de la vie : « Remerciements ; Félicitations pour un mariage ; Lettres de condoléance pour une mort ; Reproches amicaux ; Effusion de tendresse. » Il suffira, pour être correct, de remplir, sur ces cartonnages réglementaires, quelques passages laissés en blanc, et c’est à peine si quelques variantes dénoteront le degré d’intimité unissant celui qui envoie la lettre à celui qui la reçoit. Uniformité presque complète. Mais comme toute peine sera évitée ! Et « le temps est de l’argent », à ce que disent nos maîtres.
⁂
Oui, vraiment, j’en veux un peu aux femmes d’avoir si vite renoncé à une de leurs prérogatives, d’avoir accepté les innovations des papetiers et remplacé le fin petit poulet, au format charmant, par ces cartonnages, aussi secs que les banalités qu’on leur confie. Mais les femmes, après tout, suivent leur temps, de leurs petits pieds, et, elles aussi, s’éprennent d’utilitarisme. Le temps du romanesque est passé.
Spirites et spiritisme
Et cependant, s’il fallait en croire M. Eugène Nus8, le temps du merveilleux serait enfin venu ! M. Nus est un auteur dramatique d’un vrai talent, qui a écrit avec Brisebarre9 des œuvres populaires vigoureuses et porté le naturalisme sur la scène bien avant qu’on appelât naturalistes d’autres négociants que les empailleurs10. M. Nus est en même temps un esprit chercheur, qui a signé deux beaux livres : les Grands mystères et les Dogmes nouveaux. Il vient d’en publier un troisième beaucoup plus étonnant qu’il appelle Choses de l’autre monde11, et qu’il dédie « aux mânes des savants qui ont nié et repoussé la rotation de la terre, la circulation du sang, la vaccine, l’ondulation de la lumière, le daguerréotype, la vapeur, l’hélice, les chemins de fer et l’éclairage au gaz. » Ces Choses de l’autre monde ont pour but de prouver que le spiritisme est une science comme le galvanisme, et que les tables tournantes, qui ont fait tourner tant de têtes, sont un phénomène indéniable. M. Nus nous rapporte avec beaucoup de foi les conversations qu’il eut jadis avec un guéridon, en présence de M. Antony Méray12, de M. Brunier, de M. Pottier, qui fut, je crois, membre de la Commune, et de M. Victor Hennequin13, ancien représentant du peuple, lequel mourut fou. M. Nus raconte ensuite l’histoire d’un esprit vivant, agissant, qui apparaît de telle heure à telle heure dans une famille américaine, y fait le ménage, y époussète les meubles, et n’existe pas. Cet esprit est une jeune fille fort jolie, et s’appelle, de son nom d’esprit, Katie King. « Je ne dis pas que c’est possible, répète M. Nus avec Williams Crookes, je dis que cela est. »
Et moi, je ne dis pas que cela n’est point, mais je serais tenté de dire que c’est impossible. En de telles matières, la crédulité devient quelque chose d’extraordinaire. Les spirites se sont réunis, cette semaine, autour de la tombe d’Allan Kardec14, au Père-Lachaise, et lui ont souhaité mille prospérités, à travers la pierre du tombeau. Il eût été plus simple d’évoquer tout uniment l’esprit d’Allan Kardec (puisque ces sortes d’opérations sont faciles) et de converser avec lui, loin du funèbre paysage d’un cimetière. Mais l’hommage eût sans doute paru moins complet.
Ils ont le crâne bossué d’une certaine manière, je suppose, ces spirites, et leur librairie spéciale, la Librairie spirite, rue de Lille, publie un certain nombre d’élucubrations que la foule ne connaît malheureusement pas assez. J’ai eu la bonne fortune de lire, ces jours-ci — les Choses de l’autre monde de M. Nus m’y avaient poussé — un volume tout à fait particulier, signé du nom de M. Albéric Duneau et intitulé : Mes causeries avec les esprits15. C’est original.
Il s’agit ici du compte rendu des séances spiritomagnétiques tenues périodiquement dans une petite rue des Batignolles. On se livre là, grâce à quelque médium, à quelque sujet magnétique endormi, voire même au moyen de la médiumnité par le verre d’eau comme Cagliostro, à des communications orales, à des entretiens fort piquants avec les esprits. Ces esprits, qui sont variés, qui s’appellent Adèle, Jacques, Bernard, Gustave, — peu importe, — et qui, parfois, ont des noms plus célèbres, se livrent à des confidences qui devraient singulièrement étonner les esprits, si les esprits s’étonnaient de quelque chose. Il est de ces esprits mal faits qui n’entendent pas la plaisanterie, qui haussent les épaules, qui se fâchent, — par exemple cet esprit allemand qui arrive pour s’écrier :
— J’avais deux ans quand je vins à Paris ! Je suis fils d’Allemands ; les Français m’ont chassé de Paris à cause de la guerre ; eh ! bien, je me vengerai de tous les Français !
À quoi le Maître spirite qui l’évoque répond judicieusement :
— Mais, malheureux, vous ne savez donc pas que vous êtes mort ?
Il y a des esprits qui « se mettent à cueillir des marguerites » dans la chambre des Batignolles ; d’autres qui sacrent et jurent comme un cardinal Dubois16 ; d’autres qui racontent Peau d’Âne, une féerie de la Gaîté17 ; d’autres qui, décédés en 1750, s’étonnent qu’on les dérange après plus d’un siècle. Il y a des esprits juvéniles, — l’esprit Estelle, — mort d’une fluxion de poitrine attrapée à la Closerie des Lilas, et qui s’écrie, froissé dans sa pudeur virginale :
— La Closerie des Lilas ! Nous ne connaissons pas cela, non, monsieur !
Il y a des esprits qui viennent se plaindre d’avoir été volés, et qui, retournant leurs poches (les poches d’un esprit) et n’y trouvant rien, tempêtent avec fureur.
Puis, tout à coup, au milieu des doléances d’un esprit qui parle tout seul, comme dans un monologue de théâtre : « Cette solitude durera-t-elle longtemps ?… Sont-ils bêtes !… Ils m’enterrent vivante, je les appelle à grands cris et ils ne m’entendent pas ! »
— Pardon, madame, interrompt le magnétiseur, moi, je vous ai entendue. Voyons, expliquez-vous !… Voulez-vous me dire qui vous êtes ?
— Si vous me regardiez bien, répond l’esprit, vous verriez qui je suis, car qu’est-ce qui ne me connaît pas dans Paris ?
Ici, je pense que ce serait affaiblir la Causerie rapportée par M. Alfred Duneau que de ne la point donner telle qu’elle est imprimée à la page 11 de son livre :
« Mme M…, présente ce soir-là à notre séance, dit gravement M. Duneau, eut l’inspiration que c’était l’esprit de Mme Thierret18. Elle me communiqua sa pensée, et je le demandai à l’esprit :
Une dame, lui dis-je, me prie de vous demander si ce n’est pas vous Mme Thierret ?
L’esprit répète avec emphase et fierté :
— Du palais-Royal !
— Je n’ai rien su de votre maladie.
— Oui, j’avais attrapé un froid.
— Voulez-vous me dire votre âge, madame ?
— Vous seriez le premier et qui je le dirais. »
… À ce moment, des esprits lui apportèrent des épis de blé ; alors elle se récria en disant :
— Ah ça ! qu’est-ce que cela signifie ?
— Quoi, madame ?
— On vient de m’apporter un bouquet comme jamais de ma vie je n’en ai reçu !
— Voulez-vous faire une prière ensemble ?
— Prier ! Allons donc ! Dieu, je n’y crois pas !
— Eh bien, croirez-vous bien que vous êtes morte ?
— Oui, puisque j’ai vu mon convoi ! »
⁂
Pauvre Mme Thierret, qui nous a tant fait rire de son vivant, il faut encore que les évocateurs spirites nous égayent involontairement avec le souvenir de cette duègne étourdissante et d’un cornique si fin ! Je la retrouve dans ces Causeries de M. Duneau avec les esprits, revenant tout à coup, au milieu d’une séance, pour donner aux spirites des Batignolles ce renseignement d’outre-tombe : « Je viens vous dire, mes amis, que je suis bien heureuse. J’ai toujours des anges autour de moi. Ils me tracent mes occupations, et je leur obéis comme un enfant obéit à son maître. J’ai suivi vos conseils, monsieur, j’ai pensé à Dieu, j’ai prié, et c’est pour cela qu’on s’occupe de moi. Je reviendrai dans huit jours. Ces groupes me plaisent. Travaillez, mes amis, moi je travaillerai aussi. Votre toute dévouée, Mme Thierret. »
On a parlé jadis, en manière de raillerie, des conversations de M. Baudelaire avec les anges. Mais les dialogues de Mme Thierret avec les séraphins ne manquent point d’une certaine imagination folâtre qui brave le ridicule. Et le livre où je rencontre ces belles inventions est tout rempli de semblables étonnements. Ces folies sont une religion pour des milliers de gens. Ces menus propos échangés avec les fantômes sont écoutés bouche bée et avalés comme eucharistie par les adeptes. Une demoiselle J…, médium, s’assied devant un verre d’eau et demeure là, les yeux écarquillés, regardant on ne sait quel tableau fluidique d’elle seule aperçu. Tout à coup, elle aperçoit distinctement, dit-elle, « une dame en noir qui descend au fond de la mer. » Ce spectacle est déjà assez surprenant, mais ce n’est pas tout : « Cette dame cherche deux enfants ; elle les trouve et les emmène avec elle. » Où ? Comment ? Peu importe. « Le medium voit le fond de la mer ; ce tableau est si grandiose qu’il se trouve interdit à la vue de tant de choses et ne peut nous donner (je cite le volume) aucune explication. » Honnête medium ! Au moins Mlle J… a de la conscience : elle voit, mais n’explique point.
Pas plus qu’Alexandre Dumas père, que M. Duneau fait sans façon comparaître à la barre de la rue Gauthey, aux Batignolles. Esprit bon enfant que celui de Dumas arrivant spontanément et disant tout rondement : « Ne craignez rien, c’est un ami qui vous parle. Je suis Alexandre Dumas ; je suis des vôtres, moi, mes amis ! »
Soit. Mais quelle question croyez-vous qu’on adresse à l’esprit de Dumas ? On va lui parler de Rabelais, dont il eut presque le rire, ou de Shakspeare, dont il admirait le génie ? Pas le moins du monde. Les spirites de la rue Gauthey lui demandent tout simplement :
— Est-ce que vous voyez Mme Thierret ?
Mme Thierret semble décidément jouer un très grand rôle dans l’école des Batignolles.
Et quand Dumas a déclaré que Mme Thierret est « heureuse » :
— Merci, ami Dumas, lui répond familièrement le spirite ; est-ce que vous voyez Pierre Dupont ? Pourriez-vous nous l’amener ?
Mais il paraît que Pierre Dupont n’est pas « fort heureux ». Il vit à l’écart. Il est demeuré rustique, presque sauvage. Il ne viendra que plus tard. C’est Dumas qui nous l’apprend, l’esprit de Dumas, un esprit cordial qui « serre la main » du magnétiseur en lui disant ; « C’est pour toute la société », et disparaît, sans doute en éclatant de rire.
On passerait pour naïf à s’indigner de ces niaiseries quelque peu sacrilèges. Avec ces diables de spirites Luther n’aurait plus à dire en parlant des morts : « Je les envie parce qu’ils reposent ! » Ils ne reposent point. On les fait voyager, on les appelle, on les dérange, on les sert, comme un personnage à la mode, à tous les badauds accourus. Il y a chez ces évocateurs une candeur si complète qu’on ne peut se fâcher de leurs extravagances. Le côté triste de cette religion du spiritisme née de l’appétit du mystère qui fait le fond de la nature humaine, c’est que ces docteurs en l’art d’exploiter la crédulité publique enfoncent souvent plus avant que de vrais grands hommes leur nom tapageur dans la mémoire de la foule, et qu’on voit, par exemple, le souvenir d’un Allan Kardec pieusement célébré par des disciples lorsque le monument élevé à la mémoire d’un maître peintre, Thomas Couture19, est inauguré dans ce même cimetière du Père-La-Chaise, à deux ou trois jours de distance20, sans que les artistes y viennent en grand nombre et que la presse en dise, en passant, plus que quelques mots.
Fernand de Marescot
La presse a fort peu parlé d’un jeune homme, M. Fernand de Marescot21, né riche, mort trop tôt, et qui, pouvant mener une vie inutile, laisse du moins, en tombant avant l’heure, une carte de visite à l’avenir. C’est par une excellente édition de Beaumarchais, une édition définitive entreprise avec M. Georges d’Heylli22, que le nom de M. de Marescot reviendra plus d’une fois sous la plume des lettrés. Bibliophile passionné, bon dépisteur de raretés littéraires et flaireur d’inédit, M. de Marescot avait fait de Beaumarchais une étude spéciale : il était beamarchaisiste comme d’autres sont moliéristes, puisque ces barbarismes sont à la mode. Caron était son « homme ». J’ai vu chez lui d’énormes volumes composés de Lettres ou de Copies de lettres inédites de Beaumarchais, acquises à prix d’or. Il se proposait de donner une suite à son édition, bourrée de morceaux inconnus, du Théâtre de Beaumarchais ; c’était la Correspondance de Beaumarchais. Le travail était commencé. La mort est venue l’interrompre. Par qui sera-t-il repris ? Et même sera-t-il jamais repris23 ? Que vont devenir ces pages inédites, d’un intérêt capital, ces Lettres d’une valeur considérable ?
Fernand de Marescot avait été, durant la guerre, porté à l’ordre du jour de l’armée et décoré de la médaille militaire dans une circonstance fort piquante et curieusement périlleuse, qui est bien une aventure faite pour un bibliophile et pour un brave. C’était en décembre 1870. Le futur éditeur de Beaumarchais avait pris rang dans un bataillon de mobiles24. Il portait allègrement le sac et, fort élégant, habitué, comme tant d’autres, aux douceurs de la vie parisienne, il allait au feu avec entrain. J’ai causé avec lui au plateau d’Avron25 ; il n’oubliait là ni ses livres, ni son dix-huitième siècle. Un jour, à Épinay, son bataillon étant cantonné dans les maisons, Marescot avise, au premier étage d’une villa, une bibliothèque excellemment fournie et, sur les rayons, un exemplaire d’un pamphlet assez rare contre Beaumarchais, son Beaumarchais, à lui, son héros et son bien.
Il s’assied, parcourt le volume, tire de sa capote un carnet de poche, et, son chassepot26 entre ses jambes, prend des notes, absorbé par son travail, enchanté de sa découverte et sans entendre le clairon qui ordonne la retraite. Quand il a fini, le volume une fois replacé dans la bibliothèque, il met le nez à la fenêtre. Ô stupéfaction ! En bas, dans le jardin, sous les arbres sans feuilles, il y a des uniformes ennemis et des casques prussiens. Le bibliophile est prisonnier, Beaumarchais a compromis son éditeur. Marescot prendra, comme captif, le chemin de Kehl, où M. Caron, au siècle passé, faisait imprimer Voltaire !
Eh bien, non, le voyage ne lui plaît pas. Le mobile de Paris ouvre la fenêtre, enjambe la balustrade, saute dans le jardin, tombe au milieu des Allemands, lâche son coup de fusil, bondit par-dessus les haies et, toujours courant sous les balles qui le poursuivent, rejoint l’arrière-garde de la colonne française et rentre sain et sauf à son bataillon où le fourrier le portait déjà comme absent : — Disparu ou mort.
Et c’est ainsi que ce pauvre et gai garçon, enterré hier, gagna pour son édition de Beaumarchais une note peu connue dont il constatait l’originalité, et, pour la boutonnière de son habit, un morceau de ruban jaune27 dont il était très fier.

Annonce en une du Gaulois du deux avril 1880
François Hippolyte Walferdin
Ce fut là un type de jeune lettré élégant, comme M. Walferdin28, dont on vend dans quelques jours la bibliothèque, les gravures et la collection d’œuvres d’art29, fut un type de vieil amoureux des jolies choses du temps passé, un amant du dix-huitième siècle, lorsque le dix-huitième siècle était encore méconnu et qu’on vendait deux ou trois francs, sur les quais, une gravure de Moreau le Jeune30. Ancien représentant du peuple, physicien remarquable, inventeur du thermomètre différentiel qui porte son nom31, M. Walferdin s’était comme retiré dans son logis de l’île Saint-Louis, et il y vivait en compagnie de Fragonard. Ah ! Fragonard ! C’était, je ne dirai pas « son homme », cette fois : c’était son Dieu, son demi-dieu, si l’on veut, car Denis Diderot passait peut-être avant Frago dans l’admiration de M. Walferdin. Encore n’en répondrais-je point.
Avec sa belle tête aux cheveux blancs, ce vieillard de quatre-vingt-cinq ans s’enfermait, là-bas, dans sa solitude, entouré des bustes de Diderot, de Franklin, de Washington, de Mirabeau, de M. J. Chénier32, terres cuites originales de Houdon, chefs-d’œuvre qu’il a légués en partie au musée du Louvre (les trois premiers de ces bustes du moins). Ses thermomètres et ses instruments de physique alternaient sur ses murailles avec les Fragonard bien-aimés. Fort peu riche, Walferdin avait vendu, il y a douze ou quinze ans, sa collection à M. de Montbrison, moyennant vingt mille livres de rente. La somme paraît forte. Ce n’était rien ; on le verra par les prix qu’atteindront de telles œuvres d’art. Mais, après la vente de cette collection déjà ancienne, Walferdin avait recommencé une petite galerie qui, à sa mort, est revenue à des collatéraux qui la font vendre. Un pauvre professeur de collège, cousin et héritier de M. Walferdin, est même devenu fou de joie à l’idée qu’il allait partager la modeste fortune du vieillard :
— Je suis millionnaire ! disait-il naguère. Maintenant, grâce aux Fragonard de mon cousin, je diminuerai l’impôt pour tous les Français !
Le rêve était généreux. On a conduit le rêveur dans une maison de santé.
Walferdin est mort au mois de janvier dernier, fidèle aux convictions de toute sa vie. Il y avait du feu dans sa chambre de mourant, et le bois, en se consumant, faisait dans la cheminée ce pétillement qui ressemble au bruit d’une fusillade. Walferdin moribond se dressa sur son séant et, croyant entendre les détonations d’une bataille dans la rue :
— Quel roi ? dit-il tout à coup à son vieil ami Étienne Arago qui le veillait, on se bat ! quel roi veut-on mettre sur le trône ?
— Non… Non…. On ne se bat pas, répondit Étienne, c’est le feu qui crépite.
— Ah ! tant mieux, fait alors le vieillard, je hais tant la guerre civile !
Il se produisit alors, dans ce cerveau d’octogénaire, un phénomène étrange. Walferdin mourant se mit à réciter, mot pour mot, une lettre qu’il avait écrite soixante ans auparavant à son père. « Mon bon père ! disait-il en s’endormant et pour toujours. C’est le mot sublime et doux du sculpteur Préault33 mourant et disant en souriant sur l’oreiller : « Je vais rejoindre papa ! »
Les impressionnistes
Voilà des savants, des artistes, des hommes. Je doute, soit dit sans offenser personne, qu’il s’en trouve d’aussi profondément convaincus dans ce groupe de peintres indépendants que le public a baptisés et continue à baptiser du nom d’impressionnistes34. Les impressionnistes viennent d’ouvrir, rue des Pyramides, dans une maison nouvelle, aux murs humides, leur cinquième exposition de peinture35. Il y a là de tout un peu, de l’excellent et du pire. L’excellent n’appartient pas plus à l’école de l’impression pure que le pire n’appartient à l’art. Ce qui est bon est très achevé. Ce qui est détestable serait affreux sous n’importe quelle étiquette.
Les danseuses de Degas, d’une vitalité si extraordinaire, les dessins et les peintures de M. Lebourg36, le portrait de M. de Goncourt, par M. Bracquemond37, d’autres tableaux encore, sont des œuvres tout à fait supérieures, d’un art spécial. Mme Berthe Morisot38 elle-même, qui est bel et bien impressionniste, impressionniste non repentie, donne, çà et là, comme miss Cassatt39, — une américaine, — des notes attirantes, d’une blancheur singulière. Mais ce qui est surprenant, hors de pair, dans cette exposition, ce sont les tableaux et les études de M. J.-F. Raffaelli40, une sorte de Meissonier41 de la misère, le peintre des deshérités, le poète de la banlieue de Paris, un tempérament singulier, puissant et fin, mi-parti flamand et parisien, un nouveau venu dont je raconterai, quelque jour, les tâtonnements, la genèse artistique et l’histoire. Mais M. Raffaelli n’a rien de l’impressionniste.
Courses et Coursing
Cette exposition des « impressionnistes » est, avec celle de M. J. de Nittis42, organisée dans les galeries de l’Art, une des attractions de la semaine. Avant peu, ces tableaux achevés et ces pastels exquis de M. de Nittis partiront pour Londres. Les amateurs mettent autant de hâte à les aller voir que les savants à acclamer M. Nordenskjöld et les boock-makers à suivre les courses. Et pourtant les réunions se multiplient ! Courses au bois de Boulogne, courses à la Croix-de-Berny43, comme au bon vieux temps, courses militaires et sauts d’obstacles au palais de l’industrie ; coursing sur la piste d’Enghien : — coursing, c’est-à-dire étranglement de quelques malheureux lapins ou lièvres par des lévriers lâchés sur leur proie. Plaisir sauvage, en somme, aussi brutal et moins pittoresque qu’une course de taureaux, aussi sanglant et aussi inutile qu’un combat de coqs, aussi pénible qu’un combat de rats, — plaisir de blasés qui ne s’acclimatera pas facilement en France, je crois, et dont les partisans n’ont jusqu’ici trouvé qu’une excuse pour opposer à ceux qui protestent et trouvent un peu cruelle cette exécution de levrauts ou de lapereaux tremblant de peur par de grands diables de lévriers aux crocs féroces :
— Que voulez-vous ? le lapin se sauve, le lévrier le poursuit ! C’est tout naturel !
Éternelle histoire : c’est le lapin qui a commencé.
Notes
1 Théophile Gautier (1811-1872), poète romantique, romancier et critique d’art. On se souvient notamment de Mademoiselle de Maupin paru chez Eugène Randuel, l’éditeur des romantiques (351 pages) et du Capitaine Fracasse (Charpentier 1863) et aussi de son recueil de poésies Émaux et Camées (Didier, 1852).
2 Par « autour de nous », Jules Claretie pense à Paris. C’est à l’occasion de l’exposition universelle de 1878 que le premier réseau téléphonique urbain a été installé à Paris en même temps que le ministère des Postes et Télégraphes. La commercialisation est intervenue l’année suivante (l’année dernière) par des concessionnaires privés dont la société du téléphone Edison installée au 45 avenue de l’Opéra (50 francs par mois). L’an prochain, Lyon comptera 23 abonnés et Marseille 25, essentiellement des entreprises.
3 Cette expression est déjà bien désuète en 1880, la petite Poste n’existant plus depuis bien longtemps. En 1653 les Parisiens peuvent correspondre avec la province et l’étranger mais aucun service postal ne permet d’échanger des plis à l’intérieur de la capitale, ce qui était alors l’emploi des domestiques et des chasseurs. Le 17 juillet de la même année, une ordonnance de Louis XIV donne satisfaction à un maître des requêtes, Renouard de Villayer, de combler cette lacune et de créer la Petite poste de Paris. Le port de ces lettres doit être acquitté d’avance à l’aide d’un billet de port d’un sol. Cette « petite poste » n’eut pourtant pas le succès escompté et disparut trois ans plus tard. D’autres entrepreneurs reprendront l’idée avec des succès divers jusqu’à ce que la distribution du courrier soit prise en mains à la Révolution, permettant la surveillance plus efficace du courrier.
4 Jules Claretie laisse au lecteur du Temps, qui dispose évidemment de l’ouvrage à portée de main, le soin de trouver cette lettre. Le lecteur de claretie.fr dispose sans doute de moins de temps, aussi ce texte est-il reproduit dans la note suivante. La lettre de Marie de Sévigné est datée d’Ingrande, qui se nomme de nous jours Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire et se situe un peu en aval d’Angers.
5 Voici le texte de cette lettre dans l’édition Pléiade de la Correspondance de Marie de Sévigné, édition de Roger Duchêne de 1974 volume II, pages 925-926.
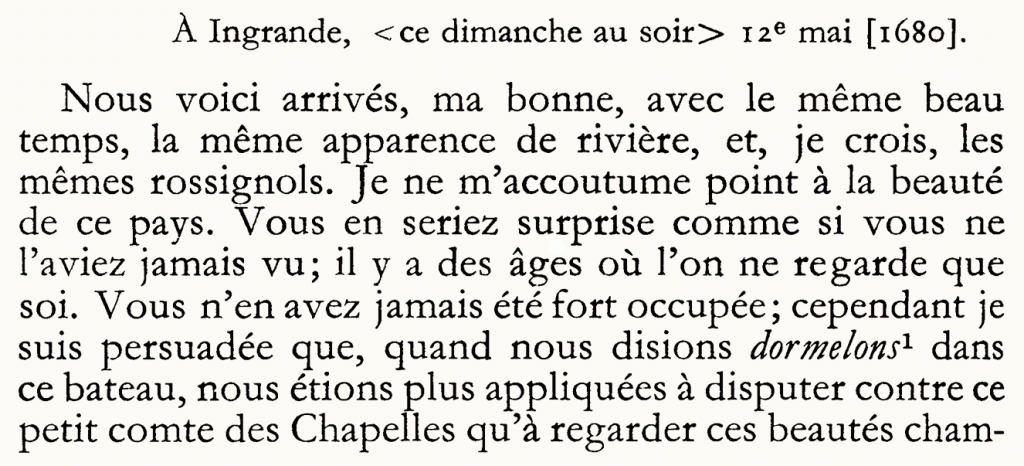
À Ingrande, <ce dimanche au soir> 12e mai [1680].
Nous voici arrivés, ma bonne, avec le même beau temps, la même apparence de rivière, et, je crois, les mêmes rossignols. Je ne m’accoutume point à la beauté de ce pays. Vous en seriez surprise comme si vous ne l’aviez jamais vu ; il y a des âges où l’on ne regarde que soi. Vous n’en avez jamais été fort occupée ; cependant je suis persuadée que, quand nous disions dormelons dans ce bateau, nous étions plus appliquées à disputer contre ce petit comte des Chapelles qu’à regarder ces beautés champêtres. Voici justement le contraire : nous sommes dans un parfait silence, parfaitement à notre aise, lisant, rêvant, et admirant un entier éloignement de toute sorte de nouvelles, et vivant sur nos réflexions. Le bon Abbé prie Dieu sans cesse ; j’écoute ses lectures saintes. Mais quand il est dans le chapelet, je m’en dispense, trouvant que je rêve bien sans cela. Enfin, ma bonne, nous trouvons le moyen de passer douze ou quatorze heures de cette sorte sans nous désespérer, tant la liberté est une belle chose. Vous connaissez la Loire par un autre bout, que j’honore, quoique moins beau, puisqu’elle m’a apporté et m’apportera encore cette chère fille qui m’occupe si tendrement et que j’aime si naturellement.
Je voulais voir aujourd’hui Monsieur d’Angers. Il le souhaitait ; j’avais bien des choses à lui dire sur toutes les sortes de malheurs dont il est accablé. Mais il fait sa visite ; il n’a pas reçu ma lettre. Demain nous serons tout à fait dans le grand monde, à Nantes. J’y trouverai de vos lettres, ma bonne, dont j’ai grand besoin, et j’y achèverai celle-ci. Aurait-on été assez cruel à Paris pour ne vous avoir point envoyé ce petit couplet sur M. de Dreux ? Il est extrêmement joli ; il sortait de sa coque le jour que je sortis de Paris.
6 Louis Monmerqué (1780-1860), éditeur des Lettres de Marie de Sévigné en dix volumes parus vers 1820 et aussi des Historiettes de Gédéon Tallement des Réaux en six volumes, vers 1830. Louis Monmerqué était aussi un peu pilleur de documents dans les bibliothèques.
7 Luca Giordano (1634-1705), réputé avoir réalisé cinq mille tableaux et ensembles de fresques. Cette expression était surtout utilisée par les peintres à fresque, qui peignaient sur un enduit encore frais avant qu’il ait eu le temps de sécher.
8 Eugène Nus (1816-1894), journaliste et auteur dramatique prolifique.
9 Édouard Brisebarre (1815-1871) auteur dramatique prolifique lui aussi collabora souvent avec Eugène Nus. Les deux auteurs sont souvent cités dans la page sur Firmin Léautaud à partir de 1866.
10 Jules Claretie n’aime pas les productions des auteurs naturalistes, on l’a compris depuis quelques articles de La Vie à Paris déjà.
11 Eugène Nus, Les Grands mystères — Vie universelle — Vie individuelle — Vie sociale, Librairie des sciences sociales, Noirot et compagnie, 1866. Les Dogmes nouveaux, Édouard Dentu, 1878. Choses de l’autre monde, Édouard Dentu, sans date.
12 Antony Méray (1817-1887), écrivain et journaliste.
13 Victor Hennequin (1816-1854), avocat, brièvement député (extrême gauche) de Saône-et-Loire de mars 1850 à décembre 1851 (deux législatures). Le dictionnaire des parlementaires de Robert et Cougny évoque une « imagination ardente et romanesque » et conclut : « Une brochure de lui, intitulée Sauvons le genre humain ! parue en 1853, porte la marque d’un trouble intellectuel évident. Il mourut l’année suivante. »
14 Allan Kardec (Hippolyte Rivail, 1804-1869), fondateur du spiritisme. Les réunions autour de la tombe Allan Kardec au Père Lachaise ont encore lieu de nos jours.
15 Albéric Duneau, Mes causeries avec les esprits, compte rendu de mes séances spirito-magnétiques des Batignolles, Librairie spirite, 7 rue de Lille. La rue de Lille, où habita Jules Barbey d’Aurevilly (au numéro dix) et Jules Sandeau (au numéro 17), proche de la Seine, commence rue des Saints-Pères et se termine vers l’Assemblée nationale, rue de Courty où habiteront, au numéro huit, Jean Lorrain et Marcel Achard.
16 Guillaume Dubois (1656-1723), abbé en 1692, évêque en 1620, cardinal l’année suivante, sans savoir célébrer une messe. Guillaume Dubois fut très efficace dans les intrigues et la diplomatie secrète en tant que conseiller du Régent. Il a été nommé ministre des Affaires étrangères en 1718, et premier ministre en 1722, nommé (et non élu) à l’Académie française la même année. Homme à femmes, la légende le dit visé par la chanson Il court il court le furet, que l’on peut lire ainsi : « Il fourre, il fourre, le curé Dubois joli ».
17 Vanderburk, Laurencin et Claireville, Peau d’Âne, « grande féérie en quatre actes et vingt tableaux » Cette féérie comprenait une « musique nouvelle » des chants, des danses et une dizaine de ballets affichant 24 danseuses. Cette « féérie » a été représentée en août 1863 et certainement reprise. Le nom de Charles Perrault n’est pas cité mais peut-être s’agit-il de tout autre chose.
18 Félicia Thierret (1814-1873), robuste comédienne entrée à la Comédie-Française en 1833 puis la quittant en 1849 pour rejoindre le Palais-Royal. Félicia Thierret est morte d’une pneumonie attrapée dans les courants d’air du théâtre.
19 Thomas Couture (1815-29 mars 1879).
20 Alors qu’Alan Kardec (note 14) est mort dix ans exactement avant Thomas Couture, le 31 mars 1869.
21 Fernand de Marescot (1844-avril 1880, à 36 ans), dix, rue Caumartin, auteur du Théâtre de Beaumarchais (accompagné d’une notice), illustrations d’Adrien Marie, à la Librairie illustrée, sans date mais vraisemblablement du printemps 1864. Cet ouvrage est aussi accompagné de la reproduction d’une lettre de Beaumarchais dont on peut retenir la signature.

22 Georges d’Heylli (Edmond Poinsot, 1833-1902), écrivain et journaliste. Le nom de Georges d’Heylli n’apparaitra que dans l’édition de 1879 et avant celui de Fernand de Marescot qui mourra l’année suivante. Cela ressemble fort à une captation.
23 Pas encore, malgré plusieurs publications fragmentaires, la dernière chez klincksieck en 1972, qui s’arrête, avec le troisième volume, en 1877, Beaumarchais ayant vécu jusqu’en 1899.
24 De gardes mobiles. La garde nationale mobile a été créée en février 1868 et dissoute en juillet 1872.
25 Point important de la défense de Paris pendant la guerre de 1870, situé sur les communes de Rosny-sous-Bois, Villemomble et Neuilly-Plaisance. La rue d’Avron, dans l’est de Paris est ainsi nommée parce qu’elle conduisait au plateau d’Avron.
26 Antoine Chassepot (1833-1905), armurier, a créé en 1866 le fusil modèle 1866 dit Chassepot.
27 Peut-être le ruban jaune, aux deux fines bordures vertes de la médaille militaire.
28 François Hippolyte Walferdin (1795-25 janvier 1880), physicien, co-fondateur de la société de Géologie de France, François Walferdin participa à l’édition des Œuvres Complètes de Diderot par Brière parue en 22 volumes en 1821. François Hippolyte Walferdin a été député (gauche modérée) de la Haute-Marne d’avril 1848 à mai 1849.
29

Annonce parue dans le Journal des débats du huit avril. Cette annonce est aussi parue dans d’autres journaux tels que Le Gaulois du 31 mars, Le Figaro du premier avril, le Gil Blas du douze, etc. Plus généralement la presse s’est largement fait écho de cette vente.
30 Jean-Michel Moreau (1741-1814), dit Moreau le Jeune par rapport à son frère, Louis-Gabriel Moreau, dit l’Aîné (1740-1806), peintres tous deux.
31 Ce thermomètre différentiel, parfois connu sous le nom de Thermomètre Beckmann, du nom de son constructeur est utilisé dans les mesures de cryoscopie (le froid profond).
32 Marie-Joseph Chénier (1764-1811), frère cadet d’André Chénier.
33 Auguste Préault (1809-onze janvier 1879), sculpteur romantique.
34 Nous savons que le nom impressionnisme est dû au journaliste Louis Leroy (1812-1885) qui, dans Le Charivari du 25 avril 1874, avait titré son article des pages deux et trois : « L’Exposition des impressionnistes » : « Oh ! ce fut une rude journée que celle où je me risquai à la première d’une exposition du boulevard des Capucines… »
35 Cette cinquième exposition s’est tenue, avec un succès modeste, durant tout le mois d’avril, au dix de la rue des Pyramides, à l’angle de la rue Saint-Honoré. La première s’était tenue au printemps 1874 dans l’atelier de Nadar, au 35 boulevard des Capucines, à qui les peintres avaient loué les deux derniers étages, tendus de rouge.
36 Albert Lebourg (1849-1928).
37 Félix Bracquemond (corrigé de Bracquemard) (1833-1914). Il s’agit du portrait d’Edmond de Goncourt.

Sur cette image fournie par le musée d’Orsay on constate de façon singulière que le bas-relief (en haut à gauche) ou l’oiseau en cage, apparaissent plus nets que le portrait d’Edmond de Goncourt, son foulard ou sa main tenant une cigarette. Le meuble en bas à droite, chaise ou porte-journaux, parait plus net aussi. Un flou volontaire introduit par le photographe n’est pas à exclure. Le Musée du Petit Palais dispose de plusieurs esquisses pour une lithographie.
Un dessin de Félix Bracquemond est particulièrement connu, sans que l’on sache qu’il en est l’auteur, c’est le deuxième logo, après la guerre de 1870, de l’éditeur Alphonse Lemerre, représentant l’homme à la bêche accompagné d’un soleil levant.

38 Berthe Morisot (corrigé de Morizot) (1841-1895), peintre impressionniste majeure, a épousé en décembre 1874 Eugène Manet (1833-1892), frère cadet d’Édouard Manet (1832-1883).
39 Mary Cassatt (1844-1926) peintre américaine, a quitté Pittsburgh, à l’âge de sept ans avec sa famille pour s’installer deux années à Paris. Dix ans plus tard, âgée de 19 ans, elle revient à Paris pour étudier la peinture avec Jean-Léon Gérôme ( voir la précédente Vie à Paris). En 1887 Mary Cassatt s’installera au dix, rue de Marignan, qu’elle ne quittera plus.
40 Jean-Marius Raffaëlli, né vers 1860 à Paris, est mort au Mali vers l’âge de 21 ou 22 ans. À l’occasion de cette exposition il a présenté six eaux-fortes, dont Deux hommes sur un banc. La représentation ci-dessous est de très mauvaise qualité. Rien n’indique de parenté avec le peintre Jean-François Raffaëlli (1850-1924).

41 Ernest Meissonier (1815-1891), particulièrement connu pour ses scènes militaires, qui n’a évidemment pas exposé dans ce salon.
42 Le peintre Jean De Nittis est le fils du peintre italien Giuseppe De Nittis (avec un D, 1846-1884). Selon le Catalogue raisonné des peintures et pastels de Gustave Caillebotte de Marie Berhaut (Wildenstein institute 1994), son parrain était Gustave Caillebotte.
43 La Croix-de-Berny est un lieu-dit, un carrefour se trouvant au sud du parc de Sceaux, sur la commune d’Antony, au sud de Paris. Il semble que le La fasse partie du nom. Le lieu, de nos jours saturé d’automobiles et d’immeubles de bureaux, est d’une laideur prononcée et d’un inconfort total pour l’être humain.
.
.
