Vie à Paris parue dans Le Temps du 28 janvier 1880. Page mise en ligne le 14 octobre 2024. Temps de lecture : un quart d’heure. Les intertitres ont été ajoutés.
Taine et Dumas (suite) — Portes entr’ouvertes — Fêtes parisiennes — L’esprit français — La fausse maîtresse — Rachel — L’esprit politique — Les comédiens et la folie — Les cercles — Changement de programme — Mœurs de la Comédie-Française (suite) — Les Lettres de Ximénès Doudan — Notes
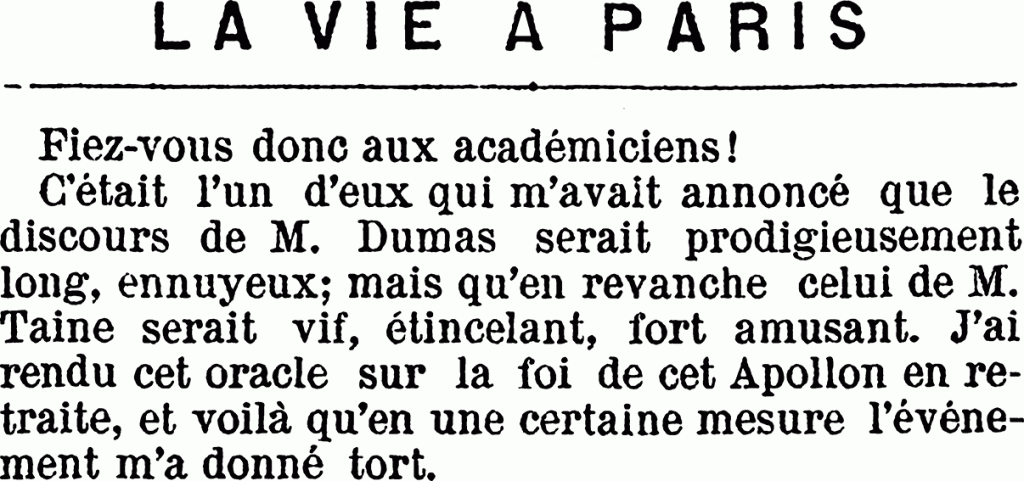
Taine et Dumas (suite)
Fiez-vous donc aux académiciens !
C’était l’un d’eux qui m’avait annoncé que le discours de M. Dumas serait prodigieusement long, ennuyeux ; mais qu’en revanche celui de M. Taine serait vif, étincelant, fort amusant. J’ai rendu cet oracle sur la foi de cet Apollon1 en retraite, et voilà qu’en une certaine mesure l’événement m’a donné tort.
Les deux discours ont été très littéraires. Mais celui de M. Taine, en dehors des habitudes, des traditions, ressemblait à un remarquable article de Revue. Ses finesses avaient besoin d’être découvertes par une lecture attentive et échappaient parfois à l’oreille.
Quant à M. Dumas, il a eu des indignations spirituelles, heureuses, contre le naturalisme2, et il a habillé en beau costume des lieux communs chers à l’Académie.
Je suis surpris qu’un Parisien comme Graindorge3, qui paraissait un peu à court d’arguments pour vanter le mérite de M. de Loménie, n’ait pas parlé de la grande révolution dont ce littérateur modeste, dont cet Homme de rien4 a été l’auteur.
Portes entr’ouvertes
Ces biographies honnêtes, décentes, qui ont mis le public en goût de curiosité, ces indiscrétions discrètes sur les intérieurs de nos grands hommes ont été l’origine de ce reportage actif, universel, qui a pris une place si considérable dans la presse française et une place presque exclusive dans beaucoup de journaux parisiens.
M. de Loménie a le premier gratté aux portes des célébrités, et fait l’inventaire de leur mobilier. Toute une invasion a passé par la porte entrouverte ; aujourd’hui, c’est une des conditions de la renommée de n’avoir plus un asile pour se cacher, à l’heure des repas, des effusions de famille, et même de la toilette.
Je ne juge pas la moralité de cette habitude. Elle amuse le public. Peut-être oblige-t-elle les gens exposés à la gloire à faire un peu balayer leur sanctuaire intime : mais, qu’elle soit funeste ou salutaire, elle est passée dans nos mœurs ; on ne peut l’en extirper, et désormais tout acteur, la veille de ses débuts, tout orateur, avant de monter à la tribune ou à la chaire, tout académicien, avant d’être reçu, tout fiancé de quelque importance politique ou sociale, avant d’aller à la mairie, doit subir un interrogatoire sur son âge, ses habitudes, ses appétits, ses relations, sa fortune, sa santé ; on ne s’arrête plus chez le concierge, on va droit au héros ; on le surprend en déshabillé, on assiste à sa toilette, absolument comme à celle d’un condamné à mort.
Ce qu’il y a de charmant dans cette violation de domicile, c’est que le personnage qui se refuserait aux renseignements demandés, qui voudrait ne donner que son nom, son talent au public, perdrait immédiatement, dans l’opinion du reporter, les titres à l’estime que lui assurent son talent et son nom. Tel candidat ne serait plus digne d’entrer à l’Académie, s’il refusait au premier venu le droit de pénétrer chez lui.
C’est le supplice d’Angelo. Tout homme un peu connu est exposé à entendre marcher dans son mur, le mur de sa vie privée. Il n’y a pas, il n’y aura jamais de loi Guilloutet5 efficace contre cet usage dont M. de Loménie a été le très innocent inventeur.
Un de mes amis qui a dû se soumettre dernièrement à cette épreuve me racontait qu’après deux heures de furetage dans ses papiers, dans ses souvenirs, le reporter, satisfait, mais rassasié, lui dit :
— Me permettrez-vous, cher maître, de revenir vous voir quelquefois ?
— Certainement.
— Voulez-vous être assez bon pour donner des ordres, afin qu’en votre absence on me laisse visiter votre bibliothèque ?
— Je ferai mieux que cela… Je vous ferai faire un passe-partout. Seulement, je vous en prie, marchez doucement la nuit, et ne me réveillez pas !
Fêtes parisiennes
Croit-on que l’autre soir, au bal de Mme Adam6, il n’y avait pas des reporters ? Ils ne se cachaient pas, et il faut avouer d’ailleurs qu’ils n’ont guère abusé de leur succès. La grâce de la maîtresse de la maison, l’éclat de la fête et aussi la variété des invités les ont désarmés.
On a beau travailler pour un journal hargneux qui interdit aux conservateurs de s’amuser sous la République ; il fallait bien avouer qu’il y avait là des conservateurs aimables fort en train de s’amuser.
On a beau imprimer tous les matins que les républicains sont aussi grossiers dans leurs allures que les bonapartistes le sont dans leur langage ; il fallait bien reconnaître que la gaieté était décente, sans manquer de vivacité, et qu’il se dépensait plus d’esprit en une heure, dans ce bal de démocratie élégante, qu’il ne s’en fabrique en un mois dans certains salons déserts de la réaction.
Les reporters ont dit cela avant moi ; ce qui prouve bien que les reporters ont du bon.
Si l’on s’amuse, et si l’on veut s’amuser dans le monde, en revanche on ne paraît guère s’amuser au bal de l’Opéra. On attendait beaucoup des deux orchestres annoncés ; il semblait qu’en doublant le bruit on allait doubler l’entrain. Hélas ! hélas !
— Je ne croyais pas qu’il y eût tant de notaires dans Paris, disait un provincial, étonné de cette quantité d’habits noirs et de la gravité de cette foule.
Que manque-t-il donc à ces fêtes ? Ce n’est ni le décor de la salle, ni la lumière, ni la musique, ni la jeunesse, ni même l’amour, encore moins l’argent dans les poches de ces messieurs, et dans le rêve de ces dames.
Mais ce que M. Vaucorbeil ne peut fournir, ce qui se passait de deux orchestres autrefois, ce qui faisait paraître superbes les chicards et les débardeurs7, ce qui embellissait le vieux foyer de la rue Le Peletier8, ce qui inspirait le génie de Gavarni, ce qui, le lendemain de ce grand attisement, se répandait en étincelles, en flammèches dans Paris, sur les boulevards, l’esprit, l’esprit parisien, l’esprit français, l’esprit tout uniment, voilà ce qui manque.
L’esprit français
Nous devenons bêtes. C’est peut-être une crise à traverser, comme celle de l’Empire, à laquelle nous avons survécu, et qui a peut-être amené celle-ci ; mais enfin c’est un fait réel, incontestable, l’esprit est en baisse.
Si on le mettait en actions, même sans promettre des dividendes, il aurait sans doute des chances de hausse ; par malheur, les financiers n’ont rien à voir dans ce déficit, qu’ils ont causé, mais qu’ils ne peuvent réparer.
Voilà un sujet de concours : chercher les moyens de ranimer l’esprit. Il n’a pas l’apparence humanitaire du concours proposé par M. Pereire9, et pourtant, au fond, il le vaut en grandeur et en illusion.
Il n’est pas plus chimérique de vouloir ramener, par un procédé, un pays au culte de l’esprit, que de trouver un remède empirique à la misère. Je voudrais savoir à ce propos si messieurs les financiers sont admis à concourir. Ils devront alors prendre l’engagement de s’interdire à jamais les jeux de bourse. Ce jour-là il y aura des chances de misère de moins.
Quoi qu’il en soit, il est hors de doute que l’esprit n’est pas en faveur. L’école naturaliste aide-t-elle à cette dépréciation du génie national, ou se borne-t-elle à la refléter dans une photographie exacte ? C’est là une question qui demanderait un développement un peu long et que je signale, sans l’aborder.
Comme il y a loin de l’esprit du dix-huitième siècle à ce qu’on applaudit aujourd’hui comme spirituel !
Nous avons eu d’abord l’esprit de Voltaire, qui rayonnait par lui-même, en résumant celui de tous les maîtres antérieurs, mais qui se gardait bien de chercher des mots, de tailler des facettes.
Puis nous avons eu l’esprit de Beaumarchais, qui, moins puissant, avait besoin de s’affiler, de chercher des formules et qui était déjà une décadence.
Aujourd’hui c’est l’assonance des mots, plus que les rapports inattendus entre les choses, qui constitue l’esprit. On disloque la grammaire ; on substitue la contorsion, la gymnastique au jet vif et naïf des pensées.
Voulez-vous un exempte ?
Dernièrement, dans une comédie très justement applaudie, à ce qu’il paraît, pour la vigueur des situations, pour la franchise des lieux communs, on servait aux spectateurs enchantés des mots comme ceux-ci :
Un personnage est accusé de comparer entre eux des gens peu semblables.
« Je ne les compare pas, dit le héros, Je les sépare. »
Le parterre applaudit avec chaleur.
Dans un autre endroit, on parle d’un homme économe et d’un dissipateur : l’auteur fait dire à un troisième personnage :
— L’un gère la fortune, et l’autre la digère.
La salle entière a retenti d’applaudissements. On a trouvé cela supérieurement spirituel. Il y a trente ans une pareille insanité eût été sifflée. On laissait aux farces de dernier ordre ces jeux de mots qui se résumaient par celui-ci.
— Que dit le pain quand on le coupe ?
— Il di minue.
Ce qui était alors une drôlerie sans conséquence est devenu une plaisanterie excellente et relativement raffinée.
Le théâtre, aussi, pour sa part, aura beaucoup aidé à cette dégringolade de l’esprit.
La fausse maîtresse
On était plus difficile, quand il arriva à un de nos confrères, rédacteur en chef d’un journal qui n’est jamais à bout d’esprit, ce périlleux embarras.
Il dînait en joyeuse compagnie. Entraîné par les épanchements que la table explique et prétend justifier, il était arrivé à parler d’une dame célèbre par sa beauté et par sa bonté.
— Ah Mme X…, dit-il tout à coup, je l’ai beaucoup connue. Elle a manqué d’être ma maîtresse !
Un convive se leva furieux. Il avait le droit de l’être, comme parent ou comme ami.
— Monsieur, répétez ce que vous venez de dire ! s’écria-t-il très pâle et très menaçant.
Le journaliste en question, qui était aussi un romancier de talent, comprit qu’il avait été trop loin pour reculer ; il sourit et répliquant à son interlocuteur :
— Je le répéterai volontiers, car si Mme X… n’a pas été ma maîtresse, c’est qu’elle n’a pas voulu.
L’honneur de la dame était sauf et l’esprit du journaliste aussi.
Rachel
Dans ce temps-là, les actrices étaient spirituelles. On les citait pour leurs mots, et non pour leurs prétentions.
On publiera quelque jour la correspondance de Rachel10, qui ne se vantait pas de savoir l’orthographe, et qui pourtant écrivit des lettres qui sont des chefs-d’œuvre de grâce, de simplicité, j’oserai dire d’ingénuité. Elle avouait très bien elle-même son manque d’instruction. Dans le post-scriptnm d’une lettre adressée à M. Émile de Girardin, elle disait :
« Ma plume est bien bonne aujourd’hui ; je ne fais presque pas de fautes… »
N’est-ce pas digne de Mme de Sévigné ?
Je crois qu’on se décidera également à faire paraître la correspondance de cette comédienne charmante qui interpréta les dernières œuvres d’Alexandre Dumas fils et qui devint célèbre au théâtre, après avoir beaucoup expérimenté la vie, et beaucoup souffert, ailleurs que sur les planches.
On y trouvera cet aveu douloureux, exquis dans sa crudité apparente. Comme on lui demandait si elle avait aimé certaine personne, elle répondit :
« Je n’en sais rien. J’avais été vendue si souvent que j’ai pris pour de l’amour ce qui n’était que le plaisir de me donner. »
N’est-ce pas d’un raffinement adorable dans sa brutale mélancolie ? Trouvez-moi aujourd’hui beaucoup d’actrices capables d’en écrire autant, après en avoir fait davantage ?
L’esprit politique
Oui, l’esprit est un peu égaré en ce moment, et si je voulais étendre le cadre, élever le ton d’une simple causerie sur la vie parisienne, je pourrais ajouter que l’esprit politique est aussi absent de France que l’esprit littéraire et l’esprit mondain.
Ces grands efforts pour chercher à constituer une majorité de gouvernement, ces prétentions pour rester divisés, tout en voulant s’unir, ces embarras singuliers quand il faut constituer un ministère, ne prouvent-ils pas, malgré le nombre des gens de talent et de bonne volonté qui sont dans les Chambres, que l’esprit parlementaire est devenu rare ?
Mais je me hasarde là sur un terrain spécial, que je ne veux pas aborder, qui me conduirait trop loin, et que je me hâte de quitter.
Les comédiens et la folie
Est-ce parce que l’esprit n’est plus de mode que les comiques deviennent rares au théâtre, et que les plus fins perdent la tête, comme ce pauvre Gil Pérès11.
On a raconté qu’il avait été ramené chez lui dans un état alarmant.
Il n’est pas le premier qui soit devenu fou, à force de vouloir dérider ses contemporains.
Les acteurs tragiques, confits en dignité, vivent longtemps, gardent presque toujours jusqu’à la fin ce sentiment de satisfaction qui les conserve. Quelques vers solennels, qui produisent toujours la même impression sur le public, leur suffisent. Ils ne doutent jamais d’eux-mêmes, ne doutant jamais de leurs effets12.
Mais les comiques, les grotesques, ceux qui doivent varier la caricature humaine, en la faisant toujours applaudir, et qui sont condamnés à un effort continu pour être plaisants, sans devenir jamais déplaisants, ceux-là ne sont jamais sûrs du lendemain. Ils ont l’inquiétude perpétuelle de leur rire, l’ambition de leur grimace. Ils s’usent à se moquer de ceux qui les applaudissent.
Je suis certain que, si l’on cherchait parmi les comédiens, on serait stupéfait de la quantité de comiques qui sont devenus fous.
N’avons-nous pas vu Monrose13, amené sur les planches du Théâtre-Français par le docteur Blanche, et jouant le Mariage de Figaro, entre deux douches ? On essayait de le guérir, par le moyen qui l’avait rendu fou.
Les cercles
Parmi les causes de l’abêtissement général, il ne faut pas oublier les cercles. Je n’exclus pas de la nomenclature les cercles les plus ingénieux à organiser, soi-disant, des fêtes de l’esprit.
Le jeu y lutte d’une façon triomphante contre la causerie, l’amusement des mots. Depuis qu’on a aboli en France, par un sentiment de moralité plus naïf que raisonné, toutes les maisons de jeux et les loteries, on a développé dans des proportions effrayantes les tripots clandestins où la police ne pénètre guère, et on a transporté la loterie dans toutes les spéculations de la Bourse.
Deux ou trois établissements de roulette à Paris, publiquement autorisés et surveillés, feraient moins de mal (je n’ose dire feraient plus de bien) que ces dix mille tripots toujours poursuivis, sans cesse renaissants, qui échappent à la loi, et que ces cercles où les honnêtes gens ne peuvent se garantir par des règlements assez sévères.
Un de ces jours je ferai, pour le lecteur, un voyage à travers les cercles de Paris, comme on en fait de temps en temps pour édifier les étrangers, dans les grands égouts.
Croirait-on qu’un des cercles les plus élégants se laisse nommer le Cercle du Péloponnèse, à cause des grecs qu’on peut y rencontrer14 ?
Changement de programme
La girouette des théâtres, celle des théâtres d’opérettes, surtout, a brusquement tourné.
Il y a quelques années on ne nous racontait que des nuits de noces. La Jolie parfumeuse15, auparavant la Fille de Mme Angot16, et toute la série qui avait suivi, prétendaient nous intéresser aux mésaventures d’un marié et d’une mariée, le soir de leur première journée de ménage.
Aujourd’hui, il n’est plus question que d’épisodes guerriers. Les Tambours-Majors17, les Voltigeurs18 piétinent sur la fleur d’oranger. Des théâtres d’opérette, les militaires montent à l’assaut des grands théâtres. Hier le Châtelet ajoutait des défilés de troupes aux aventures du Beau Solignac19, et, ce soir ou demain, l’Ambigu, qui a fini la lessive de l’Assommoir, va nous montrer la vie et la mort de Turenne, avec de vrais canons du dix-septième siècle20.
À la bonne heure ! Je ne haïs pas ces invasions. Elles sont un spectacle amusant pour les yeux, et forcément, en mettant le courage en scène, elles nous servent une moralité plus ou moins grosse, mais franche et saine21.
Mœurs de la Comédie-Française (suite)
Le bruit avait couru22 que les bénéfices considérables de la Comédie-Française pour l’année écoulée allaient déterminer la commission du budget à une petite économie et que l’on cesserait de subventionner le premier théâtre du monde, celui qui est toujours le plus digne d’encouragement.
La mesure serait pitoyable à tous les points de vue. La France est assez riche pour ne pas regarder à quelques centaines de mille francs, et l’on condamnerait le Théâtre-Français à une spéculation perpétuelle, à une préoccupation continue des gros bénéfices, au détriment du souci littéraire et artistique, en faisant dépendre uniquement la fortune des recettes du répertoire.
Les gros bénéfices dont on s’indigne presque, eussent-ils été possibles sans la subvention ? Si une année malheureuse, par la faute des pièces, par un hasard quelconque arrivait, laisserait-on les comédiens associés se mettre en faillite et ne serait-on pas obligés, pour l’honneur de la France, de combler le déficit ?
Pourquoi ne pas conserver cette garantie contre les mauvais jours, et assurer, comme par le passé, la sécurité des grandes études de répertoire, l’ambition des belles œuvres ?
Les Lettres de Ximénès Doudan
Je finis par la primeur d’une nouvelle littéraire. On sait le succès obtenu par la correspondance de M. Doudan23, ce causeur inconnu, dont la renommée n’était pas sortie, de son vivant, du cercle de l’hôtel de Broglie24.
Il paraît qu’on a retrouvé un petit manuscrit inédit de cet observateur ingénieux. C’est un recueil de pensées25. Il va sans dire qu’il y aura bien des épigrammes dans ces pensées.
Pourvu que les appariteurs de ce nouveau volume ne remettent pas à l’imprimeur un manuscrit revu, corrigé et diminué.
Le Spectateur
Notes
1 Parmi les académiciens de ce temps on peut penser à Auguste Barbier, Octave Feuillet, Paul de Noailles ou Xavier Marmier…
2 « Vous rappelez les vers irritants où il [Jonathan Swift] montre les balayeurs dans les rues, les recors aux aguets, le mouvement et les cris de la halle. S’il pleut, n’a-t-il pas à nous offrir, en outre, le spectacle des ruisseaux débordés, des chats morts, des feuilles de chou, des poissons pourris roulant pêle-mêle dans la fange ? C’est la poésie traînée non seulement dans la boue, mais dans l’ordure. Il s’y roule, dites-vous, et il en éclabousse les passants. Nous voilà bien loin d’Homère et bien près de nous, hélas ! »
3 À cause de son roman un peu autobiographique Notes sur Paris : vie et opinions de M. Frédéric Thomas Graindorge (Hachette 1867), Hippolyte Taine a souvent été surnommé Graindorge.
4 Allusion à la Galerie des contemporains illustres par un homme de rien, de Louis de Loménie, parue en fascicules d’une trentaine de pages sans autre nom d’auteur entre 1840 et 1847 puis rassemblés en dix volumes.
5 Adhémar de Guilloutet (1819-1902), député des Landes de 1867 à 1870 puis de 1876 à 1893. En février 1868, Adhémar de Guilloutet présenta un amendement sur les délits de presse.
6 Voir « Le bal de Juliette Lambert » dans La Vie à Paris du treize janvier 1880. Les notes antérieures ne sont pas reprises.
7 Un chicard est un « Personnage de carnaval se livrant à des danses grotesques dans les bals masqués, en vogue dans la deuxième partie du XIXe siècle » selon le TLFi, qui cite : « Peu de monde dans la salle, quelques épaves de Bullier ou du Casino, vierges folles suivant l’armée, chicards fanés, débardeurs en déroute, et cinq ou six petites blanchisseuses » A. Daudet, Tartarin de Tarascon, 1872, p. 85. À l’entrée Débardeur, Le Trésor cite : « Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Un costume de débardeur, cela se compose d’une chemise de soie… flottante… et d’une petite… d’un petit pantalon de velours ou de satin… Je ne sais pas trop… » Meilhac, Halévy, Froufrou, 1869, acte II, scène IV, p. 50.
8 L’opéra qui se trouvait au douze rue Le Pelletier depuis 1821, détruit par un incendie en octobre 1873.
9 Un concours pour lutter contre le paupérisme organisé par Isaac Peirere, seul survivant en 1880 des deux frères, banquiers et homme d’affaires extrêmement riches.
10 Voir Georges d’Heylli, Rachel d’après sa correspondance, Librairie des bibliophiles, 338 rue Saint-Honoré, 1882, 308 pages. Cet ouvrage nous apprend, page 263 que Rachel (1821-1858), morte à 37 ans, a légué par testament, à Émile de Girardin, une plume en or. On pourra lire dans la prochaine Vie à Paris un intéressant portrait d’Émile de Girardin.
11 Gil-Pérès (Charles-Jules Jolin, 1822-1882), humoriste débridé et comédien très apprécié. Le Voltaire a publié le 22 janvier dernier dans sa rubrique des théâtres de la page quatre, cette note qui a été reprise par plusieurs journaux, dont Le Temps du même jour : « Nous apprenons une triste nouvelle, Gil Pérès, le joyeux Gil Pérès, est fou ! / Si l’on s’en souvient, il y a de cela trois ans, à peu près, le bruit de la folie de Gil Pérès avait déjà couru. II vint lui-même, le lendemain, prier les journaux de rectifier. Tous rectifièrent. / Cette fois, malheureusement, il n’y a plus doute à avoir. L’accès lut a pris avant-hier soir, au café des Bouffes. Il avait, quelques heures auparavant prêté vingt mille francs à un ami et depuis s’imaginait ne plus les voir. C’est ainsi qu’il s’installa d’abord à une table du café susdit, écrivit une lettre réclamant l’argent prêté, puis eut un rire insensé. / Le mal était déclaré. / Gil Pérès a été reconduit chez lui où on craint de ne pas pouvoir le garder. » Lire aussi la « Chronique » de Jules Claretie dans Le Temps du cinq juin 1880, page deux.
12 Chronique de Paul Léautaud parue dans le Mercure de France du premier février 1905 : « Il faut avoir vu M. Mounet-Sully prendre un fiacre. Les marches du palais d’Œdipe, au cinquième acte, ne sont rien à côté du trottoir à descendre et du marchepied de la voiture à franchir. »
13 Monrose (Claude Barizain, 1783-1843), entré à la Comédie-Française en 1815, sociétaire en 1817, retraité en 1842. Monrose « est, malgré sa petite taille, l’interprète idéal des valets habiles, fourbes et spirituels. Scapin et Figaro sont ceux où il montre le plus de mordant et de naturel. […] D’un caractère naturellement hypocondriaque, la mort de sa femme, en 1841, achève d’ébranler sa raison déjà défaillante. Il est soigné par le docteur Blanche, chez qui fut aussi interné Gérard de Nerval. Permission exceptionnelle lui est donnée de jouer Figaro du Barbier de Séville une dernière fois à sa représentation de retraite, et, par miracle, cet homme, devenu incapable de se souvenir même de son propre nom, retrouve, devant son public, juste le temps d’une représentation, toute sa mémoire et tout son talent. » (Notice de la Comédie-Française).
14 Il existait à Paris en 1885 deux-cent cercles de jeux clandestins, que fréquentaient nombre de voyageurs étrangers ce qui se traduisait dans les noms de ces clubs : Cercle Franco-Américain, Tourist-Club, Cosmopolitan Club, Cercle de France International, Cercle des deux mondes… Ce milieu attirait évidemment tous les tricheurs, qui étaient surnommés, on ne sait pourquoi, les Philosophes ou les Grecs… qui n’étaient le plus souvent ni l’un, ni l’autre.
15 La Jolie parfumeuse, opéra-comique en trois actes d’Hector Crémieux et Ernest Blum sur une musique de Jacques Offenbach représenté le 29 novembre 1873 au théâtre de la Renaissance.
16 Clairville, Paul Siraddin et Koning, La Fille de Madame Angot, opéra-comique en trois actes sur une musique de Charles Lecocq, créé le quatre décembre 1872 au théâtre des Fantaisies Parisiennes de Bruxelles puis à Paris le 21 février 1873 sur le théâtre des Folies-Dramatiques du boulevard du Temple. Jules Claretie a rédigé une notice historique pour l’édition Polo de 1875
17 Alfred Duru et Henri Chivot, La Fille du tambour-major, opéra-comique en trois actes sur une musique de Jacques Offenbach créé en décembre dernier aux Folies dramatiques.
18 Edmond Goudinet et Georges Duval, Les Voltigeurs de la 32e, opéra-comique en trois actes sur une musique de Robert Planquette créé à La Renaissance au début du mois de janvier.
19 Jules Claretie, Le Beau Solignac, grand roman d’aventures, Dentu 1876. Deux volumes : I. Andréina. II. Louise de Farges. Ce roman a été adapté au théâtre par Jules Claretie, William Busnach et Charles de La Rounat, puis créé au théâtre du Châtelet le douze janvier dernier. On peut comprendre que Jules Claretie, qui apprécie pourtant les militaires, n’a pas été heureux de ce « défilé de troupes » sans doute assez m’as-tu-vu. Dans sa chronique du Figaro du treize janvier, Arnold Mortier, le « Monsieur de l’orchestre » écrit : « Le Beau Solignac, sans être cependant une pièce militaire, a encore plus de soldats que les Voltigeurs de la 32e et La Fille du tambour-major réunis.
20 Peut-être une reprise. La Mort de Turenne, « pièce historique et militaire à grand spectacle, en trois actes mêlée de pantomimes, combats et évolutions », de Jean-Nicolas Bouilly, Jean-Guillaume-Antoine Cuvelier, représentée pour la première fois sur le théâtre de la Cité le 29 prairial an V (17 juin 1797).
21 Nous retrouverons souvent ce goût singulier de Jules Claretie pour les militaires.
22 Voir dans La Vie à Paris du treize janvier, le chapitre « Mœurs de la Comédie-Française ».
23 Ximénès Dourdan, Lettres, Calmann-Lévy 1879 quatre volumes. Ximénès Doudan (1800-1872), critique et moraliste. Voir aussi (non publiée ici) la Chronique de Jules Claretie dans Le Temps du treize août 1880 (page deux, colonne deux).
24 Cet hôtel de Broglie (prononcer « Breuil ») construit en 1720, de nos jours 73 rue de Varenne, est aujourd’hui la plus grande propriété de Paris. Mitoyenne du musée Rodin, elle est propriété du Maroc. Ximénès Dourdan y logeait en tant que précepteur.
25 Ximénès Dourdan, Pensées et fragments, suivis des Révolutions du goût, Calmann-Lévy 1881, 325 pages.
.
.
