Vie à Paris parue dans Le Temps du dix février 1880. Page mise en ligne le 14 octobre 2024. Temps de lecture 16 minutes. Les intertitres ont été ajoutés.
Hiver — Réception à l’Élysée — Louis-Sébastien Mercier et le brouillard — La question du divorce (suite) — Les médailles de François Walferdin — Émile de Girardin et Bernard Granier de Cassagnac — Une paire de faux saints — Pour les Polonais ! — La couronne de Mademoiselle Mars — Notes
Hiver
Quel drame, profond comme une œuvre de Shakespeare, varié comme une férie moderne, on peut faire et on fera peut-être sous ce simple titre : L’Hiver de 1879 !
Les contrastes les plus éclatants, les surprises les plus inattendues, les ironies les plus brutales de la nature, les efforts les plus héroïques de la volonté humaine, et, à travers des horreurs monstrueuses, des intermèdes gais, vifs, des échos d’orchestre coupant le roulement monotone de la tempête, des apothéoses dissipant un brouillard sinistre ; tels sont les éléments de cette pièce qui devrait tenter un poète, un machiniste et un peintre.
Tous les tableaux sont d’égale beauté dans leurs disparates.
C’est d’abord, au prologue, la neige qui tombe, épaisse, implacable, la neige de la déroute de Moscou, la neige que Byron a chantée et qui prenait dans ses plis des régiments entiers. On essaie de rire sous l’avalanche. Ces hirondelles, si gentiment costumées ou plutôt dénudées, que nous avons vues dans la féerie de la Gaîté1 et qui festonnaient des pas gracieux sur la fausse neige du théâtre, étaient un présage ; on pourrait les peindre sur les programmes.
Mais cette fois, elles n’ont rien à faire dans le prologue du drame, il n’y a pas de place pour elles ; si légers qu’ils soient, leurs petits pieds enfonceraient dans cette neige épaisse qui monte, monte comme si elle voulait atteindre aux mansardes et donner aux pauvres cette couverture blanche dont se contentent les fleurs, pour ne pas mourir.
Hélas ! il n’y a même pas d’abri pour le petit Savoyard de l’élégie de Guiraud2. L’hiver est plus romantique, et les vers médiocres qui ont ému notre enfance paraîtraient une impiété à l’effroi dont les cœurs sont saisis. C’est la consternation silencieuse, une sorte d’ensevelissement de la vie, sous un suaire, pour nous donner le frisson, l’idée de la mort du globe.
Tout à coup, avant la débâcle, une aurore s’allume dans la nuit ; des bruits de musique qui ne sont pas seulement les imprécations harmonieuses des furies de l’hiver à travers les squelettes des arbres, passent sur Paris. On va, on court à une fête ; l’Espagne est en serre chaude au milieu de Paris gelé ; l’été est évoqué pour une nuit, et le plaisir, narguant la misère, la console, l’adoucit, se fait ingénieux pour l’alléger. Il fleurit de l’or sur la neige.
La débâcle arrive alors, pour fournir un décor nouveau, incomparable. Tout ce que l’imagination des dramaturges a inventé, depuis soixante ans, en fait de banquise, est dépassé. La Seine charrie des berceaux, et l’on s’attend toujours, comme dans la Prière des Naufragés3, à voir un petit enfant à genoux sur un glacier.
Quand la neige a cédé et n’est plus que de la boue dont Paris s’affranchit, on sent que le printemps aura à travailler, plus que les hommes, pour réparer les ruines de la nature. Tous les rosiers sont morts, tous les arbres qui prétendaient entretenir l’illusion de l’île de Calypso, avec leur verdure éternelle, sont flétris, desséchés. Où trouvera-t-on des rosiers, des arbres verts ? Cette fois l’élégie sentimentale, moins poignante depuis l’adoucissement de la température, porte à la rêverie. C’est le point culminant du drame où l’action semble se concentrer pour se précipiter ensuite.
En effet, après les neiges, les glaces, la débâclé, voici que le brouillard descend, épais, compact, mur blanc pour lutter contre le souvenir de la terre blanche. On marche à tâtons ; on s’arrête, et tout à coup dans cette nuée, seule visible, qui nous cache tout, il se fait un déchirement effroyable.
Ah ! ce décor d’hier, je l’ai vu, et je voudrais être peintre pour le reproduire.
L’horizon formé par cette brume qu’on ne peut comparer à rien, des entassements de débris faisant une ombre sur ce ciel à portée de la main ; au milieu du chemin, un brasier ; tout autour des épaves sanglantes et des hommes errants, avec des falots, des torches ; dans la profondeur de cette nuit à l’opacité grise, des cris, des rumeurs, et de temps en temps se mêlant aux voix humaines, confuses et enrouées par la peur, la voix stridente, formidable de la machine, qui proclame sa colère, qui menace l’homme écrasé par elle, comme l’éléphant qui tient son dompteur sous son pied, ou comme le lion qui rugit après avoir broyé les chasseurs !
Est-ce tout ? le drame va-t-il finir sur ce tableau désespéré ? Non. La vie a ses droits imprescriptibles, et dans ce brouillard qui se dissipe, rayonne subitement, comme apothéose finale, le chiffre de la République française, au-dessus d’un palais étincelant.
Réception à l’Élysée
C’est l’Élysée qui convie à ses fêtes toutes les gloires, toutes les activités de la patrie, tous les témoins ayant reçu mandat de la France, de l’Europe, de l’Amérique, de l’Asie, de l’Afrique, pour juger de nos efforts, de notre désir de concorde, de notre vaillance dans le travail, de notre belle humeur supérieure à nos chagrins4.
Là, comme dans les tableaux qui couronnent les féeries, on voit se mêler tous les costumes, toutes broderies, se coudoyer tous les personnages qui ont joué un rôle dans l’histoire sérieuse ou plaisante de l’année, s’unir, du moins devant le buffet, les princes détrônés et leurs vainqueurs, les reines dépossédées et les femmes des républicains qui montent, tandis que l’orchestre, qui joue pour tous les régimes, fait danser la jeunesse toujours pareille, et symbolise la perpétuité du bruit nécessaire aux hommes pour s’entendre, en ne pouvant plus s’écouter les uns les autres.
Voilà le plan du drame. L’apothéose a si complètement réussi qu’il serait bien malheureux d’avoir à ajouter un épilogue.
Louis-Sébastien Mercier et le brouillard
Sait-on comment au siècle dernier les Parisiens, surpris par le brouillard s’arrangeaient pour rentrer chez eux ?
Mercier, dans son Tableau de Paris, indique un moyen qui n’est venu ces jours-ci à l’esprit de personne.
Je cite textuellement :
« Dans une année, les brouillards furent si intenses, qu’on s’avisa de louer à l’heure des quinze-vingts qui vous guidaient en plein midi dans tous les quartiers. On leur donna jusqu’à cinq louis par jour, ces aveugles connaissant mieux la topographie de Paris que ceux qui en avaient gravé ou dessiné le plan. Or voici comment on voyageait dans ces brumes qui dérobaient la vue des rues et des carrefours.
« On tenait le quinze-vingts par un pan de sa robe, et, d’une marche plus sûre que celle des clairvoyants, l’aveugle vous traînait dans les quartiers où vous aviez affaire5. »
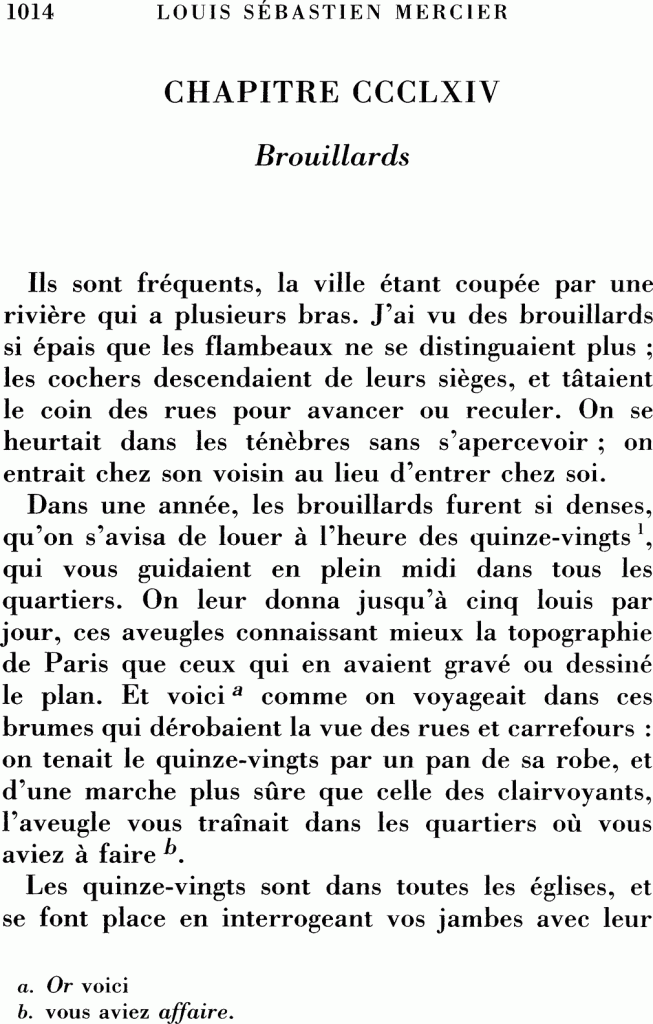
⁂
Que dites-vous de ce procédé ? On a vu quelquefois des aveugles diriger, comme on dit, le char de l’État. Mais on sait qu’en politique il n’est pas toujours nécessaire de savoir où l’on va, pour y arriver. L’emploi des aveugles en guise de conducteurs dans la rue me paraît un remède d’une efficacité douteuse.
Du divorce et de la concision
Le livre d’Alexandre Dumas fils6 est toujours le grand succès de librairie, et pour les âmes dévotes le grand scandale du moment. Je n’ai certes pas l’intention de toucher dans ces notes rapides à la grosse question du divorce. Je n’ai pas non plus à analyser le spirituel, charmant et parfois émouvant plaidoyer de l’auteur du Demi-Monde7.
Je veux seulement faire une remarque, au point de vue littéraire ; c’est que si le livre en question est toujours écrit avec la correction de style d’Alexandre Dumas fils, il est composé des phrases les plus longues, les plus laborieuses que l’auteur ait jamais écrites et que l’on ait publiées depuis longtemps.
Ce n’est pas un reproche que je formule, c’est une observation que je fais, pour prouver avec quel soin, quelle crainte de lui-même, l’écrivain a traité ce sujet. Balzac, qui se retouchait sans cesse, et Sainte-Beuve8, qui obscurcissait parfois sa pensée par les éclaircissements infinis dont il l’enveloppait, avaient déjà prouvé l’influence d’un travail consciencieux dans les esprits qui veulent philosopher, sans être philosophes par brevet.
Pour ses romans, pour ses pièces, Alexandre Dumas fils a une plume vive, alerte. Le trait jaillit ; le geste est rapide. Dans son livre sur le divorce, la sève, toujours la même, circule avec plus de lenteur. Il y a beaucoup de phrases comme celle de la page 23 qui contient 24 lignes.
Mais le nombre de lignes ne fait rien à l’affaire, et l’on peut dire que dans sa forme plus languissante, le livre est amusant, curieux pour les recherches dont il a été le prétexte, très spirituel et très concluant.
M. Alexandre Dumas fils sait-il que la même thèse a été soutenue, beaucoup moins éloquemment que par lui, par le ministre de la guerre de la Convention, Bouchotte9.
En 1791, le futur créateur des grands généraux de la République, de Masséna, de Kléber, de Moreau, de Marceau, de Bonaparte, adressait à l’Assemblée nationale un mémoire sur la question du divorce au point de vue religieux. Il ne plaisante pas avec autant d’ardeur et de bonheur qu’Alexandre Dumas fils sur les arguments tirés de la Bible ; mais il veut attendrir les législateurs par le tableau même des grandes infortunes conjugales que la Bible et l’histoire profane ont constatées.
Il trouve que Job, sur son fumier, abandonné de sa femme, avait le droit de divorcer, et que Socrate, n’avait qu’à solliciter une enquête sur les procédés habituels de Xantippe10 à son égard pour obtenir le divorce. Cette argumentation pittoresque n’est peut-être pas celle qui convient le mieux à des législateurs modernes. Je crois que l’on se préoccupe moins, dans le monde, de la crainte de ne pas blesser le concile de Trente11 que de l’inquiétude d’organiser la famille moderne, même quand elle se désorganise.
M. Alexandre Dumas, comme Bouchotte, a cédé au plaisir d’embarrasser les théologiens. C’est un plaisir qu’il se donne et qu’il nous procure, mais qui ne comptera pas beaucoup, lors de la discussion parlementaire.
Mercier, que j’ai feuilleté à propos du brouillard dans Paris, au dix-huitième siècle, a aussi un chapitre instructif sur les mauvais ménages qui auraient eu besoin du divorce.
De son temps, un couvent établi rue Saint-Denis, sous le nom de Saint-Chaumont, servait de refuge aux femmes mal mariées qui voulaient plaider en séparation. Les avocats abondaient au parloir. Le mari n’était jamais désigné dans les conversations que sous le titre de l’adversaire.
Les religieuses, devenues expertes, décidaient en premier ressort et préparaient l’opinion des juges. De grandes consolations étaient offertes, en attendant le jugement, aux victimes de la tyrannie conjugale. On les faisait jouer, chanter, dîner, pour leur donner la force de proclamer leur martyre, et, quand la séparation semblait presque impossible, on conseillait aux plaideuses de pousser la modestie jusqu’à feindre des torts ; on leur prêtait une calèche ; l’amant était prévenu, et fouette cocher ! le mari était puni ou forcé à la séparation.
Les médailles de François Walferdin
En annonçant la mort de M. Walferdin12, on a parlé de ses titres scientifiques, de son amour pour Diderot dont il a été l’éditeur, de son culte pour Fragonard dont il avait collectionné les œuvres. Mais on n’a pas assez insisté sur la grâce, vraiment extraordinaire, de ce vieil amateur de l’esprit philosophique.
II avait une tête, comme Greuze les aimait et les arrangeait, un visage sensible, des yeux expressifs une bouche qu’une ironie douce avait accentuée.

Buste de François Walferdin surplombant sa sépulture, au cimetière du Père Lachaise, photographié en 2012 par Pierre-Yves Beaudouin
Il était célèbre par une plaisanterie qui a duré longtemps, mais qu’il n’a pu continuer jusqu’à sa mort.
Il avait, lors de l’inauguration du monument de Molière, rue de Richelieu, acheté une quantité, relativement considérable, de petites médailles frappées à cette occasion. Elles portaient toutes l’effigie de l’auteur de Tartuffe, et, autant que je puis me le rappeler, le-titre aussi de ce chef-d’œuvre.
Toutes les fois qu’il était contraint, par une relation de famille ou du monde, d’assister à un mariage ou à un enterrement, M. Walferdin ne manquait jamais de déposer discrètement dans la bourse des quêteurs ou des quêteuses une de ces petites médailles, souriant en lui-même de la surprise ménagée au caissier de la sacristie.
Mais M. Walferdin vécut plus longtemps que son trésor d’épigrammes. Vers la fin de sa vie, il n’avait plus de médailles ; pourtant, comme ses amis connaissaient ses habitudes et se faisaient un plaisir de le voir glisser toujours, enveloppée d’un papier discret, la fameuse petite pièce, il ne voulut pas les désappointer ni paraître désarmé. Pour le principe, pour le respect de sa protestation antérieure, il continua, à toutes les cérémonies qu’il était obligé de subir, de déposer ostensiblement une offrande qui faisait sourire ses amis. Un jour, par je ne sais plus quelle circonstance, on vit ce qu’il dissimulait dans le papier ; on s’informa à la sacristie, où la médaille de Molière ne se trouva pas, et l’on acquit ainsi la preuve que ce bon M. Walferdin, pour sembler protester quand même, lorsqu’il ne pouvait plus protester, enveloppait diplomatiquement une pièce de cinquante centimes dans du papier et la laissait tomber dans la bourse.
Il donnait ainsi, par amour de la libre pensée, plus qu’un dévot ordinaire, et il contribuait à l’entretien de l’église, pour rester fidèle à ses ennemis.
Émile de Girardin et Bernard Granier de Cassagnac
Je crois n’enfreindre aucune convenance en rappelant, à propos de la mort de M. Granier de Cassagnac13, un fait qui le concerne et qui doit être consigné dans l’histoire des grandes polémiques du règne de Louis-Philippe.
M. Granier de Cassagnac était en lutte contre M. E. de Girardin14 ; le journal l’Époque tirait à mitraille sur le journal la Presse, et celui-ci ripostait à boulets rouges contre l’Époque.
Il était tout naturel que les deux adversaires, se trouvant dans le même salon, ne fussent pas tentés de pousser la courtoisie jusqu’à se tendre la main ; j’ignore même s’ils se saluaient.
Un soir, chez Victor Hugo, dans ce grand salon de la place Royale15, dont le souvenir fait palpiter bien des cœurs qui commencent à ralentir leurs mouvements, les deux polémistes se trouvaient mêlés à une nombreuse et illustre société. Ils paraissaient ne pas se connaître.
M. de Girardin, le lorgnon dans l’œil, guettait de loin, en souriant, le directeur de l’Époque, et celui-ci, sans en avoir l’air, ne perdait pas un instant de vue son vaillant antagoniste.
Vers minuit, quand l’heure du départ fut sonnée, les habitués du salon se retirèrent ; mais les deux adversaires, ne voulant pas se céder le terrain, demeurèrent presque les derniers. C’était à qui des deux ne partirait pas le premier.
Enfin, cependant, M. de Girardin se décida : il s’apprêta à sortir. Il dut passer devant le fauteuil de M. Granier de Cassagnac. Il ne parut pas l’apercevoir ; quand, tout à coup, arrivé en face de lui, il s’arrêta, salua, sans ironie, mais on accentuant son salut, et dit :
— Adieu, monsieur de Cassagnac !
Celui-ci tressaillit. Que signifiait cette politesse imprévue ? Ce n’était pas une offre de réconciliation. Ce ne pouvait être une faiblesse de la part d’un si intrépide adversaire. Il fut rêveur pendant quelques instants, après le départ de M. de Girardin, et se retira fort troublé.
J’ignore ses réflexions en route et pendant la nuit. Mais quand, le lendemain, il se rendit au journal l’Époque, à l’heure où sa collaboration devenait nécessaire, M. Granier de Cassagnac eut l’explication de ce salut de M. de Girardin. Il apprit que le directeur de la Presse avait acheté son journal, et enclouait ainsi pour toujours les canons qui le mitraillaient. M. de Girardin n’avait pu résister, la veille, à la petite malignité de dire adieu à l’ancien rédacteur de l’Époque, qu’il congédiait.
Je ne me souviens plus de la revanche que dut prendre ou que dut essayer M. Granier de Cassagnac, mais je crois pouvoir affirmer l’authenticité de l’anecdote que je raconte.
Une paire de faux saints
Je viens de rencontrer un lycéen furieux. On avait parlé de remplacer le dîner de la Saint-Charlemagne16 par une poignée de main affectueuse, et les divers proviseurs devaient être chargés de dire à leurs élèves : — Je suis content de vous ! Ce témoignage d’estime paraissait médiocre à certaines consciences gourmandes. Est-ce que le naturalisme aurait commencé déjà ses ravages dans la jeune génération, et l’estomac jouerait-il un rôle prépondérant dans la vanité des lauréats ?
Fallait-il supposer au contraire qu’on avait trouvé un prétexte, une occasion de supprimer un saint d’allure assez équivoque, et que saint Charlemagne allait quitter le calendrier de l’Université, comme saint Napoléon17 a depuis longtemps abandonné celui des fonctionnaires.
Voulait-on que dans cet hiver désastreux les enfants fussent initiés aux premiers éléments de solidarité humaine ? Prétendait-on les faire philosopher en action et donner leur plaisir en offrande aux malheureux ?
L’idée eût été excellente, mais elle eût peut-être gagnée à être suggérée plutôt qu’imposée aux élèves ; et il eût peut-être mieux valu trouver un moyen de manifestation charitable qui pût être pratiqué par tous les élèves, par ceux qui ne vont pas d’ordinaire au banquet de la Saint-Charlemagne, comme par ceux qui y ont leur place marquée d’avance.
Pour les Polonais !
Je me souviens que dans ma jeunesse (je puis avouer qu’il y a longtemps de cela), à propos d’une insurrection polonaise18 qui fit de nombreuses victimes, et qui provoqua des souscriptions en France, pendant que nos mères faisaient de la charpie pour les blessés, nous eûmes au collège l’idée d’abandonner nos prix pour qu’ils fussent vendus au profit des Polonais.
Ce fut un élan superbe. Il fallait voir chaque élève, à l’appel de son nom, monter fièrement sur l’estrade, et quand on lui tendait le livre doré sur tranche, avec la couronne, prendre la couronne et repousser le livre en disant tout haut : — Pour les Polonais ! Puis le vainqueur descendait, la couronne au front ou au bras, rejoindre ses camarades, au milieu des fanfares, des bravos, des attendrissements. L’orchestre jouait la Marseillaise ; car cela se passait sous Louis-Philippe, et le chant révolutionnaire et national n’était pas suspect sous la monarchie, comme il l’est devenu sous la République19.
Remarquons que dans ce temps-là les couronnes qui n’étaient pas en papier et qui, faites avec du lierre ou du vrai laurier, n’avaient pas la solidité des couronnes en papier peint, ne promettaient qu’un trophée très éphémère. C’est égal, on était content ; mais je crois que l’orgueil d’avoir inventé ce renoncement dépassait la joie de l’accomplir.
Je ne crois pas que les lycéens de 1880 seraient très fiers de n’avoir pas trinqué à la Saint-Charlemagne. Ils n’auraient pas le mérite de l’abstinence, et, comme me le disait avec une ironie épouvantable un sceptique de douze ans, un grand nombre d’entre eux eussent été persuadés qu’on avait voulu seulement faire des économies de gigot et de vin de Champagne.
C’eût été horrible. Heureusement les gourmands en ont été quittes pour la peur.
Du reste, quand on supprimerait le veau gras dans les lycées, comme on a supprimé le bœuf gras dans les rues, je ne vois pas ce que les études auraient à perdre. L’infirmerie y gagnerait à coup sûr et l’indigestion traditionnelle disparaîtrait.
On a pu voir, d’ailleurs, décroître depuis longtemps l’institution de ce festin glorieux.
La couronne de Mademoiselle Mars
De notre temps, nous avions une représentation spéciale au Théâtre-Français, avec Rachel ou Mlle Mars20. Il nous fallait les premiers interprètes et les chefs-d’œuvre. Le parterre était envahi ; les couronnes abondaient, et c’est à une de ces représentations qu’un étourdi, ne sachant comment prouver à Mlle Mars son admiration, lui lança une couronne de pompes funèbres, en immortelles, s’imaginant attester ainsi la gloire, le souvenir, l’apothéose éternelle de Célimène.
Mlle Mars, qui prenait sa retraite quelques jours après21, faillit s’évanouir en scène. Le lendemain, Jules Janin22 écrivit un feuilleton indigné contre le lycéen irrévérencieux qui s’était permis de signifier à la grande artiste l’heure de son convoi23. On sut que l’élève était de Charlemagne24. Le digne proviseur, M. Poirson, procéda à une enquête sévère et on finit par découvrir que la prétendue impertinence était un acte de piété maladroite mais naïve.
Aujourd’hui, on ne jette plus de couronnes, et les spectacles choisis pour la Saint-Charlemagne montrent aux lycéens plus de mollets et de maillots que de talents à admirer.
Le Spectateur
Notes
1 Il s’agit du nouveau théâtre de la Gaîté, fermée par l’agrandissement de la place du Château d’eau et reconstruit en bordure du square des Arts et Métiers pour la rentrée de 1862 et toujours en activité de nos jours.
2 Alexandre Guiraud (1788-1847), Le Petit Savoyard, poème d’une vingtaine de pages, Alphonse Lemerre 1897.
3 Adolphe d’Ennery et Ferdinand Dugué, La Prière des naufragés, drame en cinq actes créé au théâtre de l’Ambigu-Comique le 20 octobre 1853. La brochure est parue la même année chez Michel Lévy
4 Sur la page « L’art de recevoir à l’Élysée » le Bottin mondain écrit : « Changement de décor sous la présidence d’Adolphe Thiers [Président d’août 1871-mai 1873], après la chute du Second Empire, dont les buffets maigrichons, sandwichs mal beurrés, gâteaux secs et sirop de groseille, font pâle figure. Madame Thiers, froide et compassée, ajoute à l’ennui des réceptions. Jules Grévy [Président actuel (janvier 1879-décembre 1887)], très économe, reçoit peu et mal : becs de gaz éteints à 22 heures pour hâter le départ des invités. Sadi Carnot est le premier président [décembre 1887-juin 1894] à utiliser la nouvelle salle des Fêtes pour recevoir. Il institue l’arbre de Noël de l’Élysée. »
5 Louis-Sébastien Mercier, Le Tableau de Paris, imprimé sans nom d’auteur à Neuchâtel puis à Amsterdam, de 1781 à 1788, en douze volumes. Une édition — indispensable — en trois volumes a été reprise en 1994 par Jean-Claude Bonnet pour le Mercure de France sur le modèle du Journal de Paul Léautaud de 1986.
6 Voir dans La Vie à Paris du treize janvier, le chapitre « Du divorce et de la nullité ».
7 Alexandre Dumas (fils), Le Demi-Monde, comédie en cinq actes créée au théâtre du Gymnase en mars 1855. Le texte de la pièce est paru la même année chez Michel Lévy (162 pages).
8 Charles-Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), a abandonné ses études de médecine en 1827 pour se tourner vers la critique littéraire. Élu en 1844 à L’Académie française grâce à l’appui de Victor Hugo qui, malgré cela ne fit pas son éloge dans son discours de réception. Sainte-Beuve est surtout connu de nos jours par ses Lundis, recueil d’articles publiés entre 1851 et 1862.
9 Jean-Baptiste Bouchotte (1754-1840).
10 Xanthippe, épouse de Socrate, demeurée le modèle de la mégère.

Entrée Xanthippe dans le Grand Larousse illustré de 1900
11 Il s’agit d’un des plus importants conciles de l’histoire de la Chrétienté, qui concernait la réforme de l’Église vers le protestantisme. Ce concile s’est tenu dans la ville italienne de Trente, tout au nord de l’Italie pendant dix-huit années, de 1542 à 1563 et a concerné cinq papes.
12 François Walferdin (1795-25 janvier 1880), député de la Haute-Marne (gauche modérée) de la Constituante d’avril 1848 à mai 1849.
13 Bernard Granier de Cassagnac (1806-31 janvier 1880), journaliste, quatre fois député « Majorité dynastique » du Gers de 1852 à septembre 1870 puis deux fois député « Appel au peuple » du Gers de 1876 à 1880.
14 Émile de Girardin (Émile Delamothe (1802-1881), va mourir en avril prochain. Fondateur du quotidien La Presse en 1836 il a aussi été député (gauche) à neuf reprises de 1834 à 1851 puis de 1877 à sa mort. On se souvient qu’Émile de Girardin a déjà été évoqué dans La Vie à Paris du 29 janvier dernier à propos de Rachel.
15 La place Royale a été renommée place des Vosges en 1792, ce département ayant été le premier à payer l’impôt sous la Révolution. La maison de Victor Hugo se trouve au numéro six où l’on peut la visiter.
16 Charlemagne n’est pas un saint reconnu par l’Église mais toléré pour ses bienfaits. C’est en 1661 qu’il devient le saint-patron de la Sorbonne. Par tradition il est devenu une sorte de saint-patron des étudiants qui l’on fêté le 28 janvier, qui était une journée libre. Même si cet hommage est largement tombé en désuétude l’Association des Lauréats du Concours Général semble perpétuer cette tradition.
17 Par le décret du 19 février 1806, « la fête de saint Napoléon et celle du rétablissement de la religion catholique en France seront célébrées, dans toute l’étendue de l’empire, le 15 août de chaque année. » Les bonapartistes inventaient donc la sainteté par décret. La chose n’a gère duré.
18 Il y a eu au moins deux insurrections polonaises dans la jeunesse de Jules Claretie, né en décembre 1840. Une en 1848 dont il peut se souvenir et une en 1863. Il s’agit peut-être de cette dernière.
19 La Marseillaise a été déclarée chant national par la Convention le 14 juillet 1795 avant de décliner sous le premier empire et davantage encore sous la Restauration. Elle est reprise par le peuple lors des Trois glorieuses de 1830. Comme elle a été le chant révolutionnaire de la Commune, elle est rejetée par la Troisième République. Ce n’est qu’en février dernier (1879) que ce chant national est réintronisé par le Président Jules Grévy. En 1911 sera décidée l’obligation de l’apprendre à l’école. Après une utilisation prudente sous l’occupation allemande, les autorités de la Libération la réintroduiront à l’école. Après plus de deux siècles d’utilisations alternatives, son air trop martial et ses mots guerriers interrogent quant à la pertinence de son utilisation comme hymne national d’un pays en paix.
20 Mademoiselle Mars (Anne Boutet, 1779-1847), est entrée à la Comédie-Française en 1795. Elle a été sociétaire en 1799 et retraitée en 1841. Pour Rachel voir la précédente Vie à Paris.
21 Le quatre avril 1841. Lire l’article de Jules Janin dans Le Journal des débats du lendemain : « Maintenant, c’en est fait du Théâtre-Français ; il est tout vide. Il a perdu, en vingt-quatre heures, sa supériorité incontestable, incontestée ; il a perdu sa popularité dans toute l’Europe, la perle de sa couronne est tombée. »
22 Jules Janin (1804-1874), romancier et critique dramatique, notamment au Journal des débats, où il est demeuré quarante ans. Jules Janin a été élu à l’Académie française en avril 1870 au fauteuil de Sainte-Beuve.
23 Journal des débats du premier février 1841, bas de la page deux, troisième colonne : « Donc, à la fin de la petite comédie, plusieurs couronnes ont été jetées à Mlle Mars. / Et parmi ces couronnes, il y en avait une qui avait été volée le matin même dans un cimetière, sur une tombe profanée, volée on ne sait par qui, par la même main invisible qui espérait ainsi attrister le dernier triomphe de Célimène ! […] La fatale couronne était donc là, moitié noire et moitié blanche, aux pieds de Mlle Mars ; et par un grand malheur, c’est celle-là que, l’acteur a ramassée et qu’il a présentée !… Mais si vous aviez vu quel geste sans indignation ! quelle réserve dans ce refus ! quel courage chez cette femme ! quelle peur de toucher à ces fleurs sacrilèges volées par un païen ! […] Mais le malheureux que cette fatale idée a poussé n’a pas joui de sa lâcheté. L’actrice n’est pas morte sur le coup, comme on l’espérait sans doute ; mais au contraire s’est-elle relevée plus puissante et plus forte. Au reste, bien peu se sont aperçus de ce crime ; le geste sublime de Mlle Mars a été regardé comme un caprice par le plus grand nombre ; on a pensé qu’elle refusait une couronne banale, et les applaudissements l’ont poursuivie bien longtemps après qu’elle eut quitté la scène. Si ce jeune, pétulant et honnête parterre avait pu voir de quelles immortelles funèbres était tressée cette couronne, la salle eût été démolie. » La « Petite comédie » évoquée par Jules Janin est La Suite d’un bal masqué, d’Alexandrine-Sophie de Bawr (Alexandrine-Sophie Goury de Champgrand, 1773-1860).
24 Du lycée Charlemagne, 14 rue Charlemagne, dans le Marais.
.
.
