Article paru dans Le Temps du 23 mars 1880 et mise en ligne le quatorze octobre 2024. Temps de lecture : 25 minutes.
L’édition Havard porte un « chapeau » en tête de chaque journée, chapeau qui n’est apparu dans Le Temps qu’à partir d’aujourd’hui, 23 mars. Il est souvent apparu difficile de rattacher les éléments de ce chapeau à une partie précise du texte et c’est pourquoi il n’en a pas été tenu compte ici.. Un nouveau chapeau est donc défini et renverra, comme pour les pages précédentes, aux intertitres ajoutés dans le texte.
Une différence des deux états des textes — celui du Temps qui est ici la référence, et la parution en volume — sera parfois indiquée.
Les visites aux ateliers — Le dernier jour des envois — L’atelier Gérôme — L’École polytechnique — Henri de Bornier — Eugène de Mirecourt — La veuve de Lakanal — Notes
Les visites aux ateliers
Les Parisiennes ont eu un but cette semaine : elles ont couru les ateliers des peintres. Ces visites aux maîtres en renom passent décidément dans les mœurs. Une élégante a son carnet d’atelier comme elle a son carnet de bal : à telle heure chez Henner1, à telle autre chez Detaille2. Il est de bon ton de parler d’avance et en personne experte d’un tableau que tout le monde n’a pas vu. Certains peintres se prêtent d’ailleurs de fort bonne grâce à ces caprices des mondaines. Ils ouvrent tout grands leurs sanctuaires, étalent sur le chevalet la toile encore embue3 et passent même, au besoin, une redingote et un pantalon gris-clair pour être aussi présentables que leur peinture. Je ne sais trop s’ils ont beaucoup à gagner aux éloges stéréotypés qui tombent des lèvres aimables de leurs visiteuses. C’est un peu toujours le même compliment banal, la même prédiction de succès, la même caresse faite à l’amour-propre et qui n’engage à rien. Leur lorgnon sur le nez, les belles visiteuses émettent doctoralement, devant quelque toile pleine de vigueur, de recherches et de trouble, des jugements dans le genre de celui-ci : « Décidément j’aime beaucoup votre genre ! » Cela dit d’un petit ton net et sûr de lui-même qui n’admet pas de réplique. Il faut s’incliner, et l’on s’incline.
Elles vont ainsi par caravanes dans les ateliers, les filles d’Ève éprises d’inédit, de fruits verts, de primeurs, de tout ce qui n’est pas encore le mets du public. Si la toile destinée au Salon par l’artiste est achevée, tout est bien ; il n’a qu’à savourer, devant son œuvre, les louanges qu’on ne lui marchande point, d’abord pour paraître connaisseur — ou connaisseuse, — ensuite par pure politesse. Mais s’il doit travailler encore, donner les derniers coups de pinceau, brosser un bout de ciel ou de terrain, ah ! le malheureux ! C’est devant tout ce monde qu’il lui faut fiévreusement achever le tableau. Sous peine de paraître un ours, un sauvage, un Huron qui ferme la porte de sa hutte, il est tenu de travailler comme en public, semblable en cela à ce pauvre diable de rapin tombé qui, naguère, enlevait un paysage « en cinq minutes » sur la scène d’un théâtre ou d’un café-concert.
Et c’est la faute ou la nécessité de notre vie moderne ! Il y a, entre les mondains et les peintres, une promiscuité d’existence qui donne aux premiers une sorte de teinture d’art et les rend capables de raisonner ou de déraisonner à tout propos sur la question : tandis qu’elle enlève aux seconds une bonne partie de ce recueillement qui assure à l’artiste la force véritable. Évidemment ce n’était pas ainsi que travaillaient les Delacroix, les Rousseau4, les Millet, ces espèces de fauves de l’art, enfermés dans leur atelier comme dans leur rêve ou perdus à travers champs comme des errants de l’idéal. Il semble que les peintres de la génération nouvelle, avec leur passion du bibelot, du japonisme, du succès de boulevard, soient auprès de ces rudes et timides travailleurs comme des étalagistes aimables comparés à des ouvriers solitaires. L’art, au surplus, se fait visiblement accessible, souriant, facile à vendre. Il n’est plus ni rébarbatif ni escarpé. L’objet d’art remplace l’œuvre d’art. Les boutiques de marchands de tableaux portent, sur leurs vitrines, les noms des peintres à la mode comme les grands magasins de nouveautés arborent, sur leurs affiches, les arrivages de porcelaine de Kyoto ou de tapis de Karamanie5. La pénombre discrète où se tenait, durant des années, un Léonard évoquant la Joconde, est désormais inconnue. Le peintre a pour lui la rue, le passage, le trottoir, le carrefour. Il a mieux que cela, et le nom du Palais de l’Industrie6 où se tient, chaque année, l’exposition des produits de la peinture caractérise excellemment le temps de fabrication artistique où nous sommes.
— Il y a tous les ans, me disait hier un grand artiste, un de nos derniers grands artistes, il y a la Foire aux Jambons, à la place du Trône, et la Foire aux Tableaux, aux Champs-Élysées !…
Le dernier jour des envois
Et, depuis trois ou quatre jours, en effet, tous les moyens de transport dont Paris dispose ont été mis en réquisition pour emporter vers le Palais de l’Industrie ces milliers de toiles fraîches qui iront s’accrocher je ne sais où après avoir causé tant de migraines aux visiteurs de l’Exposition. On eût dit, vers la rue Notre-Dame-des-Champs ou le Luxembourg, dans le quartier pictural de la rive gauche, ou sur la rive droite, le long du boulevard de Clichy et de la pente de la rue Pigalle, un transbordement gigantesque, quelque chose comme le jour du terme arrivant pour les tableaux. Sous les bâches de cuir des voitures de déménagement, sur les haquets7 à bras, les crochets des commissionnaires, à travers les portières des fiacres, on apercevait le rayonnement d’or des cadres de toutes dimensions, emportés là-bas, roulés comme un Pactole8 dont tous les grains de sable sont loin d’être des pépites. C’était, comme tous les ans, une hâte, une fièvre, une terreur de ne pas arriver à temps devant ce grand portail de pierre où tout s’engouffre, les chefs-d’œuvre s’il en est, et les croûtes qui ne manquent pas.

Exposition de sculptures dans la grande nef du Palais de l’industrie (192 mètres sur 48), en 1861. Photographie de Pierre-Ambroise Richebourg (1810-1875) (photo BNF). La statue équestre, par Louis Rochet (1813-1878), est dédiée à l’empereur Pierre Ier du Brésil
Qui n’a point vu l’escalier et les galeries du Palais des Champs-Élysées le dernier jour fixé pour l’envoi des tableaux, n’a rien vu. Paris n’a pas, je crois, de spectacle plus divertissant et plus curieux. C’est un afflux de tableaux, une cohue de toiles barbouillées, une sorte de halle artistique où les rapins remplacent la criée par des cris. Car il est encore des rapins. On les retrouve, ce jour-là, dans tout le débordement de leur gaîté et leurs explosions de jeunesse. Les chapeaux de feutre d’autrefois, les chapeaux pistons9, n’ont même pas tous disparu. Le rapin, cet être antédiluvien, ce mastodonte de vingt ans, réapparaît pour s’amuser, au dernier jour des envois. Tous les ateliers de Paris, atelier de Cabanel10, atelier de Gérôme11, atelier de Jules Lefebvre12, et les petits clans des indépendants, — les protestants, les intransigeants, les modernistes, les naturalistes, les impressionnistes, les sensationnistes — se déversent dans les salles où les garçons apportent, en cognant les épaules et les fronts et en bossuant les chapeaux, les tableaux à travers la cohue. Toiles hardiment découvertes ou timidement enveloppées de serge, portraits, paysages, scènes de mœurs, scènes historiques, les rapins guettent tout au débusqué, accrochant au passage un mot cruel ou gai qui restera fiché dans le tableau entrevu, qu’on répétera le jour de l’ouverture, qui sera désormais son étiquette.
Ah ! les malheureux peintres venant là pour suivre jusqu’au bout leur œuvre comme le père menant son enfant au collège ! Ils n’ont qu’à se boucher les oreilles, les infortunés, s’ils ne veulent pas entendre jaillir de ces bouches sans pitié le cri gouailleur des vingt ans qui s’amusent et l’épithète électriquement trouvée et qui tue ! Un portrait correct de jeune élégant serré dans sa redingote et tenant dans la main une badine passe, porté sur les épaules d’un commissionnaire : « Saluez l’amant d’Amanda13 ! » Une étude de jeune femme en blanc apparaît, timide comme une fiancée, toute pâle : « Mlle Blanc-de-Céruse en costume de mariée ! » C’est, au défilé de chaque toile, une fusillade de mots, une décharge incessante de gouailleries criblant les toiles. Et l’auteur est là, souvent, poignardé par ces inconscients qui s’amusent, et devant l’œuvre qui lui a coûté parfois tant de jours de fièvre, tant de nuits d’insomnie, entendant, comme une fusée sortirait d’un feu d’artifices, quelque plaisanterie plus distincte jaillir d’un formidable éclat de rire : « Oh ! cette tête !… Oh ! ce cobalt !… Au Cobalt incomparable !… L’auteur prendra un brevet d’invention !… Un brevet sans garantie de M. Bouguereau14 !… Et ça représente ?… La famille Bidard empoisonnée par des champignons15 !… Aussi quelle imprudence !… il faut toujours mettre une cuiller d’argent quand on fait cuire des cèpes16 ! »
J’en ai vu, de ces pauvres diables de peintres, vieux ou jeunes — avec des mentons imberbes ou des barbes de patriarches — écraser des larmes sous leurs paupières en passant ainsi, bombardés de quolibets, à travers la double haie des rapins qui regardent. D’autres fois la charge se fait plus aiguë. On porte en triomphe à travers les salles quelque malheureux bien et dûment convaincu d’avoir apporté et fait enregistrer une toile épouvantable. On lui décerne les honneurs ironiques. « Vive le Raphaël des Batignolles ! » Il se débat ; on le maintient, on continue, et tout pâle, emporté à travers cette foule goguenarde, la victime effarée assiste à cette raillerie publique de son œuvre, comme un coupable condamné au pilori.
Ils ont d’ailleurs, ces jeunes gens, des enthousiasmes vrais à côté de ces acclamations railleuses. Des œuvres inconnues, saluées au passage, sont, en une minute, devenues célèbres le jour même de l’envoi. Un beau tableau fait trou dans cet entassement de cadres. Dès qu’un morceau enlevé de main d’artiste apparaît, on accourt, on se range. Il y a des fronts qui se découvrent. On a de ces respects à dix-huit ans. Et c’est comme une escorte d’honneur qui, brusquement, se forme autour de l’œuvre. Les succès du futur Salon naissent parfois, désormais incontestés, classés, historiques, dans cette première heure de tapage, de brouhaha et de cohue.
L’atelier Gérôme
Les élèves de l’atelier Gérôme17 auront tous eu le loisir de faire du bruit dans ce dernier jour. Leur atelier est fermé. Ils se peuvent promener tout à leur aise, humer les grippes qui voltigent, comme des atomes, dans les rayons du soleil de mars, et voir, aux bois, feuiller les branches. C’est toujours une punition grave pour les jeunes peintres de n’avoir plus, durant tout un mois, les conseils et l’appui du Maître. Il faut peindre au hasard, loin de la place d’habitude, les plus acharnés à leur œuvre expiant ainsi la faute des turbulents et des fous.
Je croyais que les brimades d’autrefois, les scies faites aux nouveaux, les charges d’ateliers qui semblent remonter aux temps légendaires de Bouginier18, l’échelle où l’on attache le nouveau la tête en bas, la broche en dos, toutes ces variétés bestiales de la drôlerie, étaient abandonnées, comme des plaisanteries d’une autre époque. Mais point du tout. On continue à respecter ces traditions bêtes, dangereuses au besoin puisqu’elles ont, plus d’une fois, amené mort d’homme. On change encore volontiers le nouveau en martyr s’il a trop mauvais caractère. Tel peintre aujourd’hui célèbre a été laissé les pieds et les mains attachés à une chaise et le visage peint en noir d’ivoire, devant une boutique de la rue de Seine. Tel autre se vante d’avoir fumé un nombre considérable de pipes dans les narines des nouveaux mis en croix. Ces variétés de supplices chinois sont agréablement mises en pratique par les gens qui deviendront membres de l’Institut ou propriétaires avenue de Villiers. Tant d’esprit, on l’avouera, aboutit vite à la sottise.
J’ignore si la politique, un peu partout rencontrée à l’heure où nous sommes, se glisse dans les plaisanteries faites aux nouveaux de l’École des beaux-arts et si elle a été pour quelque chose dans la fermeture de l’atelier Gérôme, mais il est bien certain qu’elle se glisse, en cas de brimades, dans les mœurs nouvelles des élèves de l’École polytechnique. Il y a longtemps qu’on a dit que l’éducation de l’Université et l’éducation par le clergé arrivaient à former littéralement deux France. Avec les élèves que font entrer, chaque année, à l’École polytechnique les professeurs de la rue des Postes19, il est bien certain qu’il y a maintenant deux Écoles.
L’École Polytechnique
Cette vieille fraternité d’autrefois entre camarades d’une même promotion commence à n’exister plus guère. Assis sur les mêmes bancs, les polytechniciens sont séparés par un fossé immense. Il y avait jadis — il y a toujours — un major de l’École qui commandait, en frère aîné, réglait amicalement bien des différends, imposait à tous son autorité, sous forme sympathique. Maintenant, la minorité de la rue des Postes a son major à elle, à côté du major de l’École ; et le major de la rue des Postes, comme on l’appelle très ouvertement, va, me dit-on, prendre le mot d’ordre chez ses anciens maîtres. Ce sont précisément des élèves de l’École polytechnique qui, naguère, racontaient le fait suivant, très significatif à mon sens : tous les ans, à un moment donné, chaque élève comparaît sur la sellette devant ses camarades. C’est un usage. On lui adresse des questions, on lui reproche ses défauts. Il y a là comme une sorte de confession publique, et de portrait moral fait, tout haut, par les compagnons de travail, qui donnent souvent à réfléchir et permettent à plus d’un de se corriger. Or, au dernier moment, lorsqu’il s’est agi de faire comparaître ainsi devant leurs copains les élèves sortis de la rue des Postes, le major de l’École a présenté au major de la rue des Postes, afin de ne blesser personne, la liste des questions et celle des reproches que l’on comptait adresser à ses camarades subordonnés. La politique se trouvait à peine effleurée dans cette liste et il eût fallu être de bien méchante humeur pour s’en fâcher. C’est ce que répondit très spirituellement d’ailleurs le major de la rue des Postes. Et chacun de défiler alors sur la sellette obligatoire.
Mais, s’il faut en croire ce qu’on m’a conté — je n’affirme rien, je répète, et même un ancien polytechnicien m’assure que le récit est exagéré — on n’aurait point dans l’établissement de la rue des Postes accepté certaines plaisanteries avec autant de cordialité spirituelle que le major de la rue des Postes, et un des pères aurait alors répondu à son ancien élève, en examinant la liste des questions et des observations formulées d’avarice — par écrit — pour sauvegarder tous les amours-propres : « Il est des choses, monsieur, que, même en matière de plaisanterie, on ne se laisse jamais dire lorsqu’on a une épée au côté. »
Je sais bien que cette épée, tous ces jeunes gens, quelle que soit leur foi, la tireraient vaillamment pour le service de la France. Leur jeune sang est tout au pays. N’importe, il n’en est pas moins triste que des hommes d’une même génération vivent ainsi, côte à côte, sous le même uniforme, mais étrangers aux mêmes idées. Ils semblent, dirait Mardoche, n’avoir point le crâne fait de même20. Ils ont tous vingt ans, et les uns se tournent obstinément vers le passé, tandis que les autres contemplent l’avenir. Cette séparation si nette, cette coupure absolue, ne laissent point d’inquiéter bien des gens. L’histoire du major de la rue des Postes, que je l’aie, en tous ses détails, bien ou mal rapportée, est une preuve nouvelle de cette division complète qui s’accentue entre la France libérale, qui est la vraie France, et cette demi-France qui vieillit, enfermée dans la stérilité de ses regrets et de ses souvenirs.
Henri de Bornier
Paris, qui a besoin de vivre, et à qui les souvenirs n’ont jamais suffi, attend toujours quelque nouveauté, que ce soit un voyageur comme M. Nordenskiold, qui vient de réunir deux océans21, que ce soit un roman inédit ou un drame à sensation. On lui donnera presque en même temps Aïda, avec Verdi conduisant l’orchestre, et les Noces d’Attila, avec M. de Bornier, qui est pourtant le meilleur des hommes, chantant avec fureur la Chanson de la hache22, un pendant à la Chanson de l’épée de la Fille de Roland23.
… L’arme qui perce et qui brise,
Bonne à tout gigantesque effort,
Qui vole, broie, enfonce, arrache,
Je l’aime ! — Et je chante la hache
D’Attila, frère de la Mort !
Si M. Verdi conduit lui-même son orchestre, c’est qu’à son avis, il n’y a qu’un chef d’orchestre au monde, celui du théâtre de Gênes, Martini, un génie, dit l’auteur d’Aïda. Quand il n’a point Martini, M. Verdi prend l’archet24. M. de Bonier réciterait, lui aussi, très volontiers, les alexandrins qu’il met sur les lèvres des personnages de sa tragédie nouvelle, Hernock, Ellaek, Herric, Gunther, Hildiga, Herklé, Gerontias, — car ce sont les noms un peu rudes de ses héroïnes et de ses héros25. — M. de Bornier dit bien, en effet, et juste, avec son accent méridional très coloré26. C’est un des auteurs de ce temps qui savent le mieux lire leurs ouvrages.
Pourquoi la Comédie-Française n’a-t-elle point joué les Noces d’Attila que va représenter l’Odéon et qui, paraît-il, ont un moment, à cause d’un patriotisme un peu trop bruyant, éveillé les susceptibilités de la censure ? Le succès de la Fille de Roland semblait indiquer que le poète était désormais de la maison. Chose peu connue, cette Fille de Roland elle-même n’a été, jadis, reçue qu’à correction, comme on dit — la correction, un pseudonyme aimable du refus. La Fille de Roland s’appelait alors Charlemagne. M. de Bornier remporta sa tragédie, la reprit en sous-œuvre, et la guerre venant donner une actualité d’ailleurs pénible au patriotisme de Roland et du vieil « emperor à la barbe florie », l’honnête et vaillant homme de lettres, qui, du fond de la bibliothèque de l’Arsenal, luttait depuis tant d’années contre le succès d’estime, rencontrait dans cette pièce à demi refusée — et qu’il venait relire avec ténacité — un succès de vogue et, pour tout dire, la gloire — ou la popularité, cette monnaie de la gloire.
Il y avait, en effet, près de trente ans que M. Henri de Bornier attendait son heure, trente ans qu’il avait publié son premier ouvrage, un volume de vers, maintenant introuvable, disparu comme tous ces volumes de début où les nouveaux venus mettent parfois le meilleur de leur âme. En 1845, M. de Bornier, arrivant de Lunel, faisait paraître chez l’éditeur Desloges, rue Saint-André-des-Arts, un volume in-18 portant ce titre : Premières Feuilles, et cette épigraphe empruntée à Virgile : Versiculos. Ce premier livre a d’ailleurs son originalité : la préface, qui est en vers, est écrite par le père de l’auteur, M. Eugène de Bornier, souhaitant du fond de sa province bon vent, bonne mer, aux écrits de son fils. Ils avaient tous, plus ou moins, ces Bornier, courtisé la Muse, de génération en génération, et M. de Bornier le père, s’adressant au futur auteur d’Attila, lui disait, dès 1845 :
Tes vers ont plus de prix que les miens, je suppose.
Qui pourrait entre nous décider de la chose ?
Je l’admets. Feu mon père en fit, à mon avis,
Qui sentaient leur Dorat27 ; à ce compte tes fils
En feront d’excellents, et tout cela fait croire
Que notre nom doit vivre au Temple de Mémoire.
Il ne devait pas, le bonhomme, resté là-bas, au pays, calme dans son fauteuil, comme il l’écrit, et « condamnant en riant son passé poétique », voir le triomphe de son fils, mais M. Henri de Bornier doit plus d’une fois aujourd’hui penser à ce conseiller de ses premières heures, à ce guide de ses premiers pas, à ce préfacier de ses Premières Feuilles. Il y a du talent dans ce volume, où des fragments de drames, de tragédies avec Pèdre le Cruel28 pour grand premier rôle, alternent avec des épîtres admiratives à Chateaubriand, à Lamartine, à Victor Hugo, ou plutôt à Charles Hugo, que Bornier engage à imiter l’auteur de Ruy Blas :
Géant si tu l’atteins, Dieu si tu l’effaçais !
Dans une pièce dédiée « À mon, frère Edmond » et intitulée Souvenir, je rencontre ces vers, dont le dernier trait est doucement touchant et qui marque bien le ton de ce premier volume tout entier :
J’avais seize ans. Un jour, dans la cour du collège,
Je courais, je sautais, je gambadais, heureux
Et fou, comme à seize ans, du bruit, des voix, des jeux.
— Âge qui de la joie a seul le privilège ! —
On m’apporte une lettre. Ô ciel ! Un cachet noir !
Quelque malheur, mon Dieu ! De la main de mon père :
« Ô mes pauvres enfants, vous n’avez plus de mère ! »
Je pleurai tout le jour, et je partis le soir.
Près du manoir désert, le lendemain j’arrive.
Le soleil se couchait tout rouge, j’entendais
Se plaindre un rossignol caché dans les cyprès29,
Et le ruisseau connu sanglotait sur la rive.
Mon père me reçut dans ses bras, sur le seuil.
On avait, dès la veille, emporté le cercueil.
— Pas même la revoir ! — La maison semblait nue,
Mes jeunes sœurs riaient sous leurs habits de deuil.
Cela brisait le cœur ! Et la plus ingénue
Disait : « Henri, maman n’est donc pas revenue ?
Lis ces vers que je veux t’offrir,
Lis sans trop pleurer, petit frère.
Pauvre enfant qui n’as plus de mère,
Mais qui, du moins, la vis mourir !
Un poète parnassien reprocherait à ces vers bien des rimes pauvres. Il aurait raison, et pourtant le sentiment qui les dictait reste pénétrant et naïvement ému encore, après bien des années.
M. de Bornier, qui fut longtemps un poète de salons, du salon de Mme Anaïs Ségalas30 et de Mme Ancelot31, avant d’arriver à la foule, annonçait, en ce temps-là, sur la couverture de son premier livre, une série d’études littéraires : Les Femmes poètes contemporaines. Je ne crois pas que le volume ait vu le jour. C’eût été une suite de madrigaux plutôt qu’une collection d’articles de critique. À cinquante ans, M. de Bornier garde encore pour les muses de sa jeunesse des éloges attendris. Il ne compte ni leurs cheveux blancs, ni leurs rides. Il les voit telles qu’autrefois, et je le donne comme un des rares exemples de ceux qui restent fidèles à leurs admirations premières, bon comme à ses débuts et simple après son succès comme aux heures de lutte et de fière pauvreté.
Eugène de Mirecourt
Le monde cependant vieillit et change. On se modifie, on disparaît. Un homme qui fut tout le contraire de cette aimante et enthousiaste nature de Bornier, Eugène de Mirecourt32, vient, dit-on, de mourir à Saint-Domingue, où il était allé comme missionnaire. Les journaux avaient déjà, l’an dernier, annoncé la fin de l’ancien pamphlétaire, qui avait pu lire alors les oraisons funèbres, assez méprisantes, prononcées par avance, sur une fosse seulement entr’ouverte. Ce fut un impatient, ce Mirecourt, un affamé de popularité, de tapage et d’argent. Il végétait en faisant des romans de pacotille ; un beau jour, il voulut crocheter le succès. Il écrivit les Mémoires de Ninon de Lenclos et les Confessions de Marion Delorme33. Lui aussi était d’avis que l’argent, fût-il ramassé par le littérateur dans la ruelle d’une courtisane, sentira toujours bon. Malheureusement pour lui, Mirecourt n’avait pas osé jeter par-dessus les moulins les couvertures de ses héroïnes ; ces Mémoires et ces Confessions étaient trop chastes. Ce ne fut qu’un demi-succès de scandale : une désillusion. L’homme alors essaya du pamphlet.
Il lança au front de ses contemporains une quantité de petits livres jaunes, qu’on s’arracha par curiosité. Mirecourt avait déjà préludé à ce genre de biographies en écrivant contre Dumas père une brochure : Fabrique de romans : Maison Alexandre Dumas et Cie34, qui lui avait valu un duel — ou un commencement de duel — avec Félicien Mallefille35. Ses biographies des Contemporains, bien différentes des honnêtes études que M. de Loménie avait, peu d’années auparavant, signées : Un homme de rien36, le conduisirent plus d’une fois en police correctionnelle et souvent en prison, sur la plainte de M. Émile de Girardin37, par exemple.
Je trouve dans une biographie de Mirecourt38 — car il fut biographié, le biographe ! — une anecdote qui n’est peut-être pas tout à fait exacte, mais qui, en ce cas, vaut la peine d’être démentie. Mirecourt venait de publier dans le journal la Silhouette un article violent contre Alexandre Dumas39. M. Dumas fils, indigné, envoie des témoins aussitôt demander raison au pamphlétaire.
— Vous venez de la part de M. Dumas fils ? dit le biographe.
Il sonne sa domestique :
— Amenez-moi mon fils !
« La bonne reparaît avec un petit garçon de quatre ou cinq ans, tout barbouillé de confitures. Mirecourt regarde ses visiteurs très sérieusement et leur dit : « Messieurs, je suis convaincu que mon fils tient autant à mon honneur que le fils de M. Alexandre Dumas à celui de son père. Comme il est indispensable que les rôles soient les mêmes, c’est à lui que vous demanderez raison. »
Je laisse à MM. Th. Deschamps et Serpentié, qui l’ont contée, la responsabilité de l’anecdote. Je ne sais trop d’ailleurs si Mirecourt avait un fils. Mais il avait une fille, très charmante, d’une intelligence vive, qui, voulant s’affranchir, entra au théâtre, joua, non sans succès, à l’Odéon et au Théâtre-Historique, puis disparut, emportée toute jeune par un cancer. Elle avait, à la scène, pris le nom de Therval40.
Mirecourt, lui, s’appelait Jacquot. Il prétendait descendre de Jacquot, baron d’Haracourt, qui, dans les guerres des Rustauds d’Alsace41, avait bataillé sous le duc Antoine de Lorraine42. Un jour, l’auteur d’André le Montagnard, du Sire de Malines et d’une foule de romans mort-nés, écrivit une nouvelle sous ce titre : les Inconvénients d’un vilain nom43, et prit celui de la petite ville des Vosges où il était né. Et quand on pense que ce nom fut célèbre simplement parce que celui qui le porta se donna pour tâche de faire peur à ses contemporains ! Quand on songe que ce littérateur sans talent compta comme une puissance, qu’il fut une force, qu’il fut un type ! M. Legouvé le visa dans une comédie, le Pamphlet44 ; M. André Thomas, le frère de l’acteur Lafontaine, dirigea contre Mirecourt une attaque en plein théâtre du Vaudeville, dans un drame, le Pamphlétaire45.
Alors Mirecourt était heureux : il faisait du bruit. Il avait essayé du théâtre, jadis ; à la Comédie-Française, il donnait, avec Marc Fournier, une Madame de Tencin46-47 ; aux Variétés — chose curieuse — un vaudeville, les Tables tournantes48, avec le romancier Champfleury49. Mais la fatalité de sa vie c’était de ne réussir que par le scandale. Veine bientôt épuisée. L’injure est ce qui lasse le plus rapidement le public après l’avoir le plus sûrement mis en éveil. Eugène de Mirecourt, devenu vieux, retomba peu à peu dans le grand silence de sa jeunesse. Puis on annonça qu’il entrait dans un couvent, puis qu’il s’était fait prêtre, puis qu’il était mort. Et de tout ce tapage d’il y a vingt ans, il ne reste plus rien, pas même un nom !
Mirecourt avait eu des collaborateurs, lui qui accusait Alexandre Dumas d’abuser de la collaboration ! L’un d’eux, M. Pierre Mazerolle50, qui a pu, de visu — et comme du fond de l’hôpital — écrire un livre poignant, affreusement sombre, la Misère à Paris, se fâcha parce que Mirecourt ne le payait point, et publia un pamphlet contre le pamphlétaire51. Mirecourt se contenta de répondre : « Je sais ce que c’est. Un peu de boue ! Ça ne tache pas ! »
Cet homme, mort repenti sous la noire soutane du prêtre, n’eût pas eu le droit de dire comme le vieux conventionnel Lakanal52 : « Je puis montrer mes mains en mourant : rien dedans, rien dessus ».
La veuve de Lakanal
Lakanal ! Sa veuve53 aussi vient de mourir. C’est encore un lien rattachant le présent au passé qui se rompt tout à coup. Il semblait, en apercevant la septuagénaire qui portait ce grand nom, qu’on entrevit une figure même de la Révolution. Bien des contemporains l’ont connu, d’ailleurs, lui-même, ce Lakanal dont Ginguené54 disait si bien : « Je veux faire passer en proverbe : Servir ses amis comme Lakanal ». Un matin de 1837, M. Mignet, l’historien de la Révolution55, vit arriver chez lui un beau vieillard aux longs cheveux, ferme et droit, vêtu de l’uniforme de membre de l’Institut du temps du Directoire. C’était Lakanal. Il avait soixante-quinze ans et ses traits n’en accusaient pas soixante.
— C’est mon extrait de naissance qui est vieux, dit-il à M. Mignet, mais ce n’est pas moi ! Et quand on me donne un grand âge, je réponds comme Moncrif56 à Louis XIV : On me le donne, mais je ne le prends pas ! »
M. Mignet peut se vanter d’avoir reçu chez lui un des plus remarquables représentants de la savante et solide génération de la fin du dix-huitième siècle.
Mme Lakanal était fidèle à la mémoire de son mari. Silencieuse, circonspecte, elle parlait peu, cacha depuis la mort du conventionnel (22 juin 1844) les papiers, les notes, les souvenirs qu’il avait laissés, et ne permit guère qu’à Michelet d’y jeter les yeux. Encore était-elle soupçonneuse et inquiète. Dans ces derniers temps, elle s’était décidée à livrer à l’impression les travaux inédits du vieillard, mais elle ne devait pas goûter cette joie de les voir paraître. Ils seront mis en vente le jour même — jour prochain — où le département de l’Ariège élèvera une statue à ce Joseph Lakanal qui, lorsqu’on lui demandait ce qu’il fallait pour « terminer la Révolution dans la République et en commencer une dans l’esprit humain », — répondait simplement :
— Rien et tout : une loi sur l’instruction.
Notes
Lire aussi les « Chroniques » de Jules Claretie (non signées) dans Le Temps des 17, 25 et 26 mars 1880, page deux : À travers les ateliers et Les ateliers avant le salon.
1 Jean-Jacques Henner (1829-1905), peintre prolifique et délicat, prix de Rome en 1958. Un très agréable (et très méconnu) musée Henner se visite, avenue de Villiers. Jules Claretie a écrit un J.-J. Henner, 1839-1878, par un critique d’Art. dans la collection Les hommes du jour, G. Decaux, 1878.

Henner, La Liseuse, huile sur toile, 94 x 123 cm., peinte entre 1880 et 1890, collection du musée d’Orsay rarement exposée
2 Édouard Detaille (1848-1912), peintre académique spécialisé dans l’art militaire. De nombreuses œuvres d’Édouard Detaille sont conservées au musée de l’Armée depuis 1915. Jules Claretie a dressé un portrait d’Édouard Detaille dans le volume II de ses Portraits contemporains et aussi dans la série « Célébrités contemporaines ». Il s’agit de deux textes différents.
3 Le verbe emboire est surtout employé en sculpture ou en peinture. Il semble que Jules Claretie confonde les significations, différentes selon l’art concerné. Selon le TLFi, qui reprend les termes du Dictionnaire de l’Académie, un sculpteur doit « emboire d’huile ou de cire un moule de plâtre, Le frotter d’huile ou de cire fondue, pour empêcher la matière qu’on y coulera de s’y attacher. » Dans le cas d’une peinture, elle va s’emboire, c’est à dire « devenir terne lorsque le support absorbe l’huile ou l’essence. »
4 Théodore Rousseau (1812-1867), peintre naturaliste.
5 La Karamanie est cette partie sud de la Turquie, face à Chypre, entre Alanya et Mersin, dont Konya, plus au nord, est la capitale
6 Le Palais de l’Industrie, bâtiment monumental et voulant l’être, a été édifié près des Champs-Élysées à l’occasion de l’exposition universelle de 1855. Il sera démoli en 1896, n’ayant servi qu’à peine plus de quarante ans, laissant place aux petit et grand palais.

Le Palais de l’industrie. Les noms des rues de l’époque ont été conservés. Après la démolition du Palais de l’Industrie, l’avenue Nicolas II a été percée, traversant son ancien emplacement depuis l’avenue des Champs-Élysées pour rejoindre le pont Alexandre III. L’avenue Nicolas II a été renommée avenue Winston Churchill en 1966. Peut-être pourrions-nous, en 2024, renommer le pont Alexandre III ?
7 Charrette étroite, longue et sans ridelles servant à transporter des tonneaux. Ce poids oblige évidemment l’emploi d’un cheval.
8 Le Pactole, aujourd’hui Şahyar, est une rivière turque à 150 kilomètres à l’est d’Izmir réputée charrier des paillettes d’or. Dans cette région autrefois nommée Lydie, a régné le roi Crésus vers 550 avant notre ère.
9 Un chapeau piston en 2024 :

10 Alexandre Cabanel (1823-1889).
11 Jean-Léon Gérôme (1824-1904), peintre et sculpteur académique. Lire, ci-dessous « L’atelier Gérôme ».
12 Jules Lefebvre (1834-1912), tombé dans l’oubli avant sa mort.
13 L’Amant d’Amanda, chansonnette créée par Libert (1840-1896), au théâtre des Ambassadeurs des Champs-Élysées. Paroles insignifiantes d’Émile Carré sur une musique minimaliste de Victor Robillard.

L’amant d’Amanda (et sa badine), illustration d’Edward Ancourt pour la partition. Premier couplet : « Toute femme a son dada, / Sa marotte, ses toquades. / Amanda me demanda / Un soir, entre deux œillades : / Mon gros veux-tu m’adorer ? / Pourquoi pas lui répondis-je. / Depuis j’entends murmurer / Partout où je me dirige : / Voyez ce beau garçon-là, / C’est l’amant d’A, c’est l’amant d’A, / Voyez ce beau garçon-là, / C’est l’amant d’Amanda. » Le succès fut immense.
14 William Bouguereau (1825-1905), peintre académique.
15 Un bidard était, dans l’argot de l’époque, une personne chanceuse.
16 Une croyance ancienne affirmait qu’une pièce d’argent noircissait au contact des champignons vénéneux mais restait brillante s’ils étaient comestibles.
17 Cet atelier se trouvait au sein de l’école des Beaux-Arts, ou Jean-Léon Gérôme a enseigné pendant quarante ans, de 1864 à 1904.
18 Bouginier (Henri Bougenier (avec un e), 1799-1866), peintre romantique et photographe.
19 L’école Sainte-Geneviève a été fondée par un jésuite en 1854, rue des Postes, aujourd’hui rue Lhomond. Cette école a été transférée à Versailles en 1913. Elle assure de nos jours une préparation à Polytechnique. Lire le Premier Paris du Figaro du sept avril, le début de l’article d’Ignotus : « La maison proscrite ».
20 « J’ai connu l’an dernier un jeune homme nommé / Mardoche, qui vivait nuit et jour enfermé. / Ô prodige ! il n’avait jamais lu de sa vie / Le Journal de Paris, ni n’en avait envie. […] Quittons ce sujet-ci, dit Mardoche, je vois // Que vous avez le crâne autrement fait que moi. » Alfred de Musset, Contes d’Espagne et d’Italie, recueil de poésies dont « Mardoche » chez Alfonse Levavasseur et Urbain Canel, 1830.
21 Adolf Nordenskiöld (1832-1901), géologue et explorateur finlandais, a été le premier à franchir le passage du Nord-Est, ouvrant ainsi, vers l’est, la « route maritime du Nord » en longeant la côte nord de la Scandinavie puis de la Russie et atteignant ainsi de détroit de Bering. Dans sa Vie à Paris du six avril, Jules Claretie (ou l’imprimeur) utilisera la graphie Nordenskjöld (avec un j).
22 Henri de Bornier (1825-1901), Les Noces d’Attila, drame en quatre actes en vers, représenté au théâtre de l’Odéon le 23 mars 1880. Le texte est paru chez Édouard Dentu la même année. Cette « chanson de la hache » intervient au cours du deuxième acte : « Femme, voici la hache, eh bien voilà la cible : / Tu vas voir, pour signal des meurtres qui suivront, / La hache d’Attila frapper ton père au front ! [Hildiga, se précipitant sur lui et arrêtant sa main] Non ! arrête, Attila ! — Je comprends ma faiblesse ; / Je ne dirai plus rien désormais qui te blesse ; »
23 Henri de Bornier, La Fille de Roland, drame en quatre actes, en vers représentée à La Comédie-Française le quinze février 1875 avec Maubant, Mounet-Sully et Sarah Bernhardt. Le texte est paru chez Édouard Dentu la même année.
24 Longtemps les orchestres ont été dirigés par le premier violon, que l’on nommait aussi maître de concert.
25
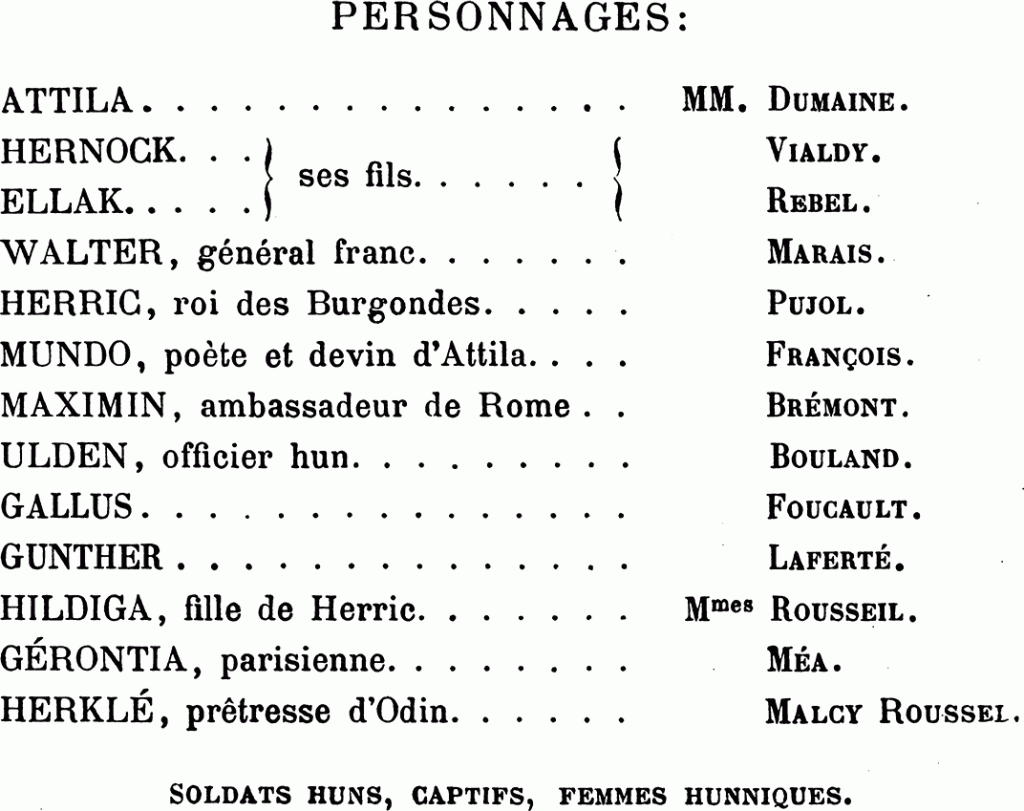
Distribution de La Fille de Roland
26 Henri de Bornier est né à Lunel, dans l’Hérault.
27 Claude-Joseph Dorat (1734-1780), auteur dramatique mineur mais prolifique dont les œuvres complètes ont été publiées en vingt volumes dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
28 Pierre Ier de Castille (1334-1369).
29 Par ces italiques, Jules Claretie souligne les « rimes pauvres » qu’il dénoncera ci-après.
30 Anne Caroline Menard (1811-1893), femme de lettres précoce, a épousé en 1827 l’avocat Victor Ségalas. C’est alors que, changeant de nom elle choisit aussi de changer de prénom et publia ses premiers textes. Elle tint salon chez elle, au 41 boulevard des Capucines, à trois immeubles de l’atelier Nadar.
31 Virginie Chardon (1792-1875), femme de lettres et peintre, a épousé en 1818 le vaudevilliste Jacques-François Ancelot (1794-1854). On lui doit entre autres, Un salon de Paris de 1824 à 1864, paru chez Édouard Dentu en 1866 (393 pages).
32 Eugène de Mirecourt (Charles Jacquot, 1812-1880) mort le treize février dernier à Port-au-Prince, journaliste et homme de lettres. Eugène de Mirecourt a écrit un Anaïs Ségalas dans la collection « Les Contemporains » de Gustave Havard (le père de Victor) en 1856 (95 pages).
33 Eugène de Mirecourt, Mémoires de Ninon de Lenclos, Victor Bunel 1875, 756 pages. Confessions de Marion Delorme, Victor Bunel (dans date), 846 pages. La particularité de ces deux ouvrages est que toutes les pages sont ornées d’une bordure fleurie avec putti dans les angles, ce qui entraîne une assez importante augmentation du nombre de pages.
NSÉRER ici l’image : « Mirecourt – Mémoires de Ninon de Lenclos web.gif »
34 Eugène de Mirecourt, Fabrique de romans, Maison Alexandre Dumas et compagnie, chez tous les marchands de nouveauté, 1845, 64 pages. La couverture jaune ressemble assez à celles de la librairie Charpentier.
35 Félicien Mallefille (1813-1868), romancier et auteur dramatique.
36 Louis de Loménie (note 31 de La Vie à Paris du treize janvier 1880), Galerie des contemporains illustres, par un homme de rien, René et cie, 1840-1847, dix volumes, 76 pages.
37 Eugène de Mirecourt : Émile de Girardin (1854), chez J.-P. Roret et Cie, 1854 (Les Contemporains numéro trois, 106 pages). Pour Émile de Girardin, voir La Vie à Paris du dix février dernier. Dans une autre série des Contemporains, éditée par Gustave Havard, Eugène de Mirecourt au aussi écrit un Madame de Girardin en 1858 (97 pages), dont l’avant-propos commence ainsi : « Depuis le jour où nous avons écrit sur notre drapeau cette audacieuse devise “Vérité quand même, vérité sur tous !” nous sommes victimes d’attaques sans nombre. » On croirait entendre Elon Musk.
38 Théophile Deschamps et Serpentié, Biographie d’Eugène de Mirecourt (Eugène Jacquot), Edmond Dentu, imprimerie centrale de Napoléon Chaix et cie, 1855, 53 pages. L’anecdote restituée par Jules Claretie se trouve page trente. Voir aussi Gustave Mayer, Eugène de Mirecourt, série « Un contemporain », chez tous les libraires, 1855.
39 Eugène de Mirecourt a écrit au moins une dizaine d’articles dans La Silhouette concernant Alexandre Dumas entre février 1845 et février 1847.
40 Eugène de Mirecourt (Eugène Jacquot) a épousé en 1836 Alexandrine Tabourier (ou Labourier) qui lui a donné trois enfants, Marie, Hélène et Nicolas. La comédienne est Joséphine (1844-1876), morte à 32 ans. Le musée Carnavalet en possède une photographie représentant une jeune femme sans grâce.
41 Les raisons de cette guerre des Rustauds ou guerre des paysans, dans les années 1524-1526, ressemblent à celles qui, 260 ans plus tard, conduiront à la Révolution française.
42 Antoine de Lorraine (1489-1544), duc de Lorraine et de Bar entre 1508 et 1544.
43 Le Globe des 23, 24 et 25 juillet 1841, information donnée par Eugène de Mirecourt lui-même dans La Silhouette du 22 juin 1845, page sept.
44 Ernest Legouvé (1807-1903), a été élu à l’Académie française en mars 1855 au fauteuil de Jacques-François Ancelot cité note 31. Le Pamphlet, comédie en deux actes créée à la Comédie-Française le sept octobre 1885. Le texte de la pièce est paru la même année chez Michel Lévy.
45 André Tomas, Le Pamphlétaire, comédie en trois actes, chez tous les libraires, 1858 (90 pages). André Thomas était le frère de Louis (1824-1898), plus connu sous le nom de scène d’Henri Lafontaine. Après des débuts au Gymnase, il entra à la Comédie-Française en mai 1856 dans le rôle du Cid. Lafontaine tient le premier rôle du Pamphlétaire, celui de Louis Lordais.
46 Claudine Guérin de Tencin (1682-1749) femme de lettres et salonnière, proche du cardinal Dubois, qui sera évoqué note 16 de la prochaine Vie à Paris.
47 Eugène de Mirecourt et Marc Fournier, Madame de Tencin, drame en quatre actes précédé de Le Chevalier Destouches, prologue, représenté pour la première fois sur le Théâtre-Français le huit août 1846. Texte publié la même année chez J.-A. Lelong, imprimeur, libraire, éditeur.
48 Eugène de Mirecourt et Champfleury (1821-1889), La Table tournante, expérience de magnétisme en un acte, mêlée de couplets, représentée pour la première fois sur le théâtre des Variétés le 22 mai 1853. L’édition du texte de la pièce par La librairie théâtrale est suivie d’une « Notice sur la manière de faire tourner les tables ».
49 Champfleury (Jules Husson, 1821-1889), journaliste, homme de lettres s’intéresse soudain à la faïence au point d’être nommé conservateur du musée de Sèvres.

Champfleury, caricature par Nadar dans Les Binettes contemporaines, tome premier, Gustave Havard 1855, gravure de Diolot
50 Dans son article « Les paysans de Paris, Histoire des Limousins du bâtiment au XIXe siècle » Alain Corbin qualifie Pierre Mazerolles de « Spécialiste des taudis » Ethnologie française, nouvelle série, T. X, No 2 (avril-juin 1980), pages 169-176.
51 Confession d’un biographe : Fabrique de biographies, maison E. de Mirecourt et compagnie, par un ex-associé, Pierre Mazerolle, chez l’auteur, treize rue Soufflot, et chez tous les libraires, 1857. Voir aussi, d’un auteur anonyme : Eugène de Mirecourt, sa biographie et ses erreurs, avec un portrait et un autographe, librairie d’Alphonse Taride 1856, 96 pages suivies d’un autographe d’Eugène de Mirecourt.
52 Joseph Lakanal (1762-14 juin 1845), professeur de rhétorique puis de philosophie chez les Pères de la doctrine chrétienne avant de se rallier à la Révolution. Il a été élu député de 1792 à 1797. Face à la première Restauration, en 1814, Joseph Lakanal préféra émigrer aux États-Unis où, en Alabama, il s’occupa d’une plantation d’oliviers avant de devenir président de l’université de Louisiane. En 1833, après la Révolution de juillet de 1830, Joseph Lakanal regagna le Paris et la France de Louis-Philippe.
53 Joseph Lakanal s’est marié deux fois. La première avec Barbe François qui lui a donné deux filles, Marie, née en 1796 et Anne, née en 1801. Veuf en 1836 Joseph Lakanal s’est remarié un peu tard, en décembre 1842 avec Rosalie Lepelletier (1806-27 mars 1880), de quarante-quatre ans sa cadette, qui lui avait donné un fils, Joseph, en 1839. C’est donc Rosalie Lepelletier, laissée sans ressources, qui est évoquée ici par Jules Claretie.
54 Pierre-Louis Ginguené (1748-1816), poète et historien de la littérature.
55 François Mignet (1796-1884), historien. François Mignet a été conseiller d’État, directeur des Archives du ministère des Affaires étrangères. Soutenu par son ami Adolphe Thiers, François Mignet a été élu à l’Académie Française contre Victor Hugo (cinq tours de scrutin tout de même) en décembre 1836. François Mignet est surtout connu de nos jours pour son Histoire de la Révolution française de 1789 jusqu’en 1814, Firmin Didot 1824, deux volumes.
56 François-Augustin Paradis de Moncrif (1687-1770), poète, musicien, comédien et escrimeur. Paradis de Moncrif est son nom. Cet homme plaisant ne fut pas élu mais imposé par le duc d’Orléans, contre Marivaux à l’Académie française, qui eut à s’en plaindre. Jules Claretie reprend ici un article de Mario Proth paru dans le Journal officiel du 26 janvier 1874 page 52.
.
.
