Souvenir du Salon défunt — Le Taquin — Le canon du Palais-Royal — Émile Thomas et les Ateliers nationaux — Le cocher de Victor Hugo — Le vers latin — Notes
30 juin 1880
Ce texte n’est pas paru dans Le Temps, ou à peine. Les trois premiers paragraphes seulement. Tout le reste est un nouveau texte, rédigé semble-t-il uniquement pour l’édition Havard. Page web mise en ligne le lundi 28 avril 2025.
On a eu bien raison de dire que l’histoire est un perpétuel recommencement. La fête du 14 juillet préoccupe autant les esprits, à quatre-vingt-dix ans de distance, fait échanger autant de propos et verser autant d’encre qu’au 15 juin 1790(1) le pouvait faire la première célébration du 14 juillet2, la cérémonie de la Fédération3.

Édouard Detaille (1848-1912), La distribution de ses nouveaux drapeaux et étendards à l’armée française sur l’hippodrome de Longchamp, le 14 juillet 1880, grande toile de près de trois mètres sur cinq, musée d’Orsay, visible au musée de l’armée
Nous serons, si cela continue, blasés avant de les avoir éprouvées, sur les émotions patriotiques de la future distribution des drapeaux. Non seulement on en donne le programme à venir, mais d’avance on en décrit toutes les splendeurs. La tribune où se tiendront les représentants des pouvoirs exécutif et législatif sera, dit-on, élevée en face de la tribune actuelle des courses et formée d’une grande tente aux couleurs tricolores, soutenue de faisceaux d’armes et surmontée de trophées militaires, sabres, cuirasses et baïonnettes. Pour peu que le soleil brille sur ces tas d’acier et en fasse jaillir des éclairs, le spectacle ne manquera point de grandeur et ce flamboiement ressemblera aux rayons d’une aurore.
On a bien fait de choisir, pour une telle cérémonie, le vaste hippodrome de Longchamp. Ce fut là que, pour la première fois, après la guerre et la Commune, la France revit défiler les lambeaux à peine recousus de son armée. Pauvres diables de soldats aux képis tordus, aux capotes usées et trouées, médiocrement vêtus, tristes encore de la défaite subie, ils marchaient de leur mieux devant les représentants de la patrie. On éprouvait un serrement de cœur à retrouver, comme en débris, avec des uniformes lacérés, ces régiments qui, une année auparavant, eussent défilé dans une tenue correctement martiale. Ceux qui ont assisté à cette première revue de 1871 ne l’oublieront jamais4. C’était la sortie hésitante du malade devenu convalescent. Il y avait là à la fois de la crainte et de la fièvre, et les acclamations qui saluaient ces braves gens ressemblaient aux embrassements qu’on donnerait à un être qu’on a cru mort.
⁂
Ce sera, pour les Parisiens, et je dirai pour les Français, une grande fête que cette solennité du 14 juillet. Ce peuple-ci aime les démonstrations publiques. Il court aux lampions et aux banderoles comme les enfants courent à la musique qui passe5. Et, ce jour prochain, la vie à Paris sera doublée, décuplée, centuplée !
En attendant, est-ce bien la vie à Paris ? C’est la vie aux environs de Paris, la vie au bord de la mer, la vie aux Pyrénées, à Vichy ou à Aix, qui commence avec la fin de juin, et il faut tout l’attrait magnétique des fêtes prochaines pour retenir dans une ville sans théâtres puisqu’ils sont fermés ou qu’on y étouffe, sans concerts puisqu’il y pleut, sans expositions puisqu’elles sont closes, tant de gens qui ont soif de la brise salée ou du grand air des bois.
En vérité, après la mi-juillet, nous assisterons à un départ assez complet, à la fuite éperdue des malles et des coffres, au transbordement des toilettes vers toutes les stations de France ; mais jusque-là on se maintient ici, après la saison, comme dans une salle de théâtre, lorsque la pièce est finie et que le rideau va se relever sur l’apothéose. On attend, on prend patience. On veut voir les feux d’artifice. De toutes les dynasties de ce monde, celle à laquelle Paris est resté fidèle, c’est la dynastie des Ruggieri6.
Souvenir du Salon défunt
L’exhibition des envois de Rome7 ne suffit évidemment pas à la curiosité des Parisiens.
Mais Paris, las de peinture et gorgé de toiles, accablé de statues, demande à tout prix du nouveau.
Rien n’est pourtant plus curieux que ce Salon même, si visité il y a huit jours, et maintenant désert, livré tout entier aux poudreuses horreurs du déménagement.
Savez-vous combien il a reçu de visiteurs ce Palais de l’industrie, depuis le jour de mai où se fit l’ouverture ? Un ami, bien informé, m’en fait connaître le nombre : 170 000 entrées payantes, 405 000 entrées gratuites, 108 000 avec cartes, au total 155 000 entrées de plus qu’au Salon dernier. Niez donc après ce chiffre les progrès écrasants de l’art ! 683 000 spectateurs en moins de deux mois ! Léonard et Vélasquez n’en virent jamais défiler autant, devant la Joconde ou les Lances, durant leur existence entière !

Diego Vélasquez (1599-1660), La Reddition de Bréda, dite aussi Les Lances, (1635) toile de plus de trois mètres sur trois visible au musée du Prado depuis 1819
Et cette solitude soudaine, contrastant avec le tapage et la foule du dernier dimanche, n’est de loin en loin troublée que par le talon d’un gardien traversant lentement une salle. Personne, en bas, dans le jardin de la sculpture. Les buffets déserts, tristes comme une salle sans convives ; beaucoup d’oiseaux se posant effrontément sur les statues, faisant leur cour ailée à Biblis8 ou à l’Ève de Falguière, et caquetant, semblant joyeusement se consoler d’avoir été si longtemps chassés par le bruit.
Ci-gît le Salon !
⁂
Dans une huitaine de jours, on enlèvera des salles les tableaux non réclamés9 ; en masse, et, lettre par lettre, on les réunira tous au rez-de-chaussée, dans une promiscuité bizarre. Entassement annuel de toiles disparates qui est comme le post-scriptum de cet autre entassement formidable du premier jour des envois. Et où diable, dans quel logis, chez quels amateurs, en quels musées, dépôts ou dépotoirs iront se caser ces milliers d’aunes de toiles et ces kilomètres de bordures d’or ?
Ce qui n’empêche pas les six ou sept mille peintres que compte Paris d’être encore et toujours occupés à en fabriquer d’autres, avec une rapidité de vers à soie rongeant un mûrier, et les inventeurs d’artistes nouveaux de découvrir, de temps à autre, une merveille inédite, comme cet Espagnol, M. Villegas10, une réédition de Fortuny11, dont il paraît qu’on paye les toiles cent ou cent cinquante mille francs à New-York. Ce qui prouve que le Génois Christophe Colomb a rendu un fier service aux peintres andalous et castillans en découvrant l’Amérique.
Le Taquin
Au reste, si nous lui vendons fort cher nos tableaux à cette Amérique, elle s’en venge en nous bombardant de ses produits et en nous faisant subir, par exemple, après le supplice de cette crécelle qui fut si fort à la mode il y a deux ou trois ans et qui venait de New-York en droite ligne, la torture de ce jeu absorbant, inquiétant, plus terrible peut-être pour le cerveau humain que l’alcool et le tabac, et qui s’appelle le taquin. Le taquin est ce jeu — ce débilitant, ce soporifique, cet instrument d’hébétude, à « combinaisons toujours nouvelles » — qui consiste à faire manœuvrer, dans une petite boîte carrée, quinze petits pions de bois mêlés au hasard et qu’il s’agit de replacer dans leur ordre numérique : 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., jusqu’à 15. Occupation puérile en apparence, travail formidable en réalité. Qui calculera combien l’inventeur anonyme du taquin a causé de migraines, névralgies, céphalalgies et névroses à ses contemporains ?
Il s’en est vendu 70 ou 80 000, de ces petites boîtes qui tiennent tant de gens à cette heure courbés et congestionnés sur leurs fragments de bois, et il s’en vend tous les jours. Il n’est point de maison de campagne où le taquin, l’inévitable et absurde taquin, ne se tienne tapi dans un angle du salon comme un insecte ou une taupe dans un coin du jardin. Et tout à coup il apparaît, le taquin, avec ses seize carrés de bois aussi redoutables que les coins enfoncés jadis dans les genoux12 des patients, et une douce voix de femme vous dit avec un sourire :
— Voyons si vous serez plus heureux que nous avec le taquin !
Et il y a de l’ombre dans les allées, et des roses dans les bordures, et des sentiers dans les bois, et des partitions de Gounod sur le piano ! On pourrait prendre l’air, respirer les fleurs, écouter de la musique. Pas du tout, Il faut être poli. Il faut céder à la manie courante. Il faut se laisser taquiner par le taquin.
— Mais, en vérité, je ne sais pas…
— Cherchez !
— Mais je suis certain de ne point trouver…
— Essayez !
Non, jamais casse-tête chinois, — au temps où les questions s’appelaient ainsi — n’a causé tant de crispations et n’a amené tant de lourdeurs de tête que ce taquin niais, inutile, bête, et pourtant attirant, absorbant, magnétique comme toute chose mystérieuse, irritante, demandant une solution à laquelle on s’acharne et qu’on ne trouve pas.
Et il y a une quantité considérable de gens qui se creusent la cervelle pour trouver la solution demandée ; pis que cela, il y a des chercheurs d’infiniment petits qui absorbent leur pensée vers ce but unique : trouver une question nouvelle, inventer un jouet inédit, jeter à cette humanité, toujours en quête de nouveauté, — et toujours, sur certains points, à l’état d’enfance,— une distraction quelconque, que ce soit la potichomanie comme à l’heure où l’on passait son temps à coller d’horribles images découpées dans de hideuses potiches de verre13 — ou la question romaine, ou le cri-cri, ou le taquin, dernière invention de quelque trouveur patenté, comme il y en a des millions en Amérique, de quelque homme intelligent, de quelque Edison14 du camelot, qui a bien compris que le meilleur moyen de divertir l’homme, c’est encore de le contraindre à s’ennuyer.
Je demanderai quelque jour au docteur Bertillon fils15 d’ajouter une note à ses recherches de statistique et de nous dire combien de cerveaux aura desséchés l’abrutissement causé par cet hypnotisme d’une autre espèce : la concentration unique de la pensée sur ce petit damier aux quinze pions de bois ; et combien auront fini dans un cabanon de ces malheureux qui restent là, des heures, à contempler le taquin, comme un fakir regarderait son nombril et qui se livrent pieds et poings liés, — par plaisir, — à cet horrible jeu dont ils ne voudraient pas entendre parler si on les payait bien cher pour se laisser taquiner, hébéter, vider et conduire ainsi tout droit à l’apoplexie.
D’autres, des partisans du taquin, répondront que le taquin n’est pas plus absorbant ni énervant que les échecs, les dames, le loto et les dominos, chers à nos grands-pères, sans doute plus patients que nous.
Le canon du Palais-Royal
Mais, non, le taquin n’a point ce caractère patriarcal des jeux de patience d’autrefois. C’est un adjuvant à la maladie générale de notre époque, dont le nervosisme est si aigu que nous avons peut-être supprimé le canon16-17 du Palais-Royal simplement parce que, fidèle à son habitude, il ne sonnait pas, lui, midi à quatorze heures, comme tant d’autres horloges et cervelles contemporaines passablement détraquées.

Le Canon du Palais-Royal en septembre 2009
Bref, il n’a plus son canon légendaire, le vieux jardin du Palais-Royal !
Nous entendrons certainement, dans les revues de fin d’année, des couplets attendrissants sur la disparition de cet obusier minuscule qui partait tous les jours à midi précis, depuis des années, à travers toutes les révolutions et tous les changements de gouvernements.
C’était le plaisir et l’habitude du quartier, et ce canon quotidien qui brûlait pacifiquement sa poudre aux moineaux et aux badauds n’a jamais coûté une goutte de sang à personne. À peine coûtait-il cinquante francs par mois d’entretien, un peu plus d’un franc cinquante par jour, ce qui ne grevait pas immodérément le budget de la Ville.
Ce canon-là, qui coûtait peu d’argent,
Ne coûta jamais une larme !…
chantera quelque prochain compère de revue sur l’air larmoyant d’Aristippe18.
« Plût à Dieu, écrit quelque part un humoriste, que les canons du monde entier fussent réduits à l’artillerie du Palais-Royal et que leur détonation n’eût jamais causé d’autre mal que le tressaillement léger dont quelques demoiselles de comptoir et plusieurs marchandes trop nerveuses ne peuvent triompher, malgré l’habitude !… Pendant les cinq minutes qui précédaient l’explosion, une centaine de personnes entouraient le petit canon dressé sur son affût. La plupart des assistants tenaient leur montre en évidence ; ceux qui n’en avaient pas regardaient les autres, et il y avait là un moment d’attente solennelle. Quelquefois même, on semblait douter de la puissance du canonnier… Le coup partait et aussitôt les uns avançaient ou retardaient leurs aiguilles, puis l’attroupement diminuait, plusieurs allaient bénévolement semer sur leur passage l’heure officielle, et le groupe eût été entièrement dispersé s’il ne fût resté là, autour de la grille du parterre, des badauds, les éternels badauds de Paris, venus pour voir de quelle manière s’y prenait le soleil pour mettre le feu à la poudre — et les retardataires qui, pendant un quart d’heure, se chargeaient de répéter à tout venant que le canon était parti. »
Ce croquis date de 1832 et, deux années après, il n’y avait plus de canon au Palais-Royal. On l’avait supprimé, comme on vient de le faire aujourd’hui, pour le restaurer ensuite, comme on le réinstallera peut-être plus tard19-20. Pauvre humble canon qui jetait pacifiquement sa petite note grêle jusque dans les jours d’orages populaires et pendant les mois de bombardement où son éternuement répondait aux grondements des forts ! Il manquera à bien des gens, et les provinciaux à leur premier voyage à Paris n’auront plus à contempler que la place où fut le canon illustre, disparu avec toutes les autres vieilles curiosités du Palais-Royal : le café des Aveugles21, où le comédien Blondelet22, aujourd’hui acteur aux Variétés, battait la caisse, habillé en zouave ou en sauvage ; le théâtre Séraphin avec son crieur en carrick23 et l’ombre chinoise de la fée Carabosse apparaissant sur le transparent qui semblait si fantastique à nos yeux d’enfant — théâtre Séraphin24 transporté depuis au boulevard Montmartre, devenu théâtre de marionnettes et que dirigeait en dernier lieu — il y a quelques mois, — M. Simon Mayer25, l’ancien directeur du théâtre de Passy, revenu de Nouméa, et auteur des Souvenirs d’un déporté26.
Ce canon du Palais-Royal, un jour, — un jour extraordinaire, — un jour où, chose incroyable, extravagante, improbable, inattendue, il partit avec quinze minutes d’avance, à midi moins le quart, au lieu de midi, donna lieu à la plus amusante des chroniques d’Eugène Guinot, qui signait Pierre Durand27,et avait rendu célèbre ce pseudonyme oublié, pis que cela, ignoré aujourd’hui. Ah ! les réputations de journalistes ! Les ailes de leur gloire sont des ailes de papillon ; un peu de vent et cela devient poussière.
Eugène Guinot avait donc, en ce temps où le public préférait la fantaisie aux réalités, les anecdotes plaisamment imaginées aux faits exacts, aux renseignements certains qu’il aime aujourd’hui — et qu’il a bien raison d’aimer — Guinot ou Pierre Durand avait tracé le fantaisiste tableau de la perturbation publique et privée, des troubles que cette avance d’un quart d’heure du canon du Palais-Royal avait produits dans la vie de Paris.
Ô désolation de la désolation ! Telle femme mariée, Juliette en puissance d’époux écoutant cependant avec douceur les soupirs d’un Roméo, avait été surprise par son mari au moment même où elle disait, non point :
Non, ce n’est pas le jour, ce n’est pas l’alouette…
« … c’était le rossignol ; toutes les nuits il chante sur ce grenadier, là-bas28… »
Mais :
— Non, ce n’est pas midi ! nous avons encore un quart d’heure. Mon tyran règle sa montre sur le canon du Palais-Royal et le canon du Palais-Royal n’a pas encore tonné… ou toussé !…
Et le mari entrait un quart d’heure trop tôt, et Eugène Guinot prétendait que de pareilles scènes s’étaient produites — toujours par la faute de ce misérable canon, — du soleil, trop brûlant ce jour-là, ou de l’amadou trop sensible — sur différents points de Paris. Et, au hasard, gaiement, il citait les initiales (c’était la mode en ce temps-là) : M. A…, Mme B…, M. C…, D…, et chose extraordinaire que l’aventure même de ce satané petit canon en avance de quinze minutes, il se trouvait qu’en inventant une historiette, le chroniqueur avait deviné juste, et que, dans Paris, deux ou trois maris étant en effet arrivés trop tôt chez leur femme, trois provocations tombaient à la fois sur Eugène Guinot, un peu surpris.
— C’est moi qui suis Monsieur A. dont vous avez osé conter l’histoire !…
— Je suis Monsieur B. Qui vous a appris, monsieur, ce que vous n’avez pas eu la pudeur de garder pour vous ?
— Monsieur C., c’est moi !… Vous allez déclarer qu’il n’y a pas un mot de vrai dans ce qui m’est arrivé et que vous n’avez pas craint de rappeler à vos lecteurs !
Ce pauvre Guinot avait beau leur répondre : — Mais vraiment, je ne songeais pas plus à vous qu’au roi de Trébizonde29 ! Pierre Durand a tout simplement conté des histoires en l’air ; il lui fallut déclarer que les mésaventures parisiennes causées par le canon du Palais-Royal étaient purement imaginaires, sous peine d’avoir sur les bras un alphabet complet, irrités, et — menaçants — tous les maris du Dictionnaire Bottin, depuis A jusqu’à Z.
On ne le reprit plus, dès lors, à forger de pareilles anecdotes, mais il se plaisait à raconter l’histoire de ce qu’il appelait une « explosion d’initiales. »
Faites, dans un roman ou sur la scène, un portrait satirique d’après un homme : il y a dix chances pour une que le modèle vivant ne se reconnaisse pas et rie tout le premier de ses ridicules. Mettez quelque sottise sur le compte d’un personnage imaginaire : vingt fois sur cent des sots quelconques, en chair et en os, auront l’esprit de se croire visés et la bêtise de s’en fâcher.
Émile Thomas et les Ateliers nationaux
Je disais tout à l’heure que la gloire des journalistes est faite de poussière, un feu de paille, comme celle des comédiens est une fumée de la rampe. Mais, à dire vrai, il en est de même de toutes les renommées. Tout s’oublie, tout s’efface. On a laissé partir, ces jours derniers, sans lui consacrer rien de plus que cinq ou six lignes dans la nécrologie — en passant bien vite à l’actualité — un homme dont la célébrité fut grande à son heure, Émile Thomas qui avait ajouté à son nom celui de son oncle Payen, l’illustre chimiste, et signait Thomas Payen30. C’est Émile Thomas qui avait, en 1848, apporté à M. Marie, alors ministre des travaux publics, l’idée de ces ateliers nationaux dont le licenciement fut l’une des causes des journées de Juin. Émile Thomas a raconté tout cet épisode dans un livre qui fit tapage comme un pamphlet, il y a trente ans, l’Histoire des Ateliers nationaux31. Émile Thomas, ingénieur et chimiste, avait demandé à M. Marie de mettre les ouvriers sans ouvrage, formés en compagnies et en escouades, sous le commandement d’élèves de cette École Centrale qu’il connaissait bien et dont le très savant M. Ch. de Comberousse a écrit l’histoire32.
C’est à Monceau, dans un manège aujourd’hui démoli33, remplacé par des hôtels, que siégeait l’état-major de ces Ateliers, devenus, pour chaque membre du gouvernement et pour les amis du pouvoir, une sorte d’exutoire où l’on envoyait les solliciteurs. Émile Thomas raconte que David (d’Angers34), qu’il n’avait pas l’honneur de connaître, lui écrivit, à lui seul, plus de sept cents lettres de recommandation.
Un jour, le gouvernement s’effraya de la puissance formidable des Ateliers nationaux. Il résolut de les dissoudre. C’était M. Trélat35 qui tenait alors le portefeuille des travaux publics. Émile Thomas dépendait de lui. Il fit venir Émile Thomas au ministère :
— Monsieur Thomas, dit-il, asseyez-vous là et écrivez votre démission.
— Dans quels termes, monsieur le ministre ?
— Dans les termes que vous voudrez.
Émile Thomas rédigea sa démission.
— Maintenant, monsieur, ajouta le ministre, vous allez quitter Paris sur-le-champ. Vous irez remplir une mission à Bordeaux.
— Laquelle ?
— Étudier le prolongement du canal des Landes et le prolongement de la Teste de Buch à Bayonne.
— Œuvre excellente, monsieur le ministre. Mais c’est un exil. D’ailleurs je suis chimiste et non pas ingénieur des ponts et chaussées, et…
— Peu importe. Il faut que vous partiez. Ce soir même. À l’instant. Une voiture attelée vous attend dans la cour.
— Permettez-moi au moins d’aller prévenir ma mère !
— Impossible. Vous ne devez voir personne !
— Pas même ma mère !
Deux officiers de paix attendaient l’ex-directeur des Ateliers nationaux. La voiture partit, à onze heures du soir, au galop.
À Versailles, Émile Thomas put écrire au crayon une lettre à sa mère, en enveloppa une pièce de cinq francs, écrivit sur ce papier l’adresse : À madame Thomas au parc Monceau, et jeta par la portière la missive, qu’une marchande de légumes apportait le lendemain à son adresse.
Et la voiture galopait toujours vers Bordeaux lorsqu’au Carbon-Blanc, le dernier relais qui précède Bordeaux, des gendarmes arrivent déclarer aux deux officiers de paix qui accompagnaient le prisonnier qu’ils étaient prisonniers eux-mêmes. Ordre de les garder à vue. On les soupçonnait d’être trop sympathiques à cet étrange déporté que le gouvernement, qui l’arrêtait à Paris, nommait ingénieur dans la Gironde.
L’autorité arrêtait l’autorité36. Cela ressemblait par avance à quelque opérette, quoique le mot ne fût pas encore inventé37.
L’affaire amena très grand bruit alors et l’enlèvement d’Émile Thomas faisait comparer M. Trélat par M. Émile de Girardin à « un baron du douzième siècle saisissant un vilain38 ».
Alexandre Dumas, qui rêvait les honneurs politiques racontait l’histoire dans la France Nouvelle et s’écriait :
— Changez la date, nous sommes au seizième siècle ; changez le lieu de la scène, nous sommes à Venise !
Il ajoutait, riant de tout et de lui-même :
— Je n’ai jamais écrit de roman plus impossible !
Et de tout ce grand scandale d’un moment étouffé sous la canonnade de juin, il reste peu de choses dans la mémoire des hommes : un livre d’Émile Thomas, dont la première édition même n’est pas épuisée, et, sur le nom de cet homme, que vient d’emporter, à cinquante-huit ans, une ossification d’une artère du cerveau, l’ombre d’un souvenir tragique : les Ateliers nationaux, dont il ne fut pas responsable.
Le cocher de Victor Hugo
Alexandre Dumas a conté, quoiqu’il en ait dit, des romans plus amusants et plus improbables que ce chapitre oublié, ne fût-ce que l’histoire de ce cocher de cabriolet, Cantillion, Cabriolet no 221(39), — le cabriolet, chose aussi disparue que le canon du Palais-Royal ! — qui lui taillait des nouvelles et des projets de romans tout en le conduisant à l’Arsenal, chez Charles Nodier40, ou rue de Bondy, chez Taylor41.
« Quand je pense à un drame qui me préoccupe, disait Dumas, quand je ne vais pas à une répétition qui m’ennuie, quand je ne reviens pas d’un spectacle qui m’a endormi, je cause avec les cochers de cabriolet et quelquefois je m’amuse autant en dix minutes que dure la course que je me suis ennuyé dans les quatre heures qu’a duré la soirée. »
Dumas appelait les souvenirs que lui laissaient ces causeries des souvenirs à vingt-cinq sous. C’était alors le prix de la course.
Quand on lui faisait observer que les cochers de fiacre valaient mieux que les cochers de cabriolet, et la preuve, c’est que les cabaretiers ne prenaient jamais qu’un cocher de fiacre et jamais de cocher de cabriolet pour enseigne, un fouet d’une main et une bourse de l’autre avec cet exergue : Au cocher fidèle :
— Bah ! répondait-il, je préfère les cochers de cabriolet. Cela tient peut-être à ce que j’ai rarement une bourse à laisser dans leur voiture !
Victor Hugo, qui prenait volontiers autrefois l’omnibus, et même l’impériale de l’omnibus, a eu son cocher, lui aussi, qui mérite bien de demeurer aussi célèbre que le Cantillon d’Alexandre Dumas. Naguère, dans cette salle à manger de l’hôtel de l’avenue d’Eylau encore orné des armes royales de la princesse de Lusignan, la voisine et la propriétaire du grand poète, Victor Hugo présentait à ses invités un petit homme d’une quarantaine d’années, râblé, modeste, bien vêtu, d’une tenue très correcte, et disait, avec cette courtoisie de geste et de manières qui lui est particulière :
— J’ai l’honneur de vous présenter M. Charles More, qui m’a conduit au théâtre de la Gaîté le jour du Centenaire de Voltaire42 et qui n’a rien voulu accepter de moi !
Au moment, en effet, où le poète, descendant de voiture, devant le théâtre, tendait le prix de la course au cocher, le cocher lui avait répondu :
— Non, monsieur Victor Hugo, je ne prendrai pas votre argent. Il me suffit d’avoir eu l’honneur de vous conduire !
Victor Hugo insistait, le cocher persistait et, à la fin, le poète forçait le cocher à emporter les vingt francs qu’il lui tendait.
Fouettant aussitôt ses chevaux, le cocher s’en allait tout droit aux bureaux du Rappel et versait à la souscription ouverte pour les détenus politiques les vingt francs, qui figuraient, le lendemain même, dans la liste : Charles More, cocher, prix d’une course payée par M. Victor Hugo : 20 francs.
Le temps passait. De temps à autre, lorsque Victor Hugo sortait de son hôtel pour se rendre au Sénat, il apercevait, stationnant près du trottoir de l’avenue d’Eylau, un cocher qui fouettait son cheval pour se rapprocher et sautait à terre pour ouvrir la portière plus vite. C’était le cocher du Centenaire de Voltaire. J’aime à croire qu’il acceptait maintenant le prix des voyages au Luxembourg. Son admiration, au bout du compte, eût coûté trop cher au brave homme. Mais de pourboire, il n’était pas question. Le pourboire, encore une fois, c’était l’honneur.
Victor Hugo, ne sachant trop à la fin comment s’acquitter envers M. More, l’invita tout simplement à dîner, et le cocher devint pâle de joie. Il entrait, à l’heure dite, dans le salon de Victor Hugo, s’asseyait à côté des amis du logis et, vraiment, donnait, devant le poète, l’exemple de la tenue la plus parfaite. Il écoutait, se mêlait peu aux conversations, ne disait que quelques mots tout simples, mais très justes.
Au dessert, il remercia Victor Hugo.
— Ma foi, messieurs, dit-il avec la bonhomie d’un homme du peuple un peu ému de se voir entouré de lettrés, j’emporterai de cette soirée un souvenir qui ne s’effacera pas, mais je sais parfaitement bien que ma place n’est pas ici. Je ne suis qu’un brave homme qui vit pauvrement, mais en travaillant de mon mieux. J’ai une bonne femme et une jolie petite fille : je les adore l’une et l’autre. Quand je rentre dîner, la ménagère trempe la soupe aux choux et la petite me tend ses bonnes joues qui me font du bien à embrasser. Je pense à elles pendant mes courses, et quand je n’ai rien à faire, assis là-haut sur mon siège, eh bien, ma foi, moi aussi, je m’amuse à faire des vers.
Cela se gâtait. Le « moi aussi » était terrible.
— Seulement, ajouta modestement le cocher, je sais qu’ils ne doivent pas être bien bons, mes vers, et je ne consentirais à les montrer et à les publier que si M. Victor Hugo voulait bien me les corriger !
Il y eut un froid, un silence tout naturel.
Victor Hugo ne répliquait point, lorsque quelqu’un, répondant rapidement à la proposition, dit avec esprit au cocher :
— Voulez-vous un avis, monsieur ? En littérature, les grands sont les grands et les petits sont les petits. Restons chacun ce que nous sommes. Nous perdrions peut-être notre humble originalité à vouloir changer.
Victor Hugo sourit. Le cocher comprit, déplia un papier tiré de sa poche, récita une pièce de vers « à l’auteur des Châtiments », qu’il plaça tour à tour sur le Thabor et sur le Golgotha, et, comme le grand poète demandait à ses convives, avec ce bon sourire fin qui relève sa moustache et sa barbe blanche :
— Eh bien ! que dites-vous de mon cocher, qui fait des odes ?
— Ma foi, cher Maître, je ne m’en étonne pas trop, répondit Charles Edmond43, présent à la fête. Après tout, qu’était-ce qu’Apollon, dieu des vers, si ce n’est un cocher, comme votre hôte ?
M. More pourrait en effet appeler « mes collègues » le cocher du Soleil et le poète des Feuilles d’Automne44. Mais le brave homme n’y songe guère. Il a repris son fouet et poursuit ses rimes, tout en promenant ses clients à travers Paris.
À bien chercher, parmi ces automédons45, comme disait M. de Jouy46, on rencontrerait des gens capables non seulement d’aligner des vers français, mais de scander des vers latins. Toutes les professions sont représentées parmi les cochers de fiacre ; tous les décavés, les enfoncés, les ratés y figurent ; on a compté qu’il y avait sept prêtres défroqués dans le nombre et un ancien gentleman rider, complètement ruiné, profondément alcoolique, dont je ne citerai ni le nom, ni l’initiale, comme l’eût fait Guinot, et qui vit là, sur son siège, revoyant, tout en contemplant la croupe de son cheval, les pelouses de Chantilly, au temps de sa splendeur de grand parieur et de coureur. Et cette manie de la gageure et du jeu le tient si fort qu’on l’a entendu, plus d’une fois, dire à des clients étonnés :
— Je vous parie cinq francs que je vous mène à la Bourse — où à l’Opéra — en sept minutes ?
Ou :
— Voulez-vous que je dépasse ce cocher de Maître qui galope là-bas ? Je mets 10 francs sur mon cheval !
Pauvre diable ! Il me fait songer à cet excentrique dont parle en ses Essais l’Américain Mark Twain, un humoriste bizarre, dont l’étrangeté stupéfie et qu’on devrait traduire et importer plutôt que les questions et le taquin. L’original, l’extravagant, dont parle Mark Twain, est également un sportman qui a passé sa vie à parier sur tout. Il parie sur les chevaux, se ruine, descend d’un degré et parie sur les chiens. Il y perd de l’argent, s’enfonce, parie sur les lutteurs, sur les acrobates, sur les coqs de combat, sur les rats de gouttière. Il parie toujours ; toujours il perd et toujours il s’acharne à son jeu, comme le buveur d’absinthe à sa liqueur verte, ou l’affolé de morphine à ses injections calmantes. À la fin, de chute en chute et de bohème en bohème, l’éternel parieur parie sur une grenouille. N’ayant plus de chevaux, plus de pointers, plus de coqs, plus rien, il a dressé une grenouille à faire des sauts, et allant de cabaret en cabaret, de débit de brandy en public-house, il avise des buveurs de whisky et leur dit :
— Je parie que vous ne trouverez pas, dans toute l’Union, une grenouille qui saute aussi haut que celle-ci. Je vais aller en pêcher deux ou trois dans l’étang voisin. Vous verrez !
On parie. Il gagne. Il a des jouissances effrénées à palper de la monnaie de cuivre après avoir gaspillé des dollars.
Un jour, tandis qu’il est occupé à chercher, dans un étang, une rivale à sa grenouille si bien entraînée, un chasseur, avisant la rainette, se dit « Nous verrons bien si tu vas sauter, toi, » et lui verse dans le gosier tout le contenu de sa corne à plomb, La malheureuse grenouille est là, gonflée de grains de plomb, comme la grenouille de la fable. Au signal du maître, elle essaie de bondir, remue à peine et reste là étouffée, roulant ses gros yeux.
— Vous avez perdu, mon bon ! répond le chasseur au parieur éternel qui, cette fois, retombant de trop haut, ayant touché le fond des déceptions humaines, va se jeter dans l’étang voisin avec sa pauvre grenouille ballonnée !
Et peut-être ce singulier Mark Twain a-t-il étudié sur le vif ce fou, beaucoup plus amusant qu’un sot, et le cocher à particule, Don César du fiacre à l’heure, qui offre un dernier pari à ses clients, deviendrait un type extraordinaire sous la plume de Mark Twain !
Le vers latin
Peut-être, dans quelques années, les derniers aligneurs de vers latins, les suprêmes arrangeurs de dactyles et de spondées47 se rencontreront-ils parmi les cochers érudits ! C’en est fait du vers latin, c’en est fait du fort en thème, c’en est fait des lauréats du discours macaronique48 qui, après avoir remporté, au Concours général, des couronnes de papier vert, pouvaient finir, avec tout leur bagage d’antiquité — que j’écrirais volontiers au pluriel — comme ce Léonidas Requin dont parle Eugène Sue49 et qui, aussi étonnant que le parieur de Mark Twain, faisait le phoque savant au fond d’une baignoire et, ancien prix d’honneur de la Sorbonne, ne se contentait pas de dire papa, comme les autres phoques vulgaires, mais parlait au besoin latin, le pur latin de Cicéron, aux bourgeois stupéfaits de Brive et de Pithiviers !
Que de souvenirs d’autrefois s’envolent avec le vers latin ! Il semble qu’une éducation plus virile et plus vivante se substitue à ces exercices d’une inutilité écrasante, et je ne vois pas que les élèves d’Oxford, qui représentaient, il y a dix jours, une tragédie d’Eschyle en grec, sur un théâtre spécial50 — ou les disciples du séminaire d’Orléans qui jouaient jadis — dans le texte — Sophocle (d’ailleurs expurgé) devant l’évêque Dupanloup soient mieux armés pour la lutte moderne, pour ce combat quotidien de la vie actuelle, qu’un homme jeune qui, laissant le vers latin aux pédagogues, la vieille scolastique aux escholiers du temps de Rabelais, entre dans le monde en sachant non pas ce que savaient Cicéron, Aristote, — ou, plus près de nous, les grands érudits du seizième siècle, — mais ce que savent, de nos jours, les Claude Bernard, les Robin, les J. Bertrand51, les Berthelot.
Adieu donc au vers latin et au discours latin ! Un jour que ce grand latiniste de Louis XVIII disait gaiement à un maréchal de l’empire : « Macte animo, generose puer52 !… » le guerrier, peu lettré, fit la grimace :
— Marchez, animaux ! Marchez, animaux !… Napoléon était bien brusque, Sire, répondit-il, mais il ne nous appelait jamais animaux !
Louis XVIII se mit à rire — puis, au bout d’un moment :
— Au fait, dit-il, vous avez raison, maréchal. Il n’y a que les pédants qui se servent de citations et l’on ne doit parler que français à ceux qui servent bien la nation française !
Le royal traducteur d’Horace ne se doutait point qu’il prononçait là, par avance, l’oraison funèbre de feu Son Ennui le vers latin.
Notes
1 « 30 juin » dans l’édition Havard. Il ne semble pas s’être passé quoi que ce soit de notable à l’une ou l’autre de ces deux dates, ni, d’ailleurs au cours de ce mois de juin.
2 C’est par la loi du six juillet 1880 qui sera votée dans trois semaines, que le quatorze juillet sera proclamé jour de la fête nationale et le drapeau tricolore emblème du pays. Ce n’est pas la prise de la Bastille, trop sanglante et meurtrière qui est commémorée, mais l’anniversaire suivant, de la fête de la Fédération (note suivante). Le même jour s’est tenue à Longchamp la « fête des drapeaux », grande cérémonie militaire au cours de laquelle le Président Jules Grévy a remis le drapeau tricolore aux régiments présents. Dans Le Temps du treize juillet prochain, Jules Claretie, toujours très admirateur des militaires, donnera à ce propos une Vie à Paris particulièrement lyrique. C’est depuis 1880 que se tient le défilé militaire sur les Champs-Élysées et dans les plus grandes villes de France.
3 La première « fête de la Fédération » s’est tenue le quatorze juillet 1790 au champ de Mars et en province dans un grand enthousiasme, nettement retombé les années suivantes.
4 Il n’est pas impossible que Jules Claretie en ait été.
5 Après ce point, les textes du Temps et de l’édition Havard deviennent très différents. C’est l’édition Havard qui est donnée ici.
6 Le mot dynastie n’est pas exagéré. À l’époque à laquelle Jules Claretie écrit ces lignes la société Ruggieri existe déjà depuis 140 ans et a illuminé les fêtes des cours d’Europe. Un siècle encore après cet article, Ruggieri verra poindre un concurrent, Lacroix, qui finira par le racheter en 1997, conservant le nom bien plus connu de Ruggieri, même si depuis longtemps plus personne de ce nom ne travaille dans cette entreprise.
7 Les titulaires du prix de Rome, lors de leur séjour à la villa Médicis, sont tenus depuis un siècle (1778) d’envoyer annuellement une œuvre à l’Académie des Beaux-Arts, qui procède à une évaluation du travail avant de l’exposer. Ainsi dans Le Temps du quinze juin dernier (1879) nous pouvons lire dans la rubrique « Nouvelles du jour » : « Les envois de Rome sont arrivés hier et ont été déposés dans la cour de l’hôtel des Beaux-Arts » (quai Malaquais) ». Suit une liste de peintures, sculptures, architecture (des études de bâtiments antiques) et gravures en taille-douce.
8 Byblis ou (comme ici) Biblis est une nymphe de l’antiquité qui pleura tellement de l’amour refusé par Caunos, son frère jumeau, qu’elle fut transformée en fontaine, ou en source selon les versions. Il s’agit vraisemblablement ici d’un plâtre d’Auguste Suchetet (1854-1832), qui a reçu le prix du salon pour cette œuvre. La statue n’a plus été vue après le salon, achetée par la famille Rothschild.
9 D’une façon surprenante, il est tellement courant que certaines œuvres ne soient pas réclamées à l’issue de expositions que les organisateurs prévoient le cas dans les règlements : « Les œuvres non réclamées ou dont les frais de retour ne nous seront pas parvenus un an et un jour après la fin de l’exposition, deviendront la propriété de l’organisateur ».
10 Peut-être José Villegas Cordero (1844-1921), directeur du Musée du Prado de 1901 à 1918.
11 Marià Fortuny i Marsal (1838-1874), peintre espagnol, ayant bénéficié d’un très grand succès de son temps.
12 Supplice dit du brodequin, qui pouvait s’appliquer aux pieds ou aux genoux.
13 Cette activité a été à la mode à partir de 1854. Un collage bien fait, à l’intérieur d’une potiche de verre, d’images ou de fragments de papiers pouvait donner l’illusion, de loin, d’une potiche peinte. Voir le feuilleton d’Horace de Vieil-Castel dans Le Constitutionnel du 18 juin 1854, très complet sur ce sujet.
14 Thomas Edison (1847-1931) inventeur et industriel américain dont le nom est apparu dans les journaux français à partir de 1871, notamment pour le télégraphe automatique, puis parlant.
15 Vraisemblablement le Bertillon que nous connaissons de nous jours à savoir Alphonse Bertillon (1853-1914), criminologue et anthropologue, pionnier dans le domaine de l’identification judiciaire. Le père, bien moins connu de nos jours, est Louis-Adolphe Bertillon (1821-1883), médecin et anthropologue, qui a eu lui aussi en son temps, affaire aux « antivax ».
16 Ce canon était à l’origine, en 1786 l’enseigne publicitaire d’un horloger du nom de Rousseau qui tenait boutique au 95 galerie de Beaujolais au Palais Royal. Cette galerie, à l’intérieur du jardin, est parallèle à la rue de Beaujolais où ont habité, bien plus tard, Colette et Jean Giraudoux. Grâce à une loupe soigneusement orientée, tous les jours à midi le soleil enflammait automatiquement la mèche du canon. La précision… horlogère de l’appareil était telle que, les jours de soleil évidemment, les habitants du quartier pouvaient régler leur montre à « midi pétante » comme on dit encore aujourd’hui. À la mort de l’horloger, peut-être, et après bien des vicissitudes, le canon a été déplacé à son lieu actuel et géré différemment, ainsi que l’indique la note suivante. On pourra aussi, note 19, lire des informations contredisant largement ce qui vient d’être écrit.
17 Dans Le Gaulois du treize mars, page deux, « Monsieur Lecoq », dans sa rubrique des « Nouvelles diverses » écrit ceci : « Vous connaissez la grande nouvelle ? Le canon du palais Royal n’est plus à sa place depuis deux jours. Donc, malgré le soleil précoce dont nous jouissons, il n’y a plus de détonation à midi, et les habitués du jardin, tout désorientés, ne savent plus comment régler leur montre. / Voilà trois ou quatre jours que dure cet état de choses, et déjà on fait courir à ce sujet les bruits les plus alarmants. […] / Nous sommes allés aux renseignements, et voici la vérité : Le canon du palais Royal n’est plus sur son socle de pierre, tout simplement parce qu’il avait besoin d’être réparé. Il est entre les mains de l’arquebusier, qui, depuis environ quarante-cinq ans, a le commandement en chef de cette pièce d’artillerie. / Puisque nous sommes ce sur sujet, ajoutons que chaque détonation coûte 37 centimes à l’État, plus les appointements du maître canonnier, qui ne sont pas considérables. Notons même que, depuis la création de cette charge, les appointements ont été réduits deux fois. / Autre détail : Après la défaite de la Commune, le canon du Palais resta, au mois de juin, huit jours sans se faire entendre, parce que le canonnier n’avait pas de poudre ! » En fait ce canon ne sera pas remis en place avant longtemps. Plusieurs spectacles (une polka, un numéro de revue) porteront le nom de Canon du Palais-Royal.
18 Aristippe, opéra en deux actes de Pierre Giraud (1764-1821) sur une musique de Rodolphe Kreutzer (1765-1831), dédié à sa majesté la reine de Hollande et créé à l’opéra de la rue Richelieu en mai 1908. Il n’est pas sûr que ce vieil opéra ait été vu par Jules Claretie qui pense vraisemblablement à l’arrangement pour violon et piano de l’ouverture, par le compositeur italien Niccolò Piccinni (1728-1800), qui vivait à Paris et y est mort.
19 Sans trop de publicité ce canon semble revenu en place en juin 1881, date à laquelle nous pouvons lire à la page trois de Vert-Vert, ce texte très contradictoire avec ce qui a été écrit supra en note 16. « Le canon régulateur du jardin du Palais-Royal sur les bordées duquel se sont réglées et se règlent tant de montres et d’horloges a une histoire très curieuse et peut-être peu connue. La borne granitique sur laquelle est braquée la petite pièce en cuivre qui fait explosion à l’heure de midi au moyen d’un appareil lenticulaire, quand il fait soleil, a été posée en 1641. Elle indique un point où passait diagonalement la ligne de l’enceinte de Paris de Charles V (1412), que le cardinal de Richelieu fit supprimer lorsqu’il fit bâtir le palais par Jacques Lemercier en 1629. / C’est sous l’administration du Régent que l’on exposa à la radiation solaire ce petit canon qui fut pour les Parisiens un objet de curiosité tel que la foule se pressait à l’heure de midi aux portes du jardin et s’entassait aux fenêtres des maisons voisines dans les rues Richelieu et des Bons-Enfants. / Il faut rappeler que le jardin du Palais-Royal était alors (1715) autrement vaste que celui que l’on voit actuellement. […] Il y a cent ans aujourd’hui, l’architecte [Victor] Louis, auteur du théâtre de Bordeaux, du Théâtre-Français et de l’Opéra (place Louvois), reçut l’ordre de transformer et d’écourter ce magnifique jardin au moyen de galeries que Philippe-Égalité mit en location d’une façon très avantageuse. / Vers cette époque, le canon régulateur changea de place. / Un limonadier restaurateur s’établit dans la rue de Beaujolais à côté des Frères-Provençaux ; il se nommait Cuisinier, — un nom bien en situation, on le voit. / Or cet industriel, afin d’attirer la clientèle dans son établissement, obtint de faire placer le canon régulateur à la croisée de l’étage où étaient ses salons. / Le canon fit fureur. / De grands personnages en vogue vinrent s’y restaurer et s’y rafraîchir pour voir partir le canon et régler leurs montres. / Quand le soleil faisait défaut, tel consommateur demandait, comme chose fort amusante, de mettre, avec son cigare, le feu à l’amorce du canon. / Cambacérès y prenait son chocolat à onze heures du matin et se rendait, au coup de midi, à la Convention. » Lire la suite de l’article, comprenant nombre d’autres anecdotes (on peut le demander ici).
20 Ainsi qu’il est indiqué au début de la note précédente, le canon est revenu à la fin du printemps 1881 mais a de nouveau été démonté en novembre ainsi que l’indique, page deux, un écho de L’Intransigeant (et d’autres titres) du deux novembre : « La désolation règne parmi les bourgeois qui ont l’habitude d’aller régler leur montre sur le canon du Palais-Royal. / En effet, il a dû être démonté à cause des travaux qu’on exécute dans le jardin. Des terrassiers s’occupent à niveler la pelouse voisine de la galerie d’Orléans. » La galerie d’Orléans est ce long espace rectangulaire mal défini, situé au sud du jardin, avant les colonnes de Buren, où sont installées depuis 1985 les fontaines cinétiques « Sphérades » de Pol Bury. Du temps de Jules Claretie, cette galerie était couverte.

21 Il faut imaginer le paisible jardin du Palais-Royal, de nos jours lieu de promenade indolente où chaque parisien à ses souvenirs, en un lieu à l’époque très populaire et animé de cafés, marchands ambulants, prostituées en nombre… Les aveugles en question étaient les musiciens. L’établissement se trouvait Galerie de pierre. Il était suffisamment connu pour servir de point de repère géographique dans un temps où les adresses postales étaient incertaines. Dans les journaux de l’époque plusieurs annonces indiquent « près du café des Aveugles » voire même « près des Aveugles ».
22 Charles Blondelet (1820-1888) a aussi été auteur d’inoubliables vaudevilles en un acte La-i-tou et Tralala et surtout de Ah, il a des bottes, Bastien à la fin des années 1850, que Jules Claretie, bien trop jeune, n’a pas pu voir. On a pu entendre Charles Blondelet chanter dans quelques œuvres d’Offenbach ou de Charles Lecocq.
23 Redingote ample à pèlerines étagées pour se protéger du froid ainsi qu’en portaient les cochers, selon le Tlfi qui cite : « Transie de froid, elle avait caché sa tête sous le dernier collet de mon carrick ».
24 Dominique Séraphin (Dominique-Séraphin François, 1747-1800) a fondé en 1772 le premier spectacle d’ombres chinoises en France, à Versailles. En 1784 il s’est établi au Palais-Royal, galerie Valois. Ses neveux s’installent ensuite sur les grands boulevards, passage Jouffroy, proche du théâtre du Gymnase.

Le théâtre Séraphin, lithographie de Gustave Doré, 1854
25 Actif pendant la Commune, Simon Mayer (1820-1887), personnage controversé, fut condamné à mort en novembre 1871, peine commuée en travaux forcés à perpétuité en février 1872. En mars Simon Mayer fut déporté en Nouvelle Calédonie. Sa peine fut amnistiée en 1879 et Simon Mayer rentra à Paris. On peut imaginer qu’à l’époque, l’expression « revenu de Nouméa » était claire pour tout le monde.
26 Simon-Mayer, Souvenirs d’un déporté — Étapes d’un forçat politique, Dentu 1880, au Palais-Royal, 15-17-19, galerie d’Orléans, 460 pages. Les faits décrits dans son ouvrage par Simon-Mayer ne sont pas à prendre sans précautions.
27 Eugène Guinot (1805-1861), avocat et homme de lettres, auteur dramatique sous le nom de Paul Vermond. L’article n’a pas été retrouvé mais cette histoire de quart d’heure était récurrente dans la presse, comme dans le bulletin météo du Siècle du neuf janvier 1878 qui nous explique : « Le soleil passe toujours au méridien à midi vrai, au moment où le cadran solaire marque midi, et où part le canon du Palais-Royal, mais ce midi n’est pas absolument fixe, la terre se mouvant avec plus ou moins de rapidité, selon qu’elle est plus ou moins rapprochée du soleil. Pour les besoins journaliers ce temps vrai est incommode ; tantôt il avance, tantôt il retarde. On a donc imaginé un temps moyen qui ne varie jamais, comme si la terre avait toujours la même vitesse pendant sa révolution annuelle. […] Il est donc absurde de régler sa montre sur le canon du Palais-Royal, comme le font un grand nombre de personnes ; plus la montre sera bonne et plus elle paraîtra se détraquer. Ainsi, le 11 février, lorsque le canon du Palais-Royal annoncera le midi vrai, l’horloge qui se trouve au fronton du même palais, indiquera midi 14 minutes 30 secondes, soit près d’un quart d’heure de différence. » Eugène Guinot a déjà été évoqué dans La Vie à Paris du neuf mars 1880.
28

Shakespeare, Roméo et Juliette, acte III, scène VI dans la traduction de Jean-Michel Déprats pour l’édition bilingue de La Pléiade en 2002, pages 362-365
29 Souvenir de La Princesse de Trébizonde, opéra-bouffe en trois actes de Charles Nuitter et Étienne Tréfeu sur une musique de Jacques Offenbach, créé à Baden-Baden en juillet 1869 puis au théâtre des Bouffes-Parisiens à la fin de la même année. Malheureusement pour cet opéra, la guerre de 1870 survint six mois plus tard et l’on se ressouvint alors que Jacques Offenbach, naturalisé Français en 1860 était d’origine allemande…
30 Thomas-Payen (Émile Thomas, 1829-13 juin 1880), chimiste (Arts et métiers) et ingénieur civil, directeur des Ateliers nationaux de la République de 1848. Ces Ateliers nationaux ouverts en février 1848, destinés à donner du travail aux nombreux chômeurs, produisaient surtout du terrassement au profit des travaux publics ou des compagnies de chemins de fer, nouvellement créées. Or tous les chômeurs n’étaient pas terrassiers et de plus étaient bien trop nombreux (on parle de 115 000). Cette organisation n’a duré que trois mois avant de s’interrompre en juin, débouchant sur les Journées du 22 au 26 juin.
31 Émile Thomas, Histoire des Ateliers nationaux considérés sous le double point de vue politique et social ; des causes de leur formation et de leur existence ; et de l’influence qu’ils ont exercée sur les événements des quatre premiers mois de la République, suivi de pièces justificatives, Michel Lévy 1848, 395 pages. La préface d’Émile Thomas est datée du 22 juillet.
32 Charles de Comberousse (1826-1897), professeur de mathématiques, président de la société des Ingénieurs civils de France. Histoire de l’école centrale des arts et manufactures depuis sa fondation jusqu’à ce jour, chez Gauthier-Villars, imprimeur-libraire du bureau des longitudes, de l’école Polytechnique, 55 quai des Augustins, 1879.
33 Jusqu’à la première guerre mondiale on trouvait à Paris plus d’une centaine de manèges, qui représentaient une activité très dynamique.
34 David d’Angers (Pierre-Jean David, 1788-1856) sculpteur romantique né à Angers, prix de Rome en 1811. En 1848, David d’Angers a été élu représentant du peuple et est entré à l’Assemblée constituante.
35 Ulysse Trélat (1795-1879), médecin en 1821, ministre des Travaux publics en mai 1848.
36 L’affaire — dont cette phrase précise — est décrite page 297 de l’ouvrage d’Émile Thomas indiqué note 31. Carbon-Blanc, de nos jours sur l’autoroute A10, à douze kilomètres au nord-est de Bordeaux.
37 À partir du début du siècle, alors que l’on écrivait encore en « ancien français » on trouve ce mot dans la presse dans son usage italien. Le correspondant de Saint-Pétersbourg (vraisemblablement un Russe francophone) de La Quotidienne du 19 octobre 1918, écrit : « Depuis six ans nous étions privés de spectacle français. L’ouverture s’en est faite hier par une opérette. » La Gazette de France du trois juillet 1920, page trois, évoque les prix de la partition d’une « chétive opérette ». Il faut attendre le Journal des débats du onze septembre 1928 (page deux) pour que le mot ne soit plus indiqué en italiques. La chronique musicale, non signée oppose l’usage de la Comédie-Française, qui est de placer dans la soirée, la pièce sérieuse avant la comédie : « À l’Opéra-Comique, on suit une marche opposée : L’opérette est placée en avant, elle est jouée pendant que la salle se remplit et l’auditoire n’est complet qu’au moment où le véritable opéra commence. »
38 La Presse du douze juin 1848, quatrième colonne de une : « M. Trélat, républicain de la veille, a fait enlever M. Émile Thomas absolument comme l’eût fait de quelque vilain quelque baron du XIIe siècle ! / L’Assemblée nationale, qui devant un pareil acte d’arbitraire, aurait dû, indignée, se lever comme un seul homme, est restée paisiblement assise, tant il est vrai que la France est toujours la même. / Semez-y de la liberté, il y poussera de l’arbitraire ! » Lire la suite de l’article, enrichi d’une lettre d’Émile Thomas.
39 Selon Delphine Dubois, des Amis d’Alexandre Dumas, en 1826, Alexandre Dumas (père, donc) a publié un recueil de trois nouvelles ; Laurette, Blanche de Beaulieu et Marie. Marie est une file déshonorée et sauvée des eaux. Il y a un duel et toutes ces choses dumassiennes. Delphine Dubois nous apprend que huit ans plus tard, en 1834, Alexandre Dumas reprend l’intrique de Marie : « Le principal changement réside dans la narration. Cette fois, Dumas se met en scène et apprend l’histoire de la bouche d’un cocher de cabriolet, ancien domestique du jeune [sauveteur de] Marie. L’intrigue […] est plus développée (la scène du sauvetage est plus dynamique, le suspense plus dense), la narration, faite par un domestique, est plus vivante et cocasse, voire drôle. Enfin Dumas choisit une fin moins tragique […]. »
40 Charles Nodier (1780-1844), poète, romancier, grammairien et bibliophile, rédacteur au Journal des débats en 1814, conservateur de la bibliothèque de l’Arsenal en 1823, protecteur des Romantiques, élu à l’Académie française à l’automne 1833. Lire le premier chapitre de La Femme au collier de velours : « En 1823, Charles Nodier fut appelé à la direction de cette bibliothèque, et quitta la rue de Choiseul, où il demeurait, pour s’établir dans son nouveau logement. » Charles Nodier a déjà été évoqué note 10 du texte frère « D’un siècle à l’autre » paru dans Le Temps du quinze juin 1880 et ici-même le quatorze avril 2025.
41 Isidore Taylor, auteur dramatique, est né à Bruxelles le jour de la Révolution française et mort 90 ans plus tard à Paris. Isidore Taylor a été « commissaire royal » (administrateur général) de la Comédie-Française de 1831 à 1838. Philanthrope il était, comme Charles Nodier, protecteur des Romantiques mais avec davantage de moyens. La rue de Bondy est l’actuelle rue René-Boulanger, qui commence place de la République.
42 Le trente mai 1878, à l’occasion du centenaire de la mort de Voltaire, Victor Hugo a prononcé un discours dans lequel il dénonçait les horreurs de la guerre : « Aujourd’hui la force s’appelle la violence et commence à être jugée, la guerre est mise en accusation ; la civilisation, sur la plainte du genre humain, instruit le procès et dresse le grand dossier criminel des conquérants et des capitaines. […] Dans beaucoup de cas, le héros est une variété de l’assassin. » Ce discours est intégralement reproduit en une du Voltaire daté du treize prairial an 85 (samedi premier juin 1878). Le programme de l’après-midi est annoncé dans le numéro de la veille. Rappelons que le théâtre de la Gaîté se trouvait alors près du square des Arts et métiers.
43 Charles Edmond (Charles-Edmond Chojecki, 1822-1899), écrivain et journaliste polonais naturalisé Français en février 1857. Charles Edmond a partagé avec Jules Claretie le pseudonyme commun de Jules Tibyl pour leur roman Le Ménage Hubert qui paraîtra chez Édouard Dentu en 1884 (315 pages). Ce roman est précédé d’Une journée à Bellevue, préface de Jules Claretie de 36 pages datée de septembre 1883. Jules Claretie a offert à Charles Edmond son roman Le Beau Solignac (Fayard 1876).
44 Victor Hugo, Les Feuilles d’automne, recueil de poèmes paru en 1831.
45 Automédon est d’abord un nom propre, celui du conducteur du char d’Achille. On le retrouve parfois utilisé sous forme de nom commun, désignant un cocher, dans la littérature du XIXe siècle.
46 Allusion possible à l’auteur dramatique et académicien Étienne de Jouy (1764-1846), encore connu de nos jours pour être le librettiste de La Vestale de Spontini en 1807 ou du Guillaume Tell de Rossini en 1829. Allusion moins sûre (« disait ») à l’archéologue et directeur du musée du Louvre Henry Barbet de Jouy (1812-1896), dont on se souvient encore aujourd’hui pour avoir sauvé le Louvre de l’incendie provoqué par les insurgés de la Commune.
47 Ces dactyles, spondées, iambes ou anapestes (inverse du dactyle) sont des éléments de la métrique antique basée sur l’alternance de syllabes longues ou courtes.
48 Le discours macaronique est assimilable au grommelot, langage inexistant et souvent incompréhensible imitant un langage réel. L’exemple le plus connu en français se trouve à la fin du Malade imaginaire :
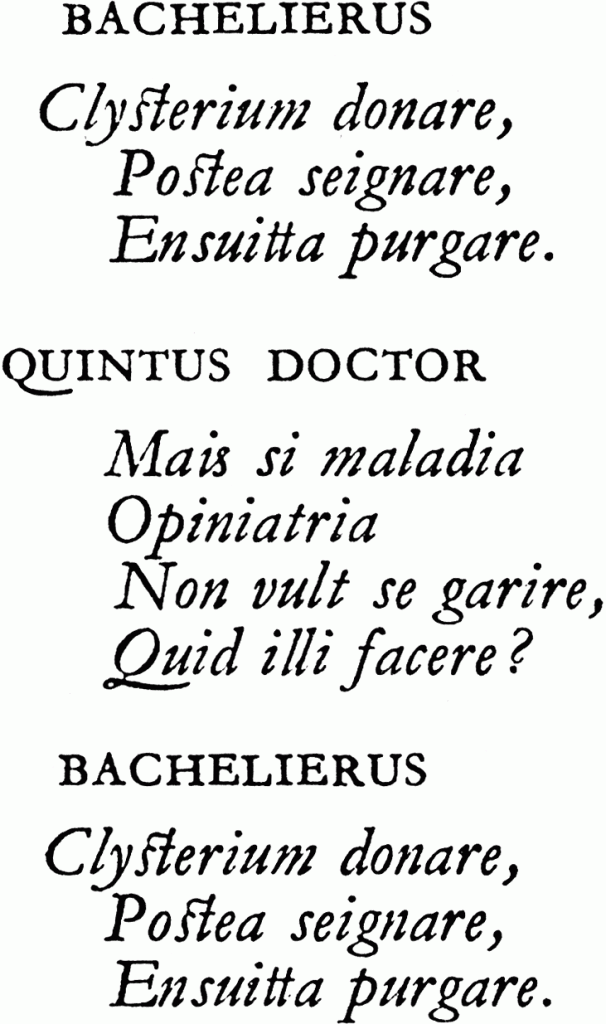
Pléiade de Georges Couton 1971, page 1175
49 Eugène Sue, Les misères des enfants trouvés, ou Les mémoires d’un valet de chambre : « Ego et animal sum et homo, non tamen duos esse nos dices. (Je suis en même temps animal et homme, sans qu’on puisse dire que je suis deux.) / Telle fut la citation latine dont l’homme-poisson, Léonidas Requin, nous salua en sortant de sa prétendue piscine. »
50 Communiqué reproduit à l’identique dans Le Globe et Le Gaulois du neuf juin et dans Le Petit journal du douze : « Une intéressante représentation théâtrale a eu lieu jeudi soir [donc vraisemblablement le trois juin 1880] à Oxford. L’Agamemnon d’Eschyle a été joué dans la langue originale par les élèves et les gradués [vraisemblablement « diplômés »] du Balliol Collège, qui ont réussi à reproduire, jusque dans les costumes et les moindres détails, le grand drame que le poète a donné aux Grecs cinq siècles avant l’ère chrétienne. / Ces représentations rappellent celles que Mgr Dupanloup organisa jadis, avec les élèves du séminaire de La Chapelle-Saint-Mesmin, et qui attirèrent tous les hellénistes de France et de Navarre. » Pour Félix Dupanloup, voir la note cinq de la Chronique du 18 mai 1880 : « Souvenirs de Gustave Flaubert ».
52 Garçon généreux et courageux.
.
