Sarah Bernhardt : Ma double vie
« Chronique théâtrale » de Francisque Sarcey
La fuite de Mlle Sarah Bernhardt
Notes
Ce n’est pas une Vie à Paris qui est donnée ici mais un dossier Sarah Bernhardt concernant sa démission de la Comédie-Française il y a trois jours, le 18 avril 1880. Ce dossier commence par la journée du 17 avril 1880 et celle du lendemain, telles que les décrit Sarah Bernhard dans ses Mémoires1.
Dossier mis en ligne le lundi quatre novembre 2024. Temps de lecture : 23 minutes.
Sarah Bernhard quittant la Comédie-Française après un échec fut l’événement théâtral saillant de ce printemps 1880. Plusieurs journaux ont largement commenté l’affaire — bien oubliée des lecteurs de notre siècle — et il paraît évident de devoir présenter ici la Chronique de Jules Claretie dans son contexte.
Dans ses écrits, Sarah Bernhard ne s’attarde pas dans les détails. Le lecteur de ses Mémoires le regrette souvent. Commençons donc par son récit, au tout début du chapitre XXX. Nous sommes évidemment au printemps 1880.
Respectant la chronologie viendra ensuite un fragment de la « Chronique théâtrale » de Francisque Sarcey parue dans Le Temps du 19 avril et enfin celle de Jules Claretie parue dans Le Temps du 21 avril.
Seule la première moitié de la Chronique de Jules Claretie est parue dans l’édition en volume de Victor Havard. Pour une raison qui demeure toujours aussi mystérieuse, ce chapitre est daté du dix avril, à une date à laquelle il ne s’était encore rien passé.
Sarah Bernhardt : Ma double vie
Les jours qui suivirent cette rentrée de la Comédie dans son foyer furent très énervants pour moi. Notre administrateur2 voulait me mater et, pour cela, il me faisait souffrir par mille petits coups d’épingle plus douloureux pour une nature comme la mienne que les coups de couteau. (Je le pense du moins, car je n’en ai jamais reçu.)
Je devenais malade, irritable et de méchante humeur à propos de tout. Moi si gaie, je devenais triste. Ma santé toujours chancelante se trouvait plus en péril par cet état de choses.
Perrin me distribua le rôle de l’Aventurière3. Je n’aimais pas ce rôle, je détestais la pièce, et je trouvais les vers de L’Aventurière de mauvais, très mauvais vers. Comme je sais mal dissimuler, je le dis nettement à Émile Augier dans un accès de colère. Il s’en vengea d’une façon discourtoise à la première occasion qui lui fut offerte.
Cette occasion fut ma rupture définitive avec la Comédie-Française, le lendemain de la première représentation de L’Aventurière, qui eut lieu le samedi 17 avril 1880.
Je n’étais pas prête à jouer ce rôle. J’avais été très souffrante, et la preuve en est dans cette lettre que j’écrivis à M. Perrin le 14 avril 1880 :
… Je suis désolée, Monsieur Perrin, mais j’ai un mal de gorge si complet, que je ne puis parler. Je suis forcée de garder le lit. Veuillez m’excuser. C’est à ce maudit Trocadéro que j’ai pris froid dimanche. Je suis bien tracassée, sachant que cela vous met dans l’embarras. Ça ne fait rien, je serai prête pour samedi, quand même.
Mille regrets et mille amitiés. — Sarah Bernhardt.
Je fus, en effet, prête à jouer, ayant guéri mon mal de gorge.
Mais je n’avais pu étudier pendant trois jours, ne pouvant parler ; je n’avais pu essayer mes costumes, ne pouvant sortir de mon lit. J’allai le vendredi prier Perrin de remettre à l’autre semaine la représentation de L’Aventurière. Il me répondit que la chose était impossible, que la location était faite et que la pièce devait être jouée le premier mardi, jour d’abonnement.
Je me laissai convaincre, ayant confiance en mon étoile. « Bah ! me disais-je, je m’en tirerai quand même. »
Je ne m’en tirai pas du tout ou, plutôt, je m’en tirai fort mal. Mon costume était manqué, il m’allait mal. Moi dont on narguait sans cesse la maigreur, j’avais l’air d’une théière anglaise. J’avais la voix encore légèrement enrouée, ce qui me désarmait un peu. Je jouai très mal la première partie du rôle ; mieux la seconde. À un moment de la scène de violence, je m’appuyai, debout, les deux mains sur la table qui portait un flambeau allumé. On cria dans la salle, car mes cheveux étaient près de la flamme4. Le lendemain, un journal disait que, sentant la partie perdue, j’avais voulu mettre le feu à mes cheveux pour faire cesser la représentation avant mon échec complet. C’était le comble des combles de la stupidité.
La presse ne fut pas bonne. Et la presse avait raison. J’avais été inférieure, laide et en méchante humeur ; mais je trouvais qu’on manquait de courtoisie et d’indulgence à mon égard. Auguste Vitu5, dans Le Figaro du 18 avril 1880, terminait son article par cette phrase :
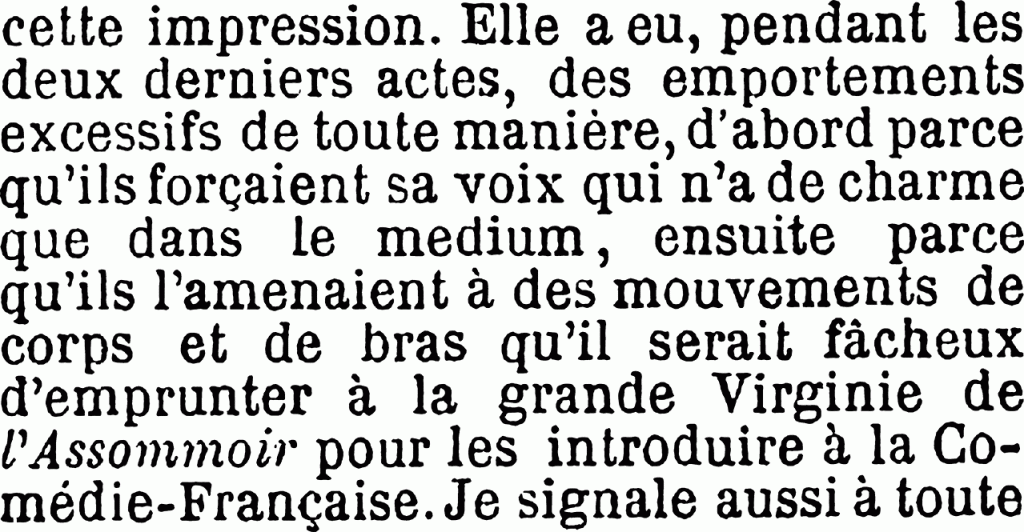
La nouvelle Clorinde (l’Aventurière) a eu pendant les deux derniers actes des mouvements de corps et de bras qu’il serait fâcheux d’emprunter à la grande Virginie de l’Assommoir6 pour les introduire à la Comédie-Française.
Le seul défaut que je n’ai jamais eu et que je ne pourrai jamais avoir, c’est la vulgarité. C’était donc une injustice et un parti pris de me froisser. Vitu, du reste, n’était pas mon ami.
Je compris à cette façon de m’attaquer que les petites haines dressaient leurs petites têtes de serpent à sonnettes. Tout le bas petit monde vipérin grouillait sous mes fleurs et mes lauriers, je le savais depuis longtemps, j’entendais parfois à la cantonade le cliquetis de leurs petits anneaux. Je voulus me donner la joie de les faire sonner tous à la fois. Je jetai mes lauriers et mes fleurs aux quatre vents. Je rompis brutalement le contrat qui me liait à la Comédie-Française et par cela même à Paris.
Je m’enfermai toute la matinée et, après mille et mille discussions avec moi-même, je me décidai à envoyer ma démission à la Comédie. J’écrivis donc cette lettre à M. Perrin, le 18 avril 1880 :
Monsieur l’Administrateur,
Vous m’avez forcée à jouer alors que je n’étais pas prête. Vous ne m’avez accordé que huit répétitions sur la scène et la pièce n’a été répétée que trois fois dans son ensemble. Je ne pouvais me décider à paraître devant le public. Vous l’avez absolument exigé. Ce que je prévoyais est arrivé. Le résultat de la représentation a dépassé mes prévisions. Un critique a prétendu que j’avais joué Virginie de L’Assommoir au lieu de doña Clorinde de L’Aventurière. Que Zola et Émile Augier m’absolvent. C’est mon premier échec à la Comédie, ce sera le dernier. Je vous avais prévenu le jour de la répétition générale. Vous avez passé outre. Je tiens parole. Quand vous recevrez cette lettre, j’aurai quitté Paris. Veuillez, Monsieur l’Administrateur, recevoir ma démission immédiate, et agréer l’assurance de mes sentiments distingués. — Sarah Bernhardt.
Pour que cette démission ne puisse être discutée au comité, j’envoyai ma lettre copiée aux journaux Le Figaro7 et Le Gaulois, qui la publiaient au moment où M. Perrin la recevait. Puis, décidée à ne pas me laisser influencer, je partis de suite avec ma femme de chambre pour Le Havre. J’avais donné l’ordre de ne dire à personne où j’étais, et je restai toute la soirée de mon arrivée dans le plus strict incognito. Mais, le lendemain matin, des gens m’avaient reconnue et avaient télégraphié à Paris. Je fus assaillie de reporters.
⁂
Parce qu’il a déjà été évoqué dans la page Jules Claretie aux champs, c’est la courte intervention de Francisque Sarcey dans sa bien plus longue « Chronique théâtrale » du Temps du 19 avril qui est reproduite ici.
« Chronique théâtrale » de Francisque Sarcey
La Comédie-Française a repris avec un certain éclat l’Aventurière de M. Émile Augier. Comme Mlle Sarah Bernhardt avait manifesté l’intention de jouer le rôle de Doña Clorinde, aux représentations qu’elle a promis de donner le mois prochain à Londres, M. Perrin a cru qu’il valait mieux réserver pour les Parisiens la primeur de ce plaisir. II a donc remis à l’étude le chef-d’œuvre d’Émile Augier.
Il a pressé les répétitions, et il a bien fait. Les échos du théâtre nous ont apporté le bruit d’une discussion très vive entre l’éminente comédienne et son directeur. Elle se plaignait, dit-on, de n’avoir eu que dix-huit répétitions. Eh diantre ! c’est bien assez pour une pièce qui est restée au répertoire courant, dont la mise en scène est sue et réglée depuis longtemps. Jadis il n’en fallait pas davantage pour monter une comédie nouvelle, une comédie en cinq actes, s’il vous plait. C’est que les artistes étudiaient leur rôle à la maison ; c’est qu’ils arrivaient au théâtre le sachant, sûrs de leur mémoire et de leurs effets, et que la répétition ne leur servait plus qu’à apprendre les entrées, les sorties, les mouvements, les jeux de scène, tout ce qui en effet ne peut s’apprendre que sur les planches mêmes.
Les amis de Mlle Sarah Bernhardt assurent qu’elle était hier soir sous le coup d’une émotion extraordinaire, et qu’elle se tenait à peine, au moment de paraître devant le public. Il y aura donc lieu d’attendre, avant de la juger définitivement dans ce rôle.
Je ne crois pas, malgré le succès très bruyant qu’elle y a obtenu, malgré les ovations répétées qui lui ont été faites, malgré un enthousiasme indéniable, et que je ne veux point contester, non, je ne crois pas qu’elle y ait été bonne, et si toute autre qu’elle l’eut joué de la sorte, je pense que le public l’eût avertie de son erreur par un silence glacial. Mais elle a l’oreille du public ; et il lui suffit de se montrer pour enlever tous les cœurs et mettre toutes les mains en mouvement.
Son costume ne m’a point paru heureux, et j’ajoute que, sur ce point, j’ai trouvé tout le monde d’accord, sauf quelques enragés fanatiques. On m’assure qu’il est copié sur un tableau de maître italien, et que le tableau est superbe. À la bonne heure ! Mais j’en reviens toujours là : en fait de costume, au théâtre, il faut préférer à la réalité exacte un habillement qui en donnant la tradition du personnage imaginé par l’auteur convienne en même temps au type de personnage de l’artiste.
Tenez ! on nous a conté qu’on avait durant six mois exécuté des fouilles profondes pour retrouver le vrai costume d’Attila, afin d’en revêtir Dumaine8. Or ce costume véritable, vous pouvez tous l’aller vérifier, ça fait juste l’effet d’une robe de chambre. Dumaine est assez ridicule là-dessous. J’aimerais bien mieux que le costume fût moins vrai et qu’il me donnât plus l’idée du terrible roi des Huns.
Mlle Sarah Bernhardt nous est arrivée avec une sorte de coiffure qui ressemblait, comme deux gouttes d’eau, à un béguin de nuit.
Le béguin était doré, et de dessous s’échappait une énorme chevelure qui flottait librement sur les épaules. Elle était avec cela vêtue d’une vaste robe qui lui étouffait considérablement le corsage… Mlle Sarah Bernhardt étouffée !… Mais ce n’est plus notre Sarah ! et il faut bien croire que cette toilette la gênait, car quand elle marchait irritée, et qu’en la voyant de dos, elle se livrait à ces mouvements d’épaule, par lesquels, nos actrices de drames figurent la colère chez les femmes du dernier peuple. Quelqu’un à côté de moi disait : Mais c’est la grande Virginie un jour de carnaval.
Tout cela, n’est pas grave, se pouvant corriger aisément. Le dessinateur et le costumier se sont trompés et voilà tout.
Ce qui m’inquiète davantage, c’est la façon dont Mlle Sarah Bernhardt a pris le rôle. Doña Clorinde est une hardie coquine, une intrigante de haute volée, jadis comédienne, et qui a traîné tout un public derrière son char de triomphe. Elle joue maintenant à la femme comme il faut, à la grande dame. Elle est supérieure dans ce rôle comme dans tous les autres ; mais elle y porte cet air délibéré, ce ton d’assurance hasardeuse qui forment le fond de son caractère.
II y a toujours quelque chose de théâtral, même dans ses accès de vertu. Quand, au troisième acte, elle se résout à repousser l’idée de s’emparer du prince, avec quelle magnificence parle-t-elle de ce désintéressement, qui lui paraît la chose la plus admirable du monde, bien que ce ne soit que de la simple honnêteté !
Aussi quand elle tombait, au quatrième acte, aux pieds de son vainqueur, terrassée par l’amour, un amour vrai cette fois, le contraste était des plus saisissants.
Mme Plessy9 rendait merveilleusement ces nuances. Je ne la trouvais faible que dans les moments pathétiques. Elle n’a jamais su trouver, dans cette voix enchanteresse que la nature lui avait départie, les accents de l’émotion profonde. Mais comme elle avait composé ce personnage !
Il serait fort difficile de savoir au juste ce qu’en a voulu faire Mlle Sarah Bernhardt. On dirait qu’elle est allée un peu au hasard, comptant sur sa diction incomparable pour charmer le public. Elle n’a pas donné de physionomie à cette Clorinde. Elle a, grâce à un procédé qui lui est familier, procédé fort dangereux d’ailleurs, passé brusquement, par des sauts inattendus, des câlineries de voix les plus exquises à des cris farouches ; d’un rapide déblayage, qui précipitant les alexandrins les uns par-dessus les autres comme des capucins de cartes à des accentuations lentes et martelées de tel vers choisi par elle, et quelquefois sans grand raison. Tout cela point fondu, point harmonieux.
Est-ce à dire que Mlle Sarah Bernhardt ait été médiocre ? Eh non ! Il a des passages qu’elle a dits à merveille. Mais elle n’a pas pris la peine de composer son rôle, cela est certain ; mais elle force à de certains endroits et la voix et le geste, et c’est (malheureusement pour elle) à ces endroits-là qu’elle est la plus applaudie. On la perd et elle se perd. C’est dommage, car on n’a pas plus de talent ni de charme. Ah ! que n’a-t-elle toujours présents à l’esprit ces vers que Rachel disait d’une voix si terrible :
Détestables flatteurs, présent le plus funeste,
Que puisse faire aux rois la vengeance céleste !
Il y a des rois de théâtre, et surtout des reines.
⁂
Lisons maintenant la Chronique de Jules Claretie parue dans Le Temps du 21 avril, pages deux et trois :
La fuite de Mlle Sarah Bernhardt

C’est la grosse nouvelle parisienne du moment. Mlle Sarah Bernhardt, furieuse, dit-on, contre la critique, contre son directeur, contre tout le monde, secoue la poussière de ses souliers et s’écrie, en partant, comme cet ancien10 : Ingrate patrie, tu n’auras pas mes os ! C’est une enfant gâtée qui n’admet pas qu’on la discute et qui finira par lasser — si elle ne l’a point fait déjà — la sympathie de ses amis et la bienveillance, parfois enthousiaste, du public.
Mlle Sarah Bernhardt, en prenant ainsi brusquement la fuite, en rompant, un beau matin, de solennels engagements, en adressant, pour la seconde fois en une année, sa démission au comité de la Comédie-Française11, vient tout simplement de souligner, avec une évidente maladresse, le léger insuccès qu’elle pouvait avoir eu, samedi dernier, en jouant Clorinde de l’Aventurière. Nous, qui ne l’avions pas vue, qui avions seulement lu les articles de la critique et qui pouvions croire, soit à la sévérité des juges, soit à une indisposition de la comédienne, nous disons, je l’avoue, très bourgeoisement (et très logiquement) aujourd’hui :
— Ah ! ça ! elle était donc bien mauvaise ?
Non, elle avait tout simplement effleuré et joué de chic, comme on dit, un personnage qui a besoin d’être profondément étudié pour être bien rendu. Mlle Sarah Bernhardt embrasse trop pour assez étreindre. Elle se démène et se surmène. L’emploi de ses journées ferait frémir un colosse de force. Levée très tôt, elle courait, en ces derniers jours, à neuf heures du matin, au théâtre des Variétés, répéter Frou-Frou ou les pièces qu’elle doit jouer à Londres. Cette première répétition à peine achevée, vite elle se jetait dans sa voiture, arrivait chez elle, y trouvait des amis ou des solliciteurs l’attendant, les recevait, déjeunait le chapeau sur la tête, en hâte, tout en causant, repartait pour la rue Richelieu, répétait ou plutôt récitait le rôle de l’Aventurière, qu’elle avait à la main et quelle ne s’était pas donné la peine d’apprendre, songeait à partir, partait, rentrait, faisait un peu de sculpture, un peu de peinture12, recevait ses amis, posait pour un peintre ou pour un graveur, donnait des conseils littéraires aux poètes inédits qui lui apportaient des manuscrits, songeait à la toilette qu’elle mettrait le soir pour aller réciter avec Coquelin quelque saynète chez M. de Hirsch13 ou ailleurs, bref, n’avait pas un moment, pas une minute de cette liberté d’esprit que réclame la composition d’un personnage qui doit vivre, agir, parler, penser devant le public.
Tout art particulier est jaloux et le théâtre plus que les autres. Il n’admet point le partage. Il ne veut point qu’on flirte avec lui, il exige qu’on se donne tout entier, corps et âme. Mlle Sarah Bernhardt me paraît agitée de cette maladie toute moderne qu’on appelle le nervosisme. Tout la séduit, tout l’attire. Admirablement organisée, mais mal pondérée, douée d’une vitalité prodigieuse sous sa frêle et élégante apparence, elle soulèverait des montagnes pour ne pas demeurer inactive.
L’an dernier, au moment de partir pour Londres, elle voulait prendre des leçons d’anglais.
— Bien, madame, lui dit sa professeur. À quelle heure faudra-t-il venir ?
— À une heure du matin, après le théâtre. Le reste du temps, mes moments sont pris.
Et elle disait vrai. Et elle se harasse ainsi à poursuivre tous les papillons que fait, devant ses yeux, danser sa fantaisie. Et lorsqu’elle se trouve en face d’un rôle pareil à celui de Clorinde, elle l’apprend comme elle apprendrait une pièce de circonstance qu’elle devrait réciter le soir, en l’honneur de Racine, de Corneille ou d’Hugo.
Bref, elle est partie. Elle a renouvelé, à plusieurs années de distance, avec M. Perrin, le coup de tête qu’elle avait fait au Gymnase avec M. Montigny14. Ses ennemis disent tout bas qu’elle cherchait depuis longtemps un prétexte. L’an dernier, elle avait renoué avec la Comédie (M. d’Heylli raconte toute cette histoire dans son curieux volume sur la Comédie-Française à Londres) parce que le traité qu’on lui offrait pour l’Amérique ne lui paraissait pas suffisamment solide. Cette fois elle aurait trouvé un impresario qui lui assurerait des conditions extraordinairement avantageuses, et elle se serait précipitée sur la première occasion offerte. Offerte… par elle.
Voilà ce que disent les adversaires. Les amis, — et Mlle Sarah Bernhardt en a beaucoup, depuis le maréchal Canrobert15 et M. Guillaume Guizot16 jusqu’à M. Clairin17 et M. Busnach18, — assurent que la précipitation avec laquelle on a joué l’Aventurière a seule irrité la tragédienne, et que, les articles de journaux arrivant par là-dessus, le désespoir a fait place à l’irritation. Nervosisme, disions-nous tout à l’heure.
Ce qui est stupéfiant en cette affaire, c’est l’attitude de certains reporters faisant des excuses à l’actrice au nom de la critique :
— Eh ! madame ! Oui, vos juges ont dépassé le but ! Mais le public, le vrai public, le bon public cassera leurs jugements !
Voilà une singulière façon et bien inattendue de respecter la critique et un moyen d’encourager les exigences actuelles des étoiles. Les étoiles, aujourd’hui, depuis Mlle Sarah Bernhardt, qui plante là la Comédie, jusqu’à Humberta19, qui demande la communication des manuscrits des opérettes avant de risquer là-dessus sa « renommée », les étoiles rendent bien malheureux et les auteurs et les astronomes mêmes qui les ont découvertes. Pourquoi M. Sardou a-t-il choisi Mlle Bartet20 pour créer Daniel Rochat ? Parce qu’il la savait malléable, capable de l’écouter, de jouer comme il voudrait. Il lui a fait modifier sa manière de dire le jour même de la première représentation, sans craindre d’elle un excès de nervosisme.
Un jour Mlle Rousseil21 dit à M. Sardou :
— Je jouerai volontiers Dolorès de Patrie22, mais à la condition que vous la rendiez sympathique !
C’est extraordinaire. Que voulez-vous dire à cela ? J’ai vu une pièce tuée par une tragédienne qui n’entendait se plier ni à la volonté de l’auteur ni aux ordres du directeur, et, comme le directeur avait besoin d’argent, on joua malgré l’auteur un drame qu’il ne put corriger comme il l’entendait.
Maintenant, que va faire la Comédie-Française ? Un procès. Elle y est forcée. Un cas analogue s’est produit en 1845. Mme Arnould-Plessy23, qui devait être justement la Clorinde de l’Aventurière, écrivit un matin, de Saint-Chéron (près Arpajon) au régisseur du Théâtre-Français, une lettre où elle lui disait : « Je suis très contrariée, la fièvre me dévore. Je tremble, je grelotte, j’ai peur d’un transport au cerveau… Écrivez-moi, ma mère vous répondra ! »
Mlle Sylvanie Plessy — alors jeune fille — quittait le théâtre pour épouser M. Auguste Arnould, homme de lettres ; d’autres disaient pour aller jouer en Russie à des conditions superbes offertes par le général Guédéonof de la part du tzar Nicolas.
Ce fut un beau tapage dans Paris, et la fugue de Mlle Plessy égaya longtemps les petits journaux. On la comparait à la fuite de Mlle Raucourt24 se sauvant de Paris, à franc étrier, sous un uniforme de dragon, en 1776, et se cachant, aux environs de Paris pour éviter ses créanciers. M. Buloz25 fit écrire par M. Verteuil26 à Mlle Plessy une lettre où il lui enjoignait de venir répéter le lendemain l’École des Vieillards27. Samson28 fut dépêché vers la fugitive. M. Regnier29 lui écrivit :
Venez-vous expliquer. Ou écrivez. Fixez le temps de votre retour. Que votre lettre soit bonne, affectueuse, et soyez sûre que les choses s’arrangeront mieux que vous ne pensez.
Votre affectionné et sincère ami,
Regnier
Ah ! bien oui ! Mlle Plessy ne voulait rentrer au théâtre que deux ans après. En revanche, elle offrait de donner à la Comédie onze années au lieu de huit années de service. Sa lettre à ses « chers camarades » était polie, mais nette.
On plaida. La Comédie réclamait à la sociétaire rompant ainsi ses engagements 200 000 francs de dommages-intérêts et 20 000 francs à titre de provision. Le tribunal ne condamna Mlle Plessy qu’à 6 000 francs de provision, remettant à statuer après vacation sur la demande principale des 200 000 francs de dommages-intérêts.
À Saint-Pétersbourg, Mlle Plessy touchait 45 000 roubles d’appointements, plus un cadeau annuel, par traité, de 9 000 roubles, à titre de prime. Elle rentra d’ailleurs rue de Richelieu, grâce à Samson, sans rien payer — pas même les frais du procès30.
Je ne sais comment les choses se passeront avec Mlle Sarah Bernhardt, mais la tragédienne d’aujourd’hui doit certainement connaître l’histoire de la comédienne de 1845. Elle voyagera en Amérique, y récoltera des applaudissements et des dollars, et rentrera rue de Richelieu sans que ses camarades lui tiennent plus longtemps rigueur. Ah ! femmes ! femmes !
Mais le public s’irrite, à la fin, de ces caprices, et des lettres pareilles à celle de M. Émile Augier sont dures. Mlle Sarah Bernhardt est, dit-on, au Havre, à Sainte-Adresse, regardant la mer aux flots moins changeants que les sympathies de la foule.
De ce qu’elle fait, dit et pense, ses amis ne savent rien.
— Je sais seulement, m’affirme l’un d’eux, que Sarah revient à Paris jeudi31.
Il y aura, alors, de l’orage — rue Fortuny32 ou rue de Richelieu.
⁂
Voici, à titre de curiosité, quelques détails sur les conditions dans lesquelles la démission de Mlle Sarah Bernhardt a été donnée :
Dimanche, à sept heures moins dix minutes, au moment où M. Émile Perrin, administrateur de la Comédie-Française, se disposait à quitter le théâtre pour rentrer dîner chez lui, on lui remit une lettre, qu’à la seule écriture de l’enveloppe, il reconnut pour être de Mlle Sarah Bernhardt. Nous en avons donné hier le texte33.
M. Perrin, croyant à une fantaisie passagère, ne tint pas compte de cette lettre et fit annoncer pour le mardi suivant une représentation de l’Aventurière, comme si aucun incident ne s’était produit.
Toutefois, et par mesure de précaution, il fit d’urgence convoquer le comité pour hier lundi, à deux heures précises, se réservant de donner alors lecture de la lettre de Mlle Sarah Bernhardt si, d’ici là, elle n’avait pas retiré sa démission.
Celle-ci, de son côté, avait pris à six heures trente minutes l’express du Havre, où elle arrivait à onze heures, et où elle est actuellement.
En ouvrant la séance du comité, M. Émile Perrin annonça que, n’ayant pas à entrer en polémique avec Mlle Sarah Bernhardt, il avait adressé à M. Émile Augier la lettre suivante :
Paris, 18 avril, 1880
Mon cher Augier,
L’Événement et le Gaulois publient, ce matin, une lettre de Mme Sarah Bernhardt34 qui m’est adressée et que j’ai en effet reçue hier soir, à sept heures, en même temps qu’elle en adressait copie aux journaux, dont elle réclamait la publicité. J’avais fait convoquer le comité d’administration pour aujourd’hui afin de lui donner communication d’un fait dont je pouvais douter encore, qui est maintenant accompli et connu de tous. Mme Sarah Bernhardt a quitté Paris, elle prétend rompre son contrat envers la Comédie-Française, ceci est affaire entre elle et nous. Mais si Mme Sarah Bernhardt s’inquiète peu des égards qu’elle doit au public, à la presse, aux auteurs, au Théâtre, si elle ne se soucie point du préjudice qu’elle porte à une compagnie qui l’a reçue dans son sein et qui lui a donné tant de marques de sympathie, la Comédie-Française, doit avoir souci des intérêts qui se trouvent gravement lésés par la faute d’un de ses membres. La reprise de l’Aventurière s’annonçait comme un grand succès, vous aviez droit d’y compter. Devant ces représentations si inopinément interrompues, je vais demander au comité de fixer le chiffre d’une indemnité qui vous est due et que je vous supplie d’accepter.
Je n’ai pas besoin, mon cher Augier, de rétablir auprès de vous et dans leur simple vérité les faits si étrangement défigurés par la lettre de Mme Sarah Bernhardt. Elle avait besoin d’un semblant de prétexte, elle a imaginé de me mettre en cause, je ne sais vraiment pas pourquoi. C’est vous-même qui, depuis le 20 mars, avez dirigé toutes les répétitions de l’Aventurière avec un soin et une exactitude qui témoignaient aux artistes choisis par vous quel intérêt vous attachiez à cette reprise.
Il y a eu dix-huit répétitions. Quand vous avez jugé la pièce prête, on a désigné le jour de la représentation. Je ne l’ai pas imposé, cela n’est pas dans mes habitudes, ni dans les usages de la maison. Tout le monde était d’accord, le jour fixé convenait à tous, même à Mme Sarah Bernhardt, qui, en s’excusant de ne pas assister à la répétition de mardi dernier, ajoutait : « N’ayez, du reste, aucune inquiétude, mon cher monsieur Perrin, je serai absolument prête pour samedi. »
Vendredi dernier, à la suite de la répétition générale, elle me faisait avertir par M. Delaunay35, qui remplissait les fonctions de semainier36, qu’elle ne jouerait pas le lendemain. Vous étiez dans mon cabinet, M. Delaunay vous demanda si vous vouliez voir Mme Sarah Bernhardt ; je vous priai de lui donner avis que je me mettais à sa disposition et que, si elle le désirait, la représentation serait remise au samedi suivant. Quelques minutes après, vous reveniez me dire qu’elle consentait à jouer. L’affiche fut donc maintenue et la pièce jouée samedi.
Vous voyez, mon cher ami, par ce simple exposé des faits, combien les allégations contenues dans la lettre de Mme Sarah Bernhardt sont peu conformes à la vérité.
En terminant, j’insiste de nouveau pour que vous veuillez bien régler avec moi la question d’indemnité ; il y va, ce me semble, de la dignité de notre maison qui vous porte un préjudice bien involontaire. Il n’est que juste qu’elle vous en tienne compte.
Veuillez croire, mon cher Augier, à mes meilleurs et mes plus dévoués sentiments.
Signé : É. Perrin.
À l’unanimité, le comité approuva la lettre de M. Émile Perrin, qui donna ensuite lecture de la réponse que lui avait adressée M. Émile Augier.
Paris, 19 avril 1880
Mon cher Perrin,
Je vous remercie de la sollicitude que vous montrez pour mes intérêts matériels, après tous les soins que vous avez donné à mes intérêts littéraires, lesquels me sont de beaucoup les plus chers ; mais, je vous en prie, ne parlez pas au comité d’une indemnité que je ne pourrais pas accepter, par la bonne raison qu’elle ne m’est pas due, l’administration du Théâtre-Français n’ayant pas l’ombre d’un reproche à se faire dans cet incident ridicule.
Les choses se sont en effet passées exactement comme vous le rappelez dans votre lettre. Vous auriez pu ajouter à l’appui que M. Febvre37, aussi nouveaud au […]38 la pièce que Mlle Sarah, n’ayant pas eu plus de répétitions qu’elle, mais n’en ayant pas manqué une seule, s’est trouvé assez prêt pour remporter le grand succès que nous savons.
S’il y a un coupable en tout cela, c’est moi, qui, en portant parole pour vous à notre charmante tragédienne, en lui donnant carte blanche de votre part, l’ai pressée, j’en conviens, de jouer le lendemain. Pourquoi ? Parce qu’à mon avis elle était aussi prête qu’elle peut l’être ; et je maintiens encore qu’elle a joué aussi bien qu’à son ordinaire, avec les mêmes défauts et les mêmes qualités, où l’art n’a rien à voir ; et j’ajoute avec les mêmes applaudissements d’un public idolâtre.
Après la représentation, je l’ai trouvée dans sa loge, rayonnante, au milieu de son flot d’admirateurs et se promettant de jouer mardi encore mieux, s’il est possible.
Que s’est-il donc passé dimanche ?
La presse s’est permis quelques observations, et Mlle Sarah ne les aime pas. — À qui la faute ? À MM. les critiques qui l’ont jusqu’ici traitée en enfant gâtée. Ces Athéniens ingrats commencent-ils à se lasser de son succès et à ne plus le trouver juste ? Ce n’est pas elle, en tout cas, qui écrira jamais, comme Aristide, son propre nom sur la coquille39 : elle aime mieux y écrire le vôtre, et c’est bien naturel, avouons-le.
Soyons donc indulgents pour cette incartade d’une jolie femme, qui pratique tant d’arts différents avec une égale supériorité, et gardons nos sévérités pour des artistes moins universels et plus sérieux.
Bien à vous,
É. Augier
Le comité, à l’unanimité, décida qu’il y avait lieu de convoquer pour aujourd’hui mardi, à quatre heures, le conseil judiciaire de la Comédie-Française, à l’effet d’aviser d’urgence aux mesures juridiques prendre, s’il y avait lieu, contre Mlle Sarah Bernhardt, pour le fait de sa démission en dehors de tout délai réglementaire, et de son départ non autorisé et contraire aux statuts.
En attendant, et pour bien établir le refus de service de Mlle Sarah Bernhardt, M. Émile Perrin a envoyé chez elle, hier dans la soirée. La personne chargée de se procurer des renseignements a trouvé la maison de la rue Fortuny hermétiquement close, portes et volets fermés, du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. Les voisins, interrogés, ont déclaré, dit le Figaro40, que tout le monde était parti depuis la veille, et, de fait, aucune lumière ne se voyait à l’intérieur, et personne n’a répondu aux trois coups de sonnette successifs de l’envoyé de M. Émile Perrin.
Notes
1 Sarah Bernhardt, Ma double vie — Mémoires, Fasquelle 1907.
2 Émile Perrin (1814-1885), administrateur général de la Comédie-Française de 1871 à sa mort. Émile Perrin sera remplacé par Jules Claretie.
3 Émile Augier, L’Aventurière, comédie en cinq actes, en vers créé sur le « théâtre de la République » (Comédie-Française) le 23 mars 1848. La scène se déroule à Padoue au XVIe siècle. Monte-Prade, vieillard stupide, s’énamoure d’une courtisane plus très fraîche, qui cherche à se faire épouser. Le texte de la pièce est paru chez Hetzel la même année.
4 Voir le compte rendu du « Strapontin de l’orchestre » dans Le Figaro du 18 avril, page trois, à la même page que l’article d’Auguste Vitu.
5 Auguste Vitu (1823-1891), journaliste et homme de lettres.
6 L’Assommoir, d’après Émile Zola, drame en cinq actes de William Busnach et Octave Gastineau, avait été créé le 18 janvier 1879 au théâtre de l’Ambigu-Comique. La pièce met en scène cinq personnages, dont la grande Virginie, future épouse Poisson dans le roman, qui avait été interprétée par la jeune Lina Munte (19 ans). Voir la « Chronique » de Jules Claretie dans Le Temps du premier mai 1879 à propos du bal costumé donné par le directeur de l’Ambigu afin de célébrer la centième représentation de la pièce. Pour ce théâtre, voir aussi la page « Une soirée à l’Ambigu »
7 Lire « Le Dossier Sarah Bernhardt » en une du Figaro du vingt avril (trois colonnes), signé Auguste Vitu, qui donne tous les détails de cette affaire. Lire aussi, en une du Gaulois du 19 avril « Un coup de tête », signé Georges Boyer (une demi-colonne). Voir aussi L’Événement.
8 Allusion au rôle d’Attila tenu par Louis Dumaine (1831-1893) dans Les Noces d’Attila d’Henri de Bornier le 23 mars dernier à l’Odéon.
9 Jeanne Arnould-Plessys (1819-1897) avait tenu le rôle de Doña Clorinde lors de la création en mars 1848, au côté de Pierre-François Beauvallet. Voir Georges d’Heylli, Madame Arnould-Plessys (1834-1876), notice avec documents recueillis aux archives du Théâtre-Français, Tresse, 1876, 35 pages.
10 Scipion l’Africain (-236/-183).
11 Sarah Bernhardt avait donné sa démission une première fois le 24 août 1878. Suite à son voyage en ballon du 22 août qui avait fort incommodé Jules Perrin, on se demande pourquoi, Sarah Bernhardt se vit infliger « mille francs d’amende pour avoir voyagé sans l’autorisation de l’Administration ». Suite à l’intervention du député Edmond Turquet, futur sous-secrétaire d’État à l’Instruction et aux Beaux-Arts, l’amende fut levée et la démission reprise. Lire avec amusement le récit de cette aventure dans le chapitre XXV de Ma double vie déjà cité. Voir aussi Sarah Bernhardt, Dans les Nuages — Impressions d’une chaise, récit recueilli par Sarah-Bernhardt, illustrations par Georges Clairin, Charpentier 1878, 94 pages. On rencontre parfois, comme ici, la graphie Sarah-Bernhardt avec un tiret.
12 Au salon de peinture et de sculpture qui ouvrira le premier mai au palais des Champs-Élysées, Sarah Bernhardt exposera, salle 17, un dessin à la plume et au lavis, La jeune fille et la mort, autoportrait (collection du musée d’art et d’histoire de Genève).

13 Maurice de Hirsch de Gereuth (1831-1896), financier et philanthrope. Fondateur de la compagnie des Chemins de fer d’Orient, Maurice de Hirsch est aussi à l’origine de la fondation de ce qui est devenu de nos jours BNP Paribas.
14 Sur un coup de tête, en effet, Sarah Bernhardt était partie, seule, pour l’Espagne, sans trop savoir s’il était préférable d’embarquer à Bordeaux ou à Marseille. Voir Ma double vie, chapitre XII.
15 François Certain de Canrobert (1809-1895), a appuyé le coup d’État de Napoléon III en 1851.
16 Guillaume Guizot (1833-1892), juriste, traducteur, professeur de lettres.
17 Georges Clairin (1843-1919), peintre et illustrateur, amant de Sarah Bernhardt.

Portrait de Sarah Bernhardt par Georges Clairin, exposée au salon de 1876 et visible au musée du Petit Palais
18 William Busnach (1832-1907), auteur dramatique populaire et prolifique, directeur du théâtre de l’Athénée de 1867 à 1869, déjà fugitivement rencontré, au côté d’Octave Gastineau (note 6 ci-dessus).
19 Amélie Humberta, comédienne bien portante et bien-oubliée.
20 Julia Bartet (Julia Regnault, 1854-1941), deuxième accessit de Comédie en 1872 dans la classe de François-Joseph Regnier, rejoint le théâtre du Vaudeville avant de rejoindre la Comédie-Française en 1879 pour la création de Daniel Rochat (Victorien Sardou, note trois de La Vie à Paris du 24 février 1880).
21 Rosélia Rousseil (1840-1916), premier prix de tragédie en 1861, comédienne oubliée, entrée à la Comédie-Française en 1872 ou 1873.
22 Victorien Sardou, Patrie !, drame historique en cinq actes et huit tableaux créé au théâtre de la Porte-Saint-Martin au printemps 1869. Le texte de la pièce est paru la même année chez Michel Lévy. La distribution y fait apparaître Rosélia Rousseil dans le rôle de Doña Dolorès en même temps (mais après) Anaïs Fargueil. Quand on sait que les deux comédiennes ont 21 ans de différence, on peut supposer que ce drame historique se déroule sur plusieurs années, ce qui semble confirmé par le fait que plusieurs autres rôles sont tenus par deux comédiens.
23 Pour Jeanne Arnould-Plessys (1819-1897), note 9.
24 Françoise Raucourt (Marie-Antoinette Saucerotte, 1756-1815), issue de la misère, est entrée à la Comédie-Française en 1772 à l’âge de seize ans, autant pour son jeune talent que par sa beauté et son tempérament accueillant. Elle a rapidement vécu dans une opulence à laquelle ses mécènes ne parvenaient pas toujours à faire face. Perdue de réputation par ses amours féminines, couverte de dettes, Françoise Raucourt s’est enfuie de Paris en 1876 avec sa compagne du moment…
25 François Buloz (1803-1877), chimiste puis imprimeur puis directeur de la jeune Revue des deux mondes en 1831, en faisant l’une des plus prestigieuse revue française de l’époque. Cette activité que l’on imagine dévorante ne l’empêcha pas de devenir, de 1838 à 1848, administrateur général de la Comédie-Française.
26 Jules Verteuil (1809-1882), a été employé de la Comédie-Française à divers titres pendant 41 ans, de février 1841 jusqu’à sa mort, le 24 février 1882. Secrétaire général de la Comédie-Française 1849, un an après le départ de François Bulloz… Voir Georges d’Heylli, Verteuil, Tresse, 1882, 34 pages.
27 Casimir Delavigne, L’École des vieillards, comédie en cinq actes et en vers créée à la Comédie-Française en décembre 1823. Le texte de la pièce est paru la même année chez Jean-Nicolas Barba.
28 Joseph-Isidore Samson (1793-1871), premier prix de comédie en 1812 est entré à la Comédie-Française en 1826.
29 François-Joseph Regnier (1807-1885) a appris son métier en province avant de rejoindre le Palais-Royal dont le directeur l’oriente vers la Comédie-Française, qu’il intègre en 1871. « L’une des figures les plus attachantes de la troupe au XIXe siècle, acteur de talent, fin lettré, homme de théâtre dans tous les sens du terme », nous dit sa notice de la Comédie-Française. Treize ans après son entrée à la Comédie-Française François-Joseph Regnier est nommé professeur au conservatoire.
30 Fin du texte de l’édition Havard.
31 C’est-à-dire demain 22 avril.
32 En 1876, Sarah Bernhardt a fait construire « un joli hôtel » (Ma double vie) au 35 rue Fortuny, qu’elle dût vendre en 1885. Cet hôtel a été détruit au milieu des années 1950

La maison de Sarah Bernhardt, rue Fortuny en 1881.
Dessin d’Alphonse Trimolet — Musée Carnavalet.
33 Nous n’est pas ici Jules Claretie qui donnait, la veille sa Vie à Paris sur Murger et sa Vie de Bohème mais, colonne six de cette même page trois, la rubrique « Spectacles et concerts ».
34 Sous la plume de d’Émile Perrin, Sarah Bernhardt, considérée comme ne faisant plus partie de la maison, perd dans cette lettre, son titre de Mademoiselle réservé aux comédiennes pour redevenir simplement Madame.
35 Louis-Arsène Delaunay (1826-1903), a débuté sa carrière au Gymnase en 1845 avent de recevoir un accessit de comédie au Conservatoire puis de jouer dans des théâtres de second rang. Louis-Arsène Delaunay est entré à la Comédie-Française en 1848 par la voie du théâtre de l’Odéon. Il donna des cours au conservatoire à partir de 1877 Louis-Arsène Delaunay a écrit Souvenirs de M. Delaunay de la Comédie-Française, préfacés par Jules Claretie et parus chez Calmann-Lévy, sans date mais vraisemblablement parus au tout début de 1901. On ne confondra pas Louis-Arsène Delaunay avec son fils Louis (1854-1937) également de la Comédie-Française, âgé de 26 ans en 1880.
36 Le mot semainier provient de l’organisation des communautés religieuses. Dans les théâtres administrés par une compagnie de comédiens, le semainier était en charge de l’administration ordinaire et de l’organisation matérielle du théâtre pendant sa semaine.
37 Frédéric Febvre (1833-1916) tenait le rôle de Fabrice aux côtés de Coquelin (Annibal), Martel (Monte-Prade), Volny (Horace), Sylvain (Dario), Sarah Bernhardt (Doña Clorinde) et Blanche Barretta (Célie).
38 Ces mots sont les derniers de la page deux, suivis évidemment des premiers de la page trois mais il semble bien manquer quelque chose. Quant au « nouveaud » du typographe…
39 Plutarque, Vies des hommes illustres, traduction d’Alexis Pierron, Charpentier 1853, Volume II, page 199 : « Chacun prenait une coquille sur laquelle il écrivait le nom du citoyen qu’il voulait bannir, et la portait dans un endroit de la place publique […]. Celui dont le nom était écrit sur un plus grand nombre de coquilles était banni pour dix ans. […] / Le jour qu’Aristide fut banni, un paysan grossier et qui ne savait pas écrire présenta, dit-on, sa coquille à Aristide, qu’il prit pour un homme du vulgaire, et le pria d’y écrire le nom d’Aristide. Celui-ci s’étonne : « Aristide t’a donc fait du tort, demande-t-il à cet homme ? — En rien, répondit le paysan ; je ne le connais même pas ; mais je suis las de l’entendre partout appeler le Juste. » Sur cette réponse, Aristide écrivit le nom, sans dire un seul mot, et lui remit la coquille. »
40 Le Figaro du vingt avril dans un autre article d’Auguste Vitu, pages une et deux.
